|
Le regard d’un expatrié La France est le plus révolutionnaire des pays conservateurs. C'est un frondeur paralytique. Nos archives regorgent d'analyses perspicaces de nos défaillances, de propositions ingénieuses destinées à y remédier. Les analyses ont presque toutes été applaudies ; les propositions n'ont presque jamais été appliquées. Jean-François Revel, Le Voleur dans la maison vide, 1999 ***** A chaque tentative de réforme, la rengaine habituelle. Grèves, blocages, crise sociale, vidéos chocs du Petit Journal. Du moins c’est l’impression que la France donne, et que les Français se donnent. D’où la sempiternelle question : la France est-elle irréformable ? La question sonne creux, mais n’appelle pas à une réponse unilatérale. Au contraire, voyons la comme un problème ouvert et constatons l’étendu des thématiques qu’elle véhicule. Le prisme de la loi Travail n’est-il pas une formidable occasion de mettre en perspective les difficultés politiques, sociales et même – osons-le – philosophiques de la France ? Du bien-fondé de la Loi El Khomri Sur toutes les lèvres, la loi Travail, dans tous les débats, son article 2. Penchons-nous sur cette boite de Pandore comme seule la politique française semble pouvoir nous offrir. Loin de moi l’envie de décortiquer chacun de ses articles – même si cela devrait être le premier réflexe de tout citoyen digne de ce nom. Car c’est au-delà de son contenu que la loi Travail fait rage. Et si elle fait l’objet de tels affrontements idéologiques, semblant cristalliser le mal démocratique contemporain, c’est bien parce qu’elle s’inscrit dans un domaine, le droit du Travail, où plus que jamais, la solution n’est jamais ni toute blanche ni toute noire, où toute position catégorique est très vite rattrapée par la réalité. Historiquement, la législation du travail est en effet ambivalente, en ce qu’elle a toujours consisté en la recherche d’un équilibre entre d’une part la protection des travailleurs et d’autre part l’efficacité économique[i]. Et cette recherche permanente de l’équilibre est bien la preuve que celui-ci n’est pas jamais atteint. Pourquoi ? « Parce que le monde bouge » - tout simplement - parce que les entreprises sont les laboratoires de bouleversements infinis, à la merci de mutations économiques mondialisées et de progrès technologiques permanents. A l’aube du XXIe siècle, la France a misé sur le découpage du gâteau “temps de travail disponible” en tranches sécurisées de 35h par travailleurs. L’intention est louable : tout le monde a sa part - celle-ci et protégée et stable - et personne n’est surexploité. Mais le constat est sans appel : l’économie française, aux proies a une concurrence mondiale toujours plus sévère, tourne au ralenti, et compte 5M de chômeurs. L’échec est retentissant, car le point d’équilibre n’est pas atteint : la balance penche du cote du droit des travailleurs, trop protégés, au détriment d’entreprises à l’efficacité minée, et qui n’osent plus embaucher. En somme, dans le domaine de l’emploi, la France a préféré la qualité à la quantité. Les chômeurs sont ainsi victime de l’effet Matthieu : “À celui qui a, il sera beaucoup donné ; mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris”. En d’autres termes, ceux qui ont un emploi ont eu les 35 heures et les RTT, mais les chômeurs guère d’embauches, ce qui était pourtant le but initial de la loi Aubry. [i] Les illustrations de cette ambivalence sont multiples dans l’histoire. On peut par exemple prendre la loi Waldeck-Rousseau de 1884 reconnaît l’existence des syndicats, mais oblige ces derniers à déposer leurs statuts en préfecture :” un moyen simple pour avoir les adresses des responsables syndicaux en cas de débordements” ou encore l’indemnité de fin de contrat de 10 % due à l’échéance d’un CDD: bénéfice pour l’employé et “incitation à aller jusqu’au bout du contrat : ce qui est une sécurité pour les employeurs”. A lire au passage l’itw de Jean-Emmanuel Ray, professeur a Université de Paris I-Sorbonne: http://www.lenouveleconomiste.fr/jean-emmanuel-ray-universite-de-paris-i-sorbonne-la-loi-travail-opere-un-bon-equilibre-entre-droit-du-travail-et-droit-a-lemploi-mais-passe-un-peu-vite-sur-les-effets-du-tsunami-numeriq-30308/ Les maux de l’économie française uniquement le fait des 35h ? Non, bien évidemment : les 35h ont été l’objet de plusieurs ajustements, et il faut souligner que les Français sont dans la moyenne du temps de travail hebdomadaire et annuel européen, ses salariés travaillant notamment davantage qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, avec une des plus fortes productivités du vieux continent[i]. Ainsi les 35h ont surtout une valeur symbolique, mais elles révèlent un paradigme malsain dans la législation française du travail. A ce sujet, Jean Tirole, lauréat du prix Nobel en d’économie 2014, rappelle dans Economie du bien commun : « Les économistes ne prennent jamais parti sur la question de savoir si l’on devrait travailler 35, 18 ou 45 heures par semaine. En revanche, la thèse selon laquelle réduire la durée du travail, avancer l’âge de la retraite, bloquer l’immigration ou adopter des mesures protectionnistes créera des emplois pour les autres n’a aucun fondement, ni théorique ni empirique.” Un autre élément clé sur lequel Tirole s’attarde dans son ouvrage est l’obsolescence de notre contrat de CDI à la française. Trop protecteur, il permet d’expliquer le fait que la grande majorité des emplois crées en France soient des CDD : 85% en 2013 (90% si l’on ajoute l’intérim), contre 75% en 1999. Or, bien que le CDD ne convienne ni à l’employé ni à l’employeur, il n’est que très rarement (cf chiffre ci-dessus) converti en CDI, contrat qui est à l’opposé en terme de protection : « (…) l’employeur est très fortement incité par la réglementation à ne pas le prolonger, même si la personne employée a donné satisfaction. De fait, au sein de l’Europe, la France est le pays où la transition d’un contrat temporaire vers un contrat stable est la plus faible. » Ainsi, on peut voir d’un bon œil la loi El Khomri, qui prévoit un allègement du droit de licenciement pour redonner aux patrons le gout du CDI, et réduire la crainte d’une embauche à durée indéterminée. Ayons conscience que notre législation ne fonctionne pas, et qu’une reforme mérite d’être tentée. Aujourd’hui ce sont des millions chômeurs qui frappent à la porte du monde du travail, et sont contraints de profiter (avec plus ou moins de bonne volonté, peu importe) des services d’un Etat Providence toujours plus endetté. D’aucuns pourront prendre les même chiffres, et conclure le contraire ; vanter les mérites de nos 35h et de notre CDI à la française. On ne le répètera jamais assez, il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. Mais cet effrayant contingent de sans-emplois est une donnée qui interpelle forcement. Tendances mondiales Certains esquivent la nécessité de réforme en soulignant le caractère trompeur du plein emploi allemand et américain. En effet, en Allemagne comme aux US, les chiffres de l’emploi occultent la réalité précaire des millions de travailleurs aux petits boulots sous-rémunères et très peu protégés (moins encore que nos CDD français) – réalité qui se traduit par un mécontentement électoral paradoxal au vu de la bonne santé économique de ces pays. Mais ne préférions-nous pas inclure tout le monde dans notre monde du travail, quitte à offrir des boulots moins précaires à certains ? La question mérite d’être posée - mais elle semble réglée d’avance ne France. Emplois low-cost vs chômage, c’est pourtant débat incontournable aujourd’hui, que le dernier rapport de l’OCDE tranche avec conviction : les pays de l'OCDE doivent cesser se soucier de l'inégalité des rémunérations et se focaliser sur le fait que plus de travail implique plus de rémunérés. Dans un premier temps, tout doit être ainsi fait, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne, pour faire baisser le chômage, quitte à offrir des rémunérations plus basses. Et ce n'est qu'une fois que le chômage a baissé que l’on doit se préoccuper d'augmenter les rémunérations. Pour rappel, la Grande-Bretagne, satisfaite de son taux d’emplois, a introduit cette année un salaire minimum élevé pour tous les travailleurs de plus de 25 ans : 7.20 livres sterling par heure, soit 9.25 euros, avec un projet d’augmentation de 60% d'ici 2020 à 9 livres sterling de l'heure, soit 11.50 euros, largement au-dessus des 9.67 euros de l'heure en France… Une réussite à faire pâlir de jalousie tous nos décideurs politiques. Prenons également conscience qu’au-delà du débat low-cost vs chômage, le sujet de préoccupation mondial est aujourd’hui le phénomène d’uberisation qui touche nos économies et nos travailleurs. De toute évidence, nos législations et nos concepts salariaux issus de la seconde révolution industrielle ne sont plus adaptés à cette nouvelle donne des emplois numériques. Et il appert que c’est à notre langage juridique de se reconstruire et de se conformer - plutôt que d’appliquer notre grille de lecture obsolète et de dénaturer une tendance inexorable. A ce sujet, loi du travail ne va pas assez loin, en se limitant à la création compte personnel d’activité (CPA), embryon de protection sociale moderne qui protège les personnes et non plus les statuts (salariés, indépendants)… à suivre, en somme, mais à souligner. [i]http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/18/la-france-pays-ou-l-on-travaille-le-moins_4489150_4355770.html 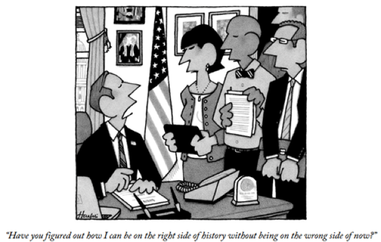 Pourquoi tant d’émoi ? En résumé, la Loi Travail, qui fait le constat des dysfonctionnements de notre marché du travail et tente de se rapprocher du point d’équilibre protection-emploi, semble faire preuve de bon sens. Notre législation pèche par une protection excessive des salaries, le gouvernement tente donc de redresser la barre vers plus d’efficacité économique – avec beaucoup de retards sur ses voisins européens, et beaucoup de concessions aux frondeurs de son propre camp. Pourquoi alors tant d’émoi ? Peut-on y voir un manque de compréhension réelle du sujet par la majorité de la population[i] ? Peut-être. Au passage, il convient de déplorer l’absence de toute intention pédagogique du gouvernement – nous y reviendrons. Là où le bât blesse, c’est qu’on voit bien que la législation du travail est, en filigrane, un affrontement entre une conception libérale et une conception socialiste du droit. Ainsi, la réduction du problème à l’affrontement primitif de ces deux conceptions - renforcée l’impartialité des discours politiques partisans - est aisée, et fait des dégâts. Mais n’est-ce pas un mal commun à tous les régimes démocratiques ? Le peuple gouverne, or le peuple est mal informé, il est versatile et cède à la démagogie, au péril du savoir et de la raison… Sempiternelle thématique de philosophie – je me garderai de vous ressortir l’argumentaire de Platon ou d’Aristote, pour me contenter de cette citation de Churchill : « la démocratie est le pire régime politique, à l’exception de tous les autres ». Mais si la démocratie française n’a pas le monopole de l’immobilisme – gardons par exemple en tête le shutdown américain de 2013 – elle semble donner l’impression, de l’intérieur comme depuis l’étranger, d’être la pire. Permettons-nous de droper le name d’Hubert Védrine, qui déplorait en 2013 (dans le cadre de la promotion de son livre) : « Je suis français par toutes mes fibres. Mais, à force de parcourir le monde, de l’analyser, d’agir par le pouvoir ou l’influence, de comparer, je suis devenu de plus en plus consterné par les blocages français et désolé de leurs conséquences sur la France ». Pourquoi une telle impression d’immobilisme en France ? Au-delà du mécanisme d’un ressenti peut-être erroné, deux éléments de réponses font de sens à mes yeux. L’un est indémontrable, totalisant, et donc bourré de stéréotypes : les Français détestent l’autorité – et par extension les élites. L’autre, plus concret, est un constat sans prétention sur notre horizon politique : les frontières des groupes politiques français sont obsolètes. Un spectateur engagé [i] Et dont l’amateurisme de cet article n’est que la parfait illustration
0 Commentaires
"Une partie du monde semble embourbée dans une croissance faible voire négative. Heureusement, les facteurs freinant l'économie ne sont pas tous hors de contrôle."
Une grande partie du monde (notamment le monde développé) est engluée depuis quelques années dans une croissance faible et une baisse du PIB, au point que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'un état semi-permanent qui est en train de s'installer - ce que l'on peut qualifier de «stagnation séculaire 1» ou SS1. C'est sans doute le cas, mais s'en tenir là est insuffisant et n'a donc qu'une utilité limitée. Plusieurs facteurs sont susceptibles de freiner la croissance et ils ne sont pas tous hors de notre contrôle. Il faut évidemment prendre en compte le fait que nombre d'obstacles qui s'opposent à la croissance sont difficiles si ce n'est impossibles à éliminer à court terme sans menacer la stabilité à long terme. C'est la persistance de cette situation qui est à l'origine de la SS1. Une conjonction de facteurs négatifs Le premier signe de la SS1 est en rapport avec l'innovation technologique. Si comme le soutient l'économiste Robert Gordon, nous sommes dans une phase où cette dernière n'améliore pas beaucoup la productivité, le potentiel de croissance à long terme s'en trouve limité. Même si le rythme de l'innovation n'a pas trop baissé, ou s'il s'accélère à nouveau prochainement, l'adaptation structurelle et les changements de comportement nécessaires pour bénéficier des gains possibles de productivité prendront du temps. La SS1 tient aussi à l'impact des incertitudes (quant à la croissance, à la sécurité de l'emploi, aux réglementations et à toutes les évolutions qui pourraient affecter ces facteurs) liées à l'investissement et à la consommation. Les gens ne savent tout simplement pas si les pouvoirs publics vont prendre des mesures pour combattre les pressions déflationnistes, s'opposer à la montée des inégalités et à la fragmentation sociale et politique et pour restaurer la croissance et lutter contre le chômage. L'investissement privé est à la baisse dans de nombreux pays, le dernier en date étant la Chine, et l'on ne sait comment la demande va évoluer. Il en est de même des dépenses des ménages, surtout dans les pays avancés où toute une partie de la consommation n'est pas indispensable (par exemple le remplacement des produits de consommation durables, les voyages, les sorties au restaurant). Etant donné le temps qu'il a fallu aux Etats-Unis pour se redresser après la Grande dépression (jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'une grande partie de la demande émanait de l'Etat), il ne faut pas s'attendre à une inversion prochaine de cette tendance. La dette est le troisième signe de notre embourbement dans la SS1. Les ménages, les entreprises, les institutions financières et les Etats sont confrontés à des contraintes budgétaires, ce qui les conduit à freiner leurs dépenses et leurs investissements et à épargner davantage - avec pour effet l'apparition d'un environnement hautement déflationniste. Bénéfique à long terme, une politique de soutien au désendettement et à l'assainissement du bilan (la reconnaissance des pertes, la réduction de la valeur des actifs et la recapitalisation des banques) a un coût immédiat. Redresser le bilan prend du temps, surtout pour les ménages, et à court terme freine la croissance. Des mesures possibles en faveur de la croissance La situation n'est peut-être pas aussi sombre qu'il y paraît, car une série de mesures pourrait peu à peu doper la croissance et améliorer sa qualité. Cela montre que nous sommes semble-t-il confrontés à un deuxième type de stagnation séculaire - appelons la SS2 - qui tient à notre réticence ou à notre incapacité à appliquer ces mesures. L'une des principales serait de combattre la montée des inégalités . Il est sans doute difficile de contrer efficacement ses causes - notamment la mondialisation et les progrès de la technologie digitale - mais il est possible d'y remédier par un processus de redistribution reposant sur la fiscalité et la protection sociale. Lorsqu'une économie est en restructuration, tous ceux qui en ont besoin doivent pouvoir bénéficier d'une reconversion professionnelle afin de s'adapter aux changements. Il faut aussi repenser la politique monétaire sur laquelle repose une grande partie du fardeau du redémarrage depuis la crise économique de 2008. Des années de taux d'intérêt extrêmement bas et de relâchement monétaire à grande échelle n'ont pas réussi à relancer suffisamment la demande agrégée, et encore moins à réduire significativement les tendances déflationnistes. Augmenter unilatéralement les taux d'intérêt n'est pas sans risque, car dans un contexte de demande faible, des taux plus élevés attirent les capitaux - ce qui pousse à la hausse le taux de change et en conséquence freine les exportations. C'est pourquoi les dirigeants des pays avancés devraient envisager de contrôler d'une manière ou d'une autre leurs comptes de capitaux (à l'image des pays émergents qui réussissent), ce qui faciliterait l'adoption de mesures prises en toute indépendance et mieux adaptées pour sortir de la répression financière. Un troisième axe consisterait à utiliser davantage l'outil budgétaire, principalement en matière d'investissement dans le secteur public. L'Europe en particulier paye un prix élevé pour ne pas l'avoir fait - une décision qui tient au caractère impopulaire de la dette et des transferts budgétaires. Fait dans de bonnes conditions, le recours au bilan des fonds de pension et desfonds souverains permettrait de financer l'investissement. De nombreux autres domaines, suivant les pays, mériteraient d'être réformés. Il s'agit essentiellement de la fiscalité, de l'utilisation des fonds publics, de la structure des marchés de produits et des marchés de facteurs de production et du manque d'adéquation entre le rayon d'action des institutions financières internationales et la capacité des Etats à intervenir en cas de difficultés financières importantes. Du fait de la SS1, il est difficile de remédier à la SS2. Il semble que même une politique énergique tant au niveau d'un pays qu'au niveau international ne permettra pas d'éliminer le risque d'une demande et d'une croissance insuffisantes sur une longue période. Pour autant, il n'y a aucune raison de retarder l'application de mesures qui pourraient avoir un impact. De même que notre politique passée a favorisé l'émergence de la SS1, notre politique actuelle, si elle écarte les mesures destinées à combattre la SS2, pourrait conduire à une situation beaucoup plus difficile demain. Cet article est publié dans le cadre du Project Syndicate, 2016 - Comment combattre la stagnation séculaire Michael Spence, professeur d’économie à la Stern School of Business de l’université de New York |
AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives
Janvier 2017
Catégories |
|
L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].
Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |




 Flux RSS
Flux RSS