|
Suite à l’attaque de ce fou islamiste à Nice, et aux nombreux précédents réalisés ou déjoués, et en prévision / prévention des suites, nombreuses sont les voies, au sein de la classe politique, comme émanant de la société civile, à s’être élevées contre une inaction supposée de l’Etat, du gouvernement et de ses bras armés et justiciers. C’est sans doutes trop peu, tant l’arsenal contre-terroriste compte aussi des armes sociétales, en plus du pénal, du militaire, du policier – nécessaires mais insuffisantes, et dont il faut sans doutes agrandir le spectre. Ici je ne m’attarderai pas sur ce triptyque de la fonction régalienne, la Défense, la Police, la Justice. Je ne ferai pas cas non plus des réponses religieuses à un problème qui comporte également une forte composante religieuse. Ici, je parlerai de société.
« Ne vous demandez pas ce que l’Etat peut faire pour vous » L’Etat ne peut pas tout, disent les économistes libéraux. Cela est vrai aussi quand il s’agit de terrorisme, et le risque zéro n’existe pas, même si beaucoup d’efforts portent leurs fruits, et il y a plus d’attentats évités que de tentatives réussies, fort heureusement, même si ces derniers nous font oublier l’énorme travail réalisé derrière les meurtres tués dans l’œuf. Les services de police, de renseignement sont en sous-effectifs et en manque de moyens. Les prisons sont surpeuplées. Nous avons d’autres sujets importants, d’autres chats à fouetter. Toute notre énergie, toute notre attention doivent également être focalisées sur d’autres sujets, tout aussi essentiels à la lutte contre le terrorisme et autres problèmes – mais pour le futur. L’Etat ne peut pas tout. D’une part parce que l’Etat n’est pas responsable de tout – nous ne sommes pas des soviets – et d’autre part parce que le beaucoup dont l’Etat a la charge, eh bien les récipiendaires de la souveraineté populaire en font parfois mauvais usage, même si ce n’est pas faute de bonne volonté. « Assez de mots, des actes ! » Arrêtons de critiquer les politiques, si on en attend moins du pouvoir, on sera moins déçu. Que peux-tu faire, toi, citoyen ? « Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour vous » (JFK) Ces dernières années ont vu le développement d’une pensée « bottom-up » plutôt que « top-down ». Le Royaume-Uni a ici une longueur d’avance sur nous. Je pense notamment au mouvement de neighbourhood watch, les voisins vigilants, pour empêcher les voleurs de pénétrer dans leur quartier. Je pense aussi aux écoles autonomisées et co-gérées par les parents. Les citoyens doivent pouvoir s’organiser, sous la férule de l’Etat, et en toute légalité. Ils doivent pouvoir défendre leurs écoles, leurs lieux de culte, etc. Cela nous responsabilisera, cela permettra aux politiques et aux fonctionnaires de moins faire, pour mieux faire. Face à des attaques qui sont imprévisibles et elles aussi « bottom-up », a l’instar de l’intifada des couteaux en Israël, ou de l’attaque de Nice, c’est-à-dire pas forcément téléguidées et minutieusement préparées, mais qui peuvent être le fait de n’importe qui, il faut premièrement se dire et se rappeler que c’est possible, vivre avec (et mourir avec, parfois aussi…). Une identité nationale positive, la fraternité citoyenne L’identité nationale, ou européenne, loin d’être uniquement sujet à débats houleux, comme sous Sarkozy, peut être vécue de manière positive. Rétablissons le service, civique ou militaire, national ou européen. Connaissons-nous mieux, favorisons le dialogue, la mixité, la diversité. Si je connais autrui, j’ai moins de chances de le détester, et plus de chances de l’aimer, de me sentir son frère. C’est le sens de l’amour, comme le dit l’acteur Saïd Taghmaoui ou encore Joann Sfar dans un billet. La plupart des jeunes, issus de l’immigration ou pas, qui ne se sentent pas chez eux dans ces cités, dans la France actuelle, il faut les faire se rencontrer avec d’autres populations, et vice-versa. Juste un petit exemple : l’école 42, où des centaines, des milliers de jeunes venus de Paris, de la banlieue, des provinces – voire de Chine et de Roumanie – affluent, et peu importe leur origine. L’esprit est bon enfant, le travail et l’envie de réussir sont là, et la coopération est au rendez-vous entre un bourge, un wesh, un gothique. « Un quart des élèves ont un casier judiciaire. Eh bien, en trois ans, il n’y a jamais eu aucun acte délictuel dans l’école » s’enthousiasme Xavier Niel dans Challenges. Les faire se rencontrer, c’est bien beau dans la théorie, mais dans la pratique, à part 42 ? Je ne sais pas, mais je suis sûr que plein d’initiatives existent ou demandent à éclore. Car il y a deux France, au moins, cela peut sembler manichéen : la France identitaire, celle de l’(extrême-)droite et des islamistes, et la France qui s’en fout, la France qui regarde où les gens vont, pas d’où ils viennent. Manuel Valls a parlé à juste titre d’un « apartheid » social et spatial. Seulement, il s’avère que l’action du gouvernement s’est limitée à l’urgence, pas à construire dans le long terme, à investir dans l’éducatif, dans l’associatif. Il faut penser aux actions de réponse à l’immédiat, mais également penser au plus long-terme sous peine de quoi, mécaniquement, les mêmes causes produiront les mêmes effets, en pire. Le patriotisme demande à ressurgir, qu’il soit national ou européen. L’hymne national, ou même dans un futur proche, l’Ode à la Joie (hymne européen), demande à être chanté dans la cour de récré, comme c’est le cas dans les écoles de la Fondation Espérances Banlieues, une initiative soutenue par Harry Roselmack. L’éducation civique, cette matière chiante du collège, demande à être réformée pour être vécue et prendre tout son sens, pas juste représenter des notes. L’éducation tout court est le premier pilier de la lutte contre le terrorisme (et accessoirement le chômage), quitte à dire une énième fois cette banalité. A ce propos, lisez cela. Remplaçons le religieux par le républicain, pour de bon, ou plutôt, redonnons la primauté au républicain. Faites de l’humanitaire… en France, de l’associatif, du social, engagez-vous, lisez cet article : et sortez le drapeau, pas que pour Grizou. Voilà quelques pistes, quelques idées pour (re-)commencer. « Que faire ? » disait le camarade Lénine. J’espère vous avoir apporté ici quelques pistes de réflexion-action, à compléter évidemment !
0 Commentaires
Que Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui a tué plus de 80 personnes à Nice le 14 juillet, ait agi au service de Daech ou qu’il soit un déséquilibré qui s’est approprié les symboles djihadistes du groupe, la même question essentielle se pose : Pourquoi autant d’attentats d’une telle envergure ont-ils lieu en France plutôt que dans d’autres pays d’Europe? La Belgique a aussi été frappée récemment, mais moins souvent. En Angleterre et en Espagne, il n’y a pas eu d’attentats faisant plus de dix morts depuis plus d’une décennie. En Allemagne, il n’y a pas eu d’attentat de grande envergure du tout. La défaillance des services de sécurité et de renseignements français ne saurait être l’explication principale de cette différence puisque que partout en Europe ces services souffrent de problèmes de communication. La réponse est autre : En matière de djihadisme aussi il existe une exception française. La spécificité de la France tient en partie de la puissance idéologique de l’idée que la nation se fait d’elle-même depuis la Révolution française, avec son républicanisme revendicateur et sa suspicion affichée envers toute religion, à commencer historiquement par le Catholicisme. Ce modèle a été malmené depuis, d’abord par la décolonisation et plus tard par des années de crise économique, la stigmatisation de particularismes culturels, l’individualisme forcené des nouvelles générations et la globalisation, qui a réduit les marges de manoeuvre de l’Etat. Avant tout, la France n’arrive pas à résoudre le problème de l’exclusion économique et sociale. Son modèle, trop protecteur de ceux qui détiennent un emploi et pas assez ouvert à ceux qui n’en ont pas, nourrit le mal-être des uns et des autres. Les jeunes des banlieues, exclus et avec peu de perspectives, se sentent victimisés. Ils deviennent vite les cibles privilégiées de la propagande djihadiste, souvent après avoir fait un passage en prison pour divers délits. Ni l’Allemagne ni l’Angleterre ne connaissent le phénomène des banlieues à une telle échelle. La ville allemande de Dinslaken, partiellement ghettoïsée, est devenue un foyer de radicalisation Islamiste. Il en est de même pour Dewsbury dans le West Yorkshire, ou encore la commune de Molenbeek à Bruxelles. Mais la France semble aliéner un nombre plus important encore de ses ressortissants, et bien au-delà de ceux qui rallient Daech. Une des raisons est que le projet de citoyenneté de la nation française, qui insiste lourdement sur une adhésion à des valeurs politiques exaltées, a très mal résisté à l’usure. Dès les années 1980, l’idéal républicain était en difficulté : Il avait promis l’égalité des chances et celle-ci faisait défaut. Le Parti communiste français, qui a longtemps apporté dignité aux groupes défavorisés en leur proposant de résister à l’injustice par la lutte des classes, s’est grandement affaibli à cette époque-là, en partie du fait de l’effondrement de l’Union soviétique. L’Allemagne, quant à elle, a opté après la Seconde guerre mondiale pour un idéal nettement plus modeste et plus prudent : le progrès économique. Aujourd’hui, elle a une politique étrangère assez réservée à l’égard du monde musulman, et elle n’affiche pas la volonté de rassembler tous ses citoyens autour de principes universalistes. L’Angleterre non plus ne cherche pas à créer une société mono-culturelle. Elle a opté pour le multiculturalisme, qui tolère la coexistence d’identités à trait d’union et les conduites dites particularistes. La France, résolument universaliste, prétend toujours vouloir et pouvoir intégrer tous les français. Mais cette ambition assimilationniste est de plus en plus en porte-à-faux avec la réalité quotidienne, et ce décalage grandissant angoisse tout le monde. C’est donc la force, le poids, de l’identité nationale de la France qui pose problème aujourd’hui. Elle accentue en particulier le malaise des jeunes provenant d’ailleurs, surtout d’Afrique du Nord, d’autant plus que la région a été décolonisée dans la douleur et l’humiliation. Le départ de la France d’Algérie a fait des centaines de milliers de morts et laissé des séquelles qui sont encore présentes dans l’inconscient collectif. Les décolonisations anglaises peuvent paraître presque indolores en comparaison. Certes, les Anglais, ainsi que les Allemands, émettent eux aussi des craintes face à l’immigration et à l’islam. C’était l’un des motifs essentiels du Brexit ; des actes de harcèlement sexuel apparemment commis par des immigrés à Cologne en début d’année ont provoqué un houleux débat en Allemagne (et au-delà). Mais en Angleterre comme en Allemagne une large autonomie est laissée à la pratique religieuse et communautaire de minorités issues d’ailleurs et à leur expression dans l’espace public. La France, elle, exige qu’au nom de l’idéal républicain la religion reste une affaire strictement privée. Nation idéologique par excellence, elle se focalise sur des sujets symboliques, limitant par exemple le port du foulard ou les prières collectives en public. Ces restrictions blessent par-delà leur réalité, ce qui permet aux islamistes d’en exagérer les enjeux plus encore et de s’en prévaloir pour accuser la France d’islamophobie. En réalité, la France n’est pas plus islamophobe que ses voisins ; elle est juste plus frontale dans sa gestion de l’islam dans la sphère publique. L’intégration à la française a eu certains succès. Parmi eux, notamment, un taux élevé de mariages mixtes. L’école républicaine, qui a permis de promouvoir les classes populaires, et donc une partie importante des jeunes d’origine nord-africaine, a aussi été un outil d’intégration (même si elle semble moins efficace dernièrement). Les enfants d’immigrés, rencontrant parfois des préjugés sur un marché de l’emploi longtemps sclérosé par le chômage, ont pu trouver refuge dans les institutions publiques comme l’armée et la police, où l’embauche se fait par concours anonymes. Mais si la France a intégré beaucoup d’étrangers et leurs descendants, ceux qu’elle a laissés en marge sont plus aigris que leurs congénères allemands ou anglais : Nombreux d’entre eux se sentent offensés dans leur identité arabe ou musulmane. La laïcité, si inflexible, semble dénier leur dignité. A cela s’ajoute une politique étrangère française musclée qui semble privilégier pour cibles des pays musulmans comme la Libye, la Syrie ou le Mali. Le système d’intégration français est généreux dans ses principes mais trop rigide dans sa pratique. Les réalités de la société française aujourd’hui exigent une approche plus pragmatique et plus souple, avec moins de diktats idéologiques et moins d’anxiété face à la pluralité. La France n’est plus ce qu’elle était et il est temps qu’elle se fasse à cette idée. FARHAD KHOSROKHAVAR Sociologue directeur d'études à l'EHESS, auteur de nombreux ouvrages sur la radicalisation Ce 7 janvier tu as reçu une balle à l'épaule ,qui t'a marquée et traumatisée . Toi qui es si belle, gentille et attentionnée, tu aimes et fais confiance à tes enfants, ceux que tu as enfantés comme ceux que tu as adoptés . Le bras attelé , tu es fatiguée mais encore rayonnante, debout et pleine d'espoir. Tes enfants se chamaillent mais tu essayes de les apaiser, de les comprendre et de leur apporter bienfaits . Comme toutes les blessures , tu as su guérir et cicatriser, sans pour autant oublier . Sans pour autant oublier que cette balle c'est un de tes enfants qui l'a tirée..... Te voilà à terre le 13 novembre , tu es de nouveau blessée. Une balle au genou qui t'empêche de te lever , une blessure si profonde , qu'aucun de nous ne pourra t'aider . Je te vois souffrante , tu pleures et je suis impuissant . Impuissant face à mes frères qui t'ont estropiée . Impuissant face à la destruction de ton âme que je vois se réaliser . J'ai tellement mal, je ne sais pas comment t'aider... Hier je n'étais pas à la maison , j'apprends que tu es de nouveau attaquée . Je ne comprends pas très bien ce que l'on me dit . Tu es allongée , on ne t'entends plus respirer . Je commence à paniquer. Que s'est il passé ? Un cauchemar ou la réalité ? Je commence à douter tellement je suis dépassé par autant d'atrocités , autant de haine que mes frères peuvent te porter . Je ne peux rien faire seul mais tu sais je suis comme plein d'amour et plus intelligent qu'eux Avec mes autres frères et sœurs on va te sauver ! On est plus nombreux on avait déjà commencé , ils nous ont arrêté . On ne te laissera pas tomber .Tu nous as toujours tout donné . Tes jambes sont peut être plus fragiles et ton âme attristée mais tu es plus plus forte que jamais. C'est à notre tour de te protéger . Relève toi et punis une fois pour toutes ces enfants qui n'ont jamais voulu t'écouter , ces enfants égarés pour lesquelles tu ne peux plus rien donner .. S'il te plait ouvre les yeux et sois plus autoritaire, ne te laisse plus manipuler ...car les gens font toujours plus de mal aux gentils et ça tu le sais . Repose toi et demain matin les choses vont changer . Je te le promets Je t'aime maman Othman Zem Partout les hommages se multiplient et toute la scène politique salue d’une seule et même voix Michel Rocard pour une dernière fois. Qu’il est étrange ce cortège funéraire où l’on trouve, nombreux, ceux qui se revendiquent de son héritage marchant côte à côte avec les opposants de toujours qui malgré la discorde ont toujours estimé l’homme pour la force de ses convictions. Qu’il est étrange ce cortège funéraire pour celui qui se décrivait lui même comme un « oiseau rare, isolé et sans relations ». Peut-être faisait-il référence, aussi, à l’albatros Baudelairien qui, les ailes trop grandes pour marcher sur terre, ne peut comprendre les affaires des hommes. Il est important pour toute une génération qui ne le connaît que trop peu de retracer le parcours de ce militant de toujours. é Un engagement précoce La lutte, le petit Michel a dû l’apprendre très tôt dans la maison bourgeoise qui l’a vu grandir à Courbevoie. Yves, son père, résistant, professeur et chercheur veut que son fils épouse comme lui une carrière scientifique. Il n’en sera rien, ce qu’il aime lui c’est la politique, les combats idéologiques sans fin. Déjà ses camarades scouts l’ont bien compris et le surnomment, un brin moqueur, « le hamster érudit », hamster car il est menu et la forme de son nez rappelle celui de l’animal malicieux, érudit bien sur car il passe le plus clair de son temps à lire. Il aime parler aussi, si bien que l’on pourrait croire qu’il lit un livre quand il parle. Mais son père n’aime pas ça et après avoir décroché un bac avec une mention assez bien grâce aux matières littéraires, il décide de l’inscrire en maths-sup contre son gré. Comprenant qu’il n’avait aucun don scientifique il décide de s’inscrire à sciences Po, la déception chez son père qui le voyait polytechnicien est énorme, il lui coupe les vivre puis lui trouve un petit boulot de tourneur fraiseur dans une usine de Courbevoie. C’est là au côté d’un contre-maître qu’il est initié au socialisme, le vieux briscard rouge devient un temps son « mentor » et lui compte l’histoire du mouvement socialiste. Plus jamais cette idéologie ne le quittera. Il adhère rapidement au SFIO mais très vite l’étudiant qui est désormais à l’ENA est jugulé par la position du parti vis à vis de la question Algérienne et notamment par le comportement de Mendes France. C’est ce traumatisme qui le mènera à la création du PSA (parti socialiste autonome), puis du PSU plus tard. Haut fonctionnaire, il adoptera même le pseudonyme de Michel Servet –protestant mort pour la liberté- et démontera la politique française en Algérie, notamment les camps d’internement dans des rapports au vitriol. L’audace, encore et toujours l’audace le pousse, dès 1969, à se lancer dans la course à la présidentielle. Alors illustre inconnu il devient très vite le candidat à la mode, brille dans les milieux intellectuels, son courage plaît au peuple et le renouveau qu'il incarne séduit la jeunesse de Mai 68. A mi-chemin entre la sociale-démocratie et l’idéologie marxiste, il propose une offre politique jusqu’alors inexistante. Bien que déçu de son résultat –il obtient tout de même des scores similaires à ceux de la gauche traditionnelle de Mendes et Defferre- il est désormais devenu une figure incontournable du paysage politique français.  Un destin qui s’acharne Une seule personne les sépare à la tribune en ce jour de Mai 1974 au congrès du parti socialiste, mais le regard noir de Mitterrand laisse apparaître la tension qui règne entre les deux hommes. Mitterrand n’aime pas l’attitude du haut fonctionnaire et le fait savoir. Il le juge sévèrement et le méprise profondément cet inspecteur des finances qui représente au fond tout ce qu’il déteste. Fin politique, il sait le danger que représente Rocard et l’engouement qu’il a su crée autour de lui mais il dispose d’une arme redoutable : le PS. C’est en 81, que le destin va une première fois abandonner Rocard, où plutôt c’est Rocard qui va abandonner son propre destin. Alors que tout le monde s’attend à ce qu’il annonce sa candidature face à un Mitterrand -conspué, jugé hautin et dépassé- il affirme qu’il ne se présentera que si Mitterrand lui ne le fait pas. Mitterrand n’en avait pas demandé autant, il se présente et contre toutes attentes est élu en 81, ce sera alors une traversée du désert pour Rocard écarté par le nouveau monarque. Peu importe, il continue à s’interroger à réfléchir, à représenter une véritable force de proposition. Réélu, Mitterrand sait qu’il devra le nommer et décide que Matignon sera son purgatoire. Le Machiavel élyséen espère en réalité l’éliminer et affirme en privé que « dans six mois, on verra à travers. » c’était mal connaître Rocard, une éternité qu’il attendait ce moment dans l’antichambre du pouvoir. Accompagné d’une équipe de choc, il enchaine les réformes les plus difficiles avec un certain brio : RMI, CSG… Il résiste 3 ans et jouit d’une popularité qui ne semble s’essouffler, s’en est trop pour Mitterrand qui le congédie brutalement et sans raison: après tout c’est lui le roi. Il jouera ensuite de manigances, allant jusqu’à soutenir Chirac en sous-marin faisant voler en éclat tous les espoirs présidentiels de Rocard en 95. Une idéologie en héritage
Si tant d’hommes et de femmes de conviction se revendiquent du « rocardisme », ce n’est pas un hasard. Un peu comme le patriarche d’une école philosophique, Rocard a formé autour de lui de nombreux émissaires –à l’image de Manuel Valls- qui aujourd’hui encore dispensent "une façon de faire de la politique". Mais c’est en 1977 à Nantes que l'on trouve l'acte fondateur de cette idéologie: il va alors énoncer un discours dans lequel il affirme qu’en France il existe deux gauches. L’une, longtemps dominante est jacobine, étatique et héritière d’une idéologie marxisante. L’autre est décentralisatrice, régionaliste, elle refuse l’arbitraire des patrons autant que de l’Etat, elle réclame l’autonomie et l’autogestion. Elle refuse aussi l’utopie que promettent les dirigeants du PS, connaît la réalité économique et c’est que c’est à la politique de s’adapter au réel et non le contraire, Ce jour là tout est clair, Michel Rocard est le chef de file de cette deuxième gauche. Mais le Rocardisme c’est aussi une manière de faire de la politique. Pour Rocard, la politique c’était « les idées » alors que la politique, pour Français Mitterrand, c’était «les hommes». Cette distinction a été notamment reprise par Jean Lacouture dans sa longue biographie de Mitterrand où il souligne combien les « Rocardiens » avaient la prétention d’être d’abord des « intellectuels ». Un paradoxe quand beaucoup affirment qu’« un homme politique est un intellectuel qui ne pense pas», selon la formule célèbre du grand théoricien américain Harold Rosenberg. On peut, comme moi, ne pas être dans le camp politique de Michel Rocard mais nous ne pouvons que saluer la façon dont il a changé la manière de faire de la politique. Peut-être seulement, était-il en avance sur son temps et avait-il affirmé trop top l’importance du principe de réalité. Une chose est certaine, aujourd’hui les français ne veulent plus des mensonges qui ont été servis à la pelle par la gauche au grand dam de Rocard et comprennent que les idées, les vrais, ne sont pas aussi attrayantes que les discours populistes . Et bien que leurs idéologies soient différentes, la méthodologie Rocard se rapproche en ce sens de celle de Juppé: ce n’est pas un hasard d’ailleurs si les deux hommes ont écrit un livre ensemble. Rédouane Ramdani Torpeur économique et désolation de soi sont les deux grands enjeux que notre société doit relever. Zoom sur la désolation de soi, ses tenants et aboutissants. Pourquoi l’identité heureuse n’est aujourd’hui qu’un vague espoir. Notre société doit aujourd’hui faire face à deux enjeux. Le premier est économique et traité partout dans l’espace public, c’est ce que j’ai décidé d’appeler la « torpeur économique ». Le mot « crise » est trop usité, trop dévoyé. La réalité, c’est que nous ne connaissons pas une crise économique puisque les voyants sont tous au vert : euro faible, pétrole peu cher, retour de la croissance, taux d’intérêt au plus bas. Le monde entier voit son activité repartir. Malgré tout, le chômage continue d’augmenter inlassablement. C’est donc bien une torpeur économique. La torpeur peut paraître légère pour qualifier ces millions de chômeurs mais elle définit en fait bien plus qu’un simple engourdissement passager, c’est une diminution des fonctions d’attention vitales. Quand la torpeur s’installe, le sommeil devient bien vite éternel et l’engourdissement nous endort pour mieux nous étouffer. Je ne traiterai pas ici de la réponse à apporter à la torpeur économique, je traiterai du deuxième enjeu. Ce second enjeu est oublié dans la presse car vite assimilé à une déviance nationaliste alors qu’il mériterait d’être précisé, conceptualisé et étudié. Il est ce qui est caché derrière le mal-être français. J’ai appelé cela la « désolation de soi ». Le sens premier de ce mot vise un paysage. Un lieu sans vie, un lieu sans joie, un désert. Le désert n’a pas d’eau, pas de verdure, mais il affronte des tempêtes et paraît toujours sans limite, sans frontière, l’horizon n’a jamais de fin derrière les dunes de sable qui se succèdent. La seule compagnie que l’on parvient à trouver, c’est celle du mirage qui nous promet un monde meilleur. Je préciserai plus après ces images que je sollicite en premier. La désolation de soi ne doit pas être comprise uniquement à travers les prismes posés par le Front National : je ne sollicite pas ici un ultime débat sur l’identité nationale afin de mieux montrer du doigt l’immigration et — plus largement — les musulmans. Comprendre la désolation de soi et le problème identitaire français, ce n’est pas juste s’arrêter à la question nationale et la fragmenter pour mieux nourrir les fantasmes. Qu’est-ce qu’être soi ? Comment se structure l’identité ? Peut-être faut-il aller plus loin dans un premier temps. Les sociologues ont compris que l’identité de l’individu subit plusieurs socialisations pour permettre au multiple d’être un. On peut dénombrer trois socialibilisations différentes : la socialisation familiale, la socialisation sociale, la socialisation nationale. Chacune s’englobe dans un noyau toujours plus grand. La famille est la première couche. Le milieu social est la deuxième et va jusqu’aux relations avec les autres, avec son entourage. Le milieu national est le dernier noyau. Chacune de ces couches nourrit la relation de soi avec les autres. Les relations avec sa famille, avec ses amis et ses connaissances et enfin, avec cet inconnu que je croise dans la rue. Ce qui génère une dynamique identitaire chez l’individu, c’est la manière avec laquelle ces trois couches communiquent et sont définies. Si elles sont clairement posées par des cadres spécifiques, alors elles peuvent interagir et créer ce qu’Alain Juppé a bien vite appelé une « identité heureuse ». Mais cette identité heureuse demande également un effort certain : il faut pouvoir franchir ces frontières clairement posées pour mieux en sortir et se rapprocher de ceux qui vivent en dehors de chacun des cercles. Nous comprenons donc que pour parvenir à avoir une identité stable, il doit exister trois contenus définis par trois frontières. La première frontière permet de dire ce qui distingue le « mien » du « tien », la deuxième permet de comprendre la différence entre le « eux » et « nous » et la dernière permet de savoir qui est le « barbare » dans son sens premier. Mon discours peut paraître étrange. En effet, la mondialisation a largement fait comprendre que le mot de « frontière » était à bannir, qu’elles avaient explosé, et que désormais, poser des frontières, c’était aller contre le progrès, c’était aimer la guerre. Il est vrai que les flux économiques et financiers se moquent bien des frontières. Mais il n’en est pas la même chose pour l’identité. La réalité aujourd’hui est qu’une partie de la population française ne possède plus sa propre identité qui n’est que désolation : un désert sans verdure. Seuls les mirages lui expliquent qui elle est. Du concept de frontière... Le mot de frontière a donc été banni. Il était une fermeture à l’autre, un reste du XXe siècle, le présage de guerres, un souvenir de l’horreur du combat pour l’Alsace-Moselle ou du IIIe Reich. Il a bien vite été caricaturé. La fin de la frontière a tué deux mots : l’Hospitalité et la concorde. L’Hospitalité a longtemps été un idéal dans une société. Elle est, selon Claude Raffestin, un « rite qui autorise la transgression des limites ». Autrement dit, pour bien accueillir, pour réellement s’ouvrir à l’altérité la plus totale, pour être réellement dans l’ouverture et le don de soi, il faut qu’il existe une frontière. Sans frontière, il n’y a plus d’Hospitalité puisque tout le monde est chez soi partout. Cela signifie que la relation avec autrui perd toute son importance et toute sa vigueur. Pour le dire clairement, sans frontière, il n’y a pas de communauté ouverte. Il n’y a que la désolation du désert sans horizon. Il est des cas où l’on consent à la présence de l’Autre tout en la refusant, où, sous prétexte de ne pas pouvoir faire autrement, l’Autre est accueilli sans être accepté. Parce que la règle de l’Hospitalité n’est ni définie, ni pensée dans nos sociétés. Ces cas, ce sont ceux où les hôtes s’installent en lisière du territoire, hors de la sociabilité nationale pour finir ghettoïsés. C’est une Hospitalité qui sert de quarantaine. Il en faut alors peu pour que ces hôtes mal-acceptés finissent par devenir des boucs-émissaires ou se radicalisent eux-mêmes contre ceux qui les ont acceptés mais qui prétexteront alors d’être déjà bien aimables de les avoir accueillis. L’étranger que j’accueille volontiers est entre l’ami et l’ennemi, celui que j’accueille malgré moi est un ennemi en puissance. Je ne sais s’il restera à mes côtés, je ne sais s’il vient me changer, je ne sais s’il ne vient pas m’égorger. Petit à petit, je l’animalise, je l’exclus hors de l’Humanité, il devient un ours qui transmet les maladies. Il devient le nomade que j’exècre. Notre promiscuité est un perpétuel effort de ne pas communiquer, de ne surtout rien se dire, ni ne rien avoir à se dire. C’est Jean Valjean dansLes Misérables qui trahit l’évêque qui l’avait accueilli en lui dérobant ses chandeliers. Sans frontière, il n’y a pas d’Hospitalité et sans Hospitalité, il n’y a pas de vivre ensemble sûr de lui-même. La beauté de la frontière, c’est lorsque l’on autorise l’autre à la franchir. C’est alors accepter pleinement son altérité et ce qui le fait autre. Reparler aujourd’hui de frontières, au fond, c’est revenir à la tolérance. Un mot banni donc mais dont la réalité se fait toujours davantage comprendre. La frontière aujourd’hui n’existe plus pour définir nos identités familiales, nos identités sociales et nos identités nationales. La famille ne fait plus grand sens aujourd’hui puisque sa conception est en pleine recomposition. La mort du PCF a contribué à la disparition de l’identité sociale dans le corps populaire et à la mort du tissu associatif caractéristique de l’engagement citoyen. Il restait une dernière frontière : celle qui enfermait le populaire dans son espace ghettoïsé, créant ainsi une sociabilité forcée. Mais les relations ont changé : les habitants de ces tours les quittent en courant, rêvant du pavillon résidentiel qui les coupera à tout jamais des autres. Plus aucun lien n’existe à présent. L’identité nationale avait deux fonctions auparavant : extraire l’individu de ses deux premières identités et en définir une nouvelle par rapport au « barbare ». Elle répondait à deux questions : pourquoi suis-je le même que cet inconnu dans la rue ? Et pourquoi suis-je différent de celui qui vit dans tel autre pays ? Pour définir cette nouvelle frontière, il existait deux moyens. La conscription, cette école de la vie. Et l’instruction publique, cette école de l’esprit. Le premier n’existe plus. Qu’ai-je à voir avec cet individu que je ne connais pas, qui ne s’habille pas comme moi, qui n’a pas la même histoire que moi ? Pourquoi vivrais-je avec lui ? Auparavant, la réponse était subtile mais comprise par tous : les deux se trouvaient dans la boue à faire des pompes devant un drapeau français. Le deuxième moyen, l’école républicaine, se fourvoie. Il était ce symbole des Lumières qui met l’individu hors de lui-même pour le mettre en relation avec une histoire commune et uniforme. Le problème de la construction identitaire: Aujourd’hui, la construction identitaire n’est plus une composition de blocs qui acceptent de voir leur frontière dépassée par plus grand qu’eux. C’est un ensemble de flux déstructurés et déstructurants qui génèrent une identité, au mieux malléable, au pire, inexistante. Mon identité est claire si je me sais héritier de 1789, si je connais les valeurs que m’a véhiculées la Révolution sans oublier ce que je dois aussi à la monarchie et à ceux qui ont vécu avant que la tête du Roi ne fût coupée. Si, tout simplement, mon roman national est le même que mon voisin, si je le maîtrise suffisamment pour en connaître les rouages, les rebondissements, les noirceurs, parfois ; bref, si je peux le commenter avec ma sensibilité. Aujourd’hui, qui lit le même roman ? Certains ne lisent pas même un roman mais un tweet en quelques caractères. D’autres écrivent par-dessus, arrachent des pages et les avalent aussitôt. Pour certains, leur Histoire n’est faite que de massacres, cela permet de mieux s’en exclure. Pour des jeunes français aux origines immigrées, l’histoire, c’est ce que leurs communautés familiale et sociales racontent. Le souvenir d’un grand-père torturé, d’une famille déplacée, du mépris du Blanc. Le souvenir familial, qu’il est normal de cultiver, n’engage pas l’Education Nationale. Et pourtant, elle cède. Sous prétexte d’intéresser les élèves à l’Histoire, on ne leur parle dans les programmes que de ce qui ne va pas contre ces souvenirs protégés et transmis. Mais pourquoi alors aimer la France ? Pourquoi ce jeune français qui entend dans son foyer familial comment les siens furent chassés d’un « chez-lui » fantasmé (« le bled ») aimerait la France ? Que lui-a-t-elle apporté, à lui, la France ? Quand il y réfléchit, face à un père rendu malade de l’amiante avalée, il ne voit que de la souffrance, il ne voit que de l’exploitation. Une forme de servage qui se tait. Et les Lumières alors, crierait le brave hussard noir trop longtemps assis ? Parle-t-on bien de ces mêmes Lumières ? Celles qui ont justifié que l’on rentrât dans Alger les armes à la main ? Pour un peu qu’il contacte alors son identité sociale en morceaux, il ne sait qu’une seule chose : il vit au milieu des tours en béton, ces tours qu’il méprise, le ghetto. Il y a trente ans, le milieu social définissait un « eux » contre un « nous ». On attaquait le « eux » mais jamais le « nous ». Aujourd’hui, certains jeunes des banlieues populaires mettent le feu à leurs poubelles, à leurs voitures et taguent leurs murs. Il n’y a plus de « nous » au sein de l’espace social, il n’y a que cet immense désert que l’on vandalise. Quant à l’histoire commune, on espère qu’ils l’apprendront sur wikipedia. Ou dans un Mooc. Ou pas du tout. Arrive alors le moment du mirage au milieu de cette désolation. Car l’individu doit bien répondre à la question suivante : « qui suis-je ? ». Une famille déstructurée vivant une histoire douloureuse et mouvementée, un tissu social sans sens et sans histoire, ne vivant plus au rythme de la grande aventure ouvrière, une identité nationale qui paraît être devenue la maladie du greffon contre l’autre… Le mirage, c’est l’identité de façade. Dans les banlieues, le mirage est double : il offre une nationalité fantasmée, un eldorado, une terre d’accueil féconde pour la lutte, la Palestine. L’autre refuge repose sur les dernières formes de communautés qui persévèrent dans cette désolation sociale : la religion ou le gang. Voire les deux dans les cas que la presse ressasse. La religion est surtout musulmane parce que l’Islam offre une identité neuve. Déjà, parce qu’elle est victime de ségrégation, la communauté musulmane a renforcé son entre-soi : être musulman, c’est se retrouver « entre nous » dans des lieux et des fêtes privilégiés : la Mosquée et le ramadan, instruments de définition de soi. Être soi devient alors palpable. De plus, la conversion promet de devenir radicalement différent. Se convertir à l’Islam, lorsque la préoccupation principale n’est pas celle du transcendant, plus que trouver une nouvelle famille, c’est changer de prénom. C’est ne plus être le même. C’est aussi adopter une forme de costume, de déguisement : port de la djellaba, port de la barbe, la femme devient voilée. Quel rapport entre ce qu’était le converti et qui il est aujourd’hui ? Il devient le combattant de la Palestine avec sa nouvelle identité. Une identité simple avec une histoire simple : un triptyque esclavage-colonisation-décolonisation auquel on ajoute un antisionisme. Ce converti refuse de voir l’Islam comme un avant-gardisme. Il refuse de comprendre que l’Islam est une quête spirituelle et que la djellaba, la barbe et le voile ne sont pas ce qui parvient à définir la totalité de cette grande religion. Il se moque bien de la foi, ce qu’il aime, c’est son nouveau prénom, ses nouveaux habits et ses nouvelles habitudes. Il s’appelle différemment, il mange différemment. Voilà le mirage qui vient répondre à la désolation. Le problème est grave : Il n’y a rien de pire que de vivre dans le mythe idéalisé, à travers le prisme d’une histoire d’un autre, de celle d’une autre nation. C’est parce que les Allemands n’avaient pas eu leur propre Renaissance qu’ils sont allés chercher leur histoire dans le Dionysos obscur d’Athènes. C’est là-bas qu’ils ont trouvé le nazisme : dans la désolation de soi. Même la citoyenneté ne parvient à créer du lien. Quelle est cette citoyenneté qui n’offre pour seul avantage qu’un droit de vote si désavoué, alors même qu’une partie de la population française ne connaît pas même le nom de cinq hommes politiques ou confond Jacques Chirac et Lionel Jospin ? La citoyenneté française est symbolisée par la Semeuse, cette Marianne qui sème la terre française. C’est la réunion entre les principes universels qui font la France et son aspect aussi très concret, ancré dans ses frontières et ses limites. Mais qu’est-ce que la Nation si elle n’a rien de concret ? La citoyenneté à Athènes est définie tant par les droits politiques que le partage de la terre : la terre appartient pleinement aux citoyens qui exercent un droit foncier sur elle tandis que les étrangers ne peuvent détenir les propriétés d’Athènes. Quel sens donner à cette citoyenneté quand les appartements des Champs-Elysées appartiennent tous à de riches russes, américains ou habitants du Golfe ? Comment s’étonner de la désolation ? Une torpeur économique, une désolation de soi : la France est marquée par un assèchement, un trouble profond qui l’endort. Elle pousse le français à vivre dans un univers jamais clos mais jamais défini, dans lequel il se perd sans parvenir à répondre à cette question fondamentale de la vie humaine : « qui suis-je ? ». Comment lui reprocher alors de sortir du chemin tracé et de se perdre à la vue du mirage et au son des sirènes ? « Il me venait à l’esprit ces images peintes pour vous ». Loïs Henry |
AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives
Juin 2017
Catégories
Tout
|
|
L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].
Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |


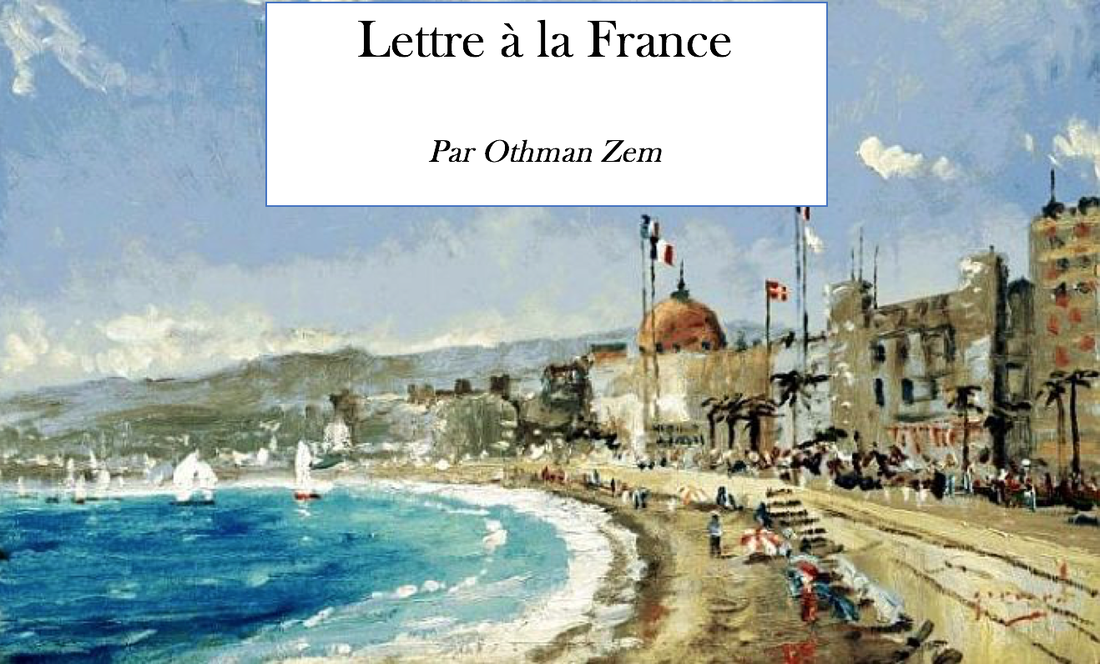






 Flux RSS
Flux RSS