|
Crédit photo: Serge Hambourg
Nous avons grandi dans une impasse. Cernés d’un réseau de petites phrases anxiogènes qui s’aggloméraient comme des narcotiques dans nos cerveaux en formation. Enfants, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente: pas un jour sans qu’on entende à la radio des nouvelles de ces deux sœurs morbides, Mme Dette et Mme Crise, dont les ombres dans nos têtes enflaient sans cesse. Finiraient-elles par exploser? Non: c’est le chômage, le trou de la Sécu et son acolyte de la couche d’ozone qui s’en chargeaient. Les tours aussi, le 11 Septembre de nos 11 ans. Dans nos têtes d’enfants saturées de ces traumatismes subliminaux, l’idée de l’Apocalypse naissait au début des années 2000. Nous n'avions pas 20 ans: nous arrivions trop tard Au lycée, on nous avertit d’emblée que l’Histoire était finie. On nous expliqua que Dieu, le Roman et la Peinture étaient morts. Sur les murs de la capitale, on nous apprit que l’Amour l’était aussi. Nous n’en connaissions pas le visage que déjà, nous n’avions plus le droit d’y croire. Notre adolescence a passé comme ça, sans que jamais rien ne se passe. A l’université, nous nous découvrions «postmodernes» - dans les livres de Gilles Lipovetsky, d’Alain Finkielkraut, de Marcel Gauchet. La formule, ailleurs, revenait souvent, recouvrant indistinctement tout ce qu’il y avait de contemporain: on l’accompagnait généralement d’un sourire sarcastique, que nous imitions sans tout à fait le comprendre. On nous inculquait ce schéma ternaire «prémoderne, moderne, postmoderne», grille de lecture ou tenaille qu’on nous présentait comme neutre quand, insidieusement, celle-là avait déjà décidé pour nous qu’il n’y avait plus rien à faire. On était déjà à l’épilogue du récit mondial de l’humanité. L’hypothèse communiste? Un délire de pyromanes. Mai 1968? Une bataille de boules de neige. L’idéal du progrès ? On avait vu Hiroshima. Les utopies avaient toutes été ridiculisées, la poésie rendue barbare après Auschwitz, les rêves, n’en parlons pas. Nos ambitions se réduisaient au quart d’heure de gloire warholien, un éphémère, et puis s’en va. Avec les autres époques, nous avions le sentiment de ne plus tenir la comparaison. Français, nous étions saturés de rêves de gloire en même temps que divorcés de l’Histoire - comme affligés d’un complexe d’infériorité à son égard. Toujours, et sans que nous n’ayons décidé quoi que ce soit, nous nous situions après, une génération de retardataires qui se sentaient tout petits en face des statues de pierre. Nous n’avions pas 20 ans: nous arrivions trop tard. Alors que faire? Mourir, éventuellement. En restant vivant si possible. Devenir un spectre de soi-même avec l’ennui et l’orgueil comme seuls moteurs, prenant comme modèles des anti-héros mégalomanes : Michel Houellebecq («souvenez-vous-en : fondamentalement, vous êtes déjà mort»), Yves Adrien (l’auteur, virtuellement mort en 2001, de F. pour fantomisation) ou Frédéric Beigbeder («Je suis un homme mort. Je me réveille chaque matin avec une insoutenable envie de dormir»). A nouveau que faire ? Une autre issue: regretter. Avec Muray, Dantec et les autres, pester contre l’homo festivus. Le jour fustiger les Bisounours, puis la nuit, pudiquement, rêver aux chevaleries d’avant. A l’extrême rigueur, enfin, agir à l’extrême. Devenir une bombe, prôner la haine de l’autre, exercer la terreur; à défaut de savoir comment s’y comporter, travailler à l’extermination du monde tel qu’il est. Une nouvelle triade de la résignation: celui qui disparaît, celui qui regrette, celui qui tue. Pour les autres, il reste l’oubli: la consolation des objets, l’anesthésie par les loisirs. De toutes ces figures possibles, nous ne nous reconnaissons dans aucune. Alors, à nouveau, que faire? La réponse est simple: renaître, comme il nous plaira. Nous sommes comme les personnages de la pièce de Shakespeare fuyant désormais un modèle de société qui nous a déjà bannis. Etant tout sauf désabusés, nous n’avons plus d’autre choix que celui d’inventer une nouvelle voie. La place est déjà prise? Trop prisée? Nous irons ailleurs, explorer. Sur les ruines des Trente Glorieuses, certains d’entre-nous au-dessous du seuil de pauvreté, nous ferons très exactement ce que nous voulons. Tant pis pour le confort, tant pis pour la sécurité, et tant pis si nous ne sommes plus capables d’expliquer à nos parents ce que nous faisons de nos journées. Nous sommes soutenus par l’amour que nous nous portons. On nous l’a de toutes manières assez répété: il n’y a plus d’issue. Dont acte. Indépendants, multitâches et bricoleurs A distance d’un théâtre politique dont on ne comprend plus la langue, nous aspirons à l’émancipation, quitte à consentir à une certaine précarité. Le système D s’ouvre, comme une alternative possible au salariat. Nos petites entreprises côtoient, et à nos yeux égalent, les grandes institutions. Dans les marges et grâce à Internet, nous explorons les micro-économies souples. Les intermédiaires sont court-circuités. Nous produisons et distribuons notre propre miel. Plus rien n’est entre nous et la musique: l’énergie et la foi suffisent pour la créer, un ordinateur pour la mixer et la distribuer tout autour du monde. Nous sommes cosmopolites mais pratiquons le local: dans des sphères restreintes et de fait habitables, nous façonnons des objets qui nous ressemblent, puis nous les partageons. Dans nos potagers numériques, nous cultivons les liens, IRL comme URL, échangeant nos enthousiasmes, nos connaissances et les nuances de nos vies intérieures. Partout, nous nous réapproprions nos heures. Par la conversation, nous prenons le temps d’inventer des mots nouveaux pour désigner des choses nouvelles. Nous sommes indépendants, multitâches et bricoleurs. Conscients de notre chance comme de l’effort à fournir, nous refusons le cynisme et la plainte. S’il faut manger des pâtes, nous les mangeons sans rechigner. S’il faut sacrifier les vacances, nous l’acceptons. Nous échangeons nos vêtements, nos logements, nos idées. Sans faire de bruit, une révolution discrète, locale et qui ne cherche à convaincre personne a déjà eu lieu. Nous acceptons désormais d’être sans statut, retirés dans les marges joyeuses, par nécessité comme par choix. L’avenir est pour nous dans les friches. C’est dans les terrains encore vagues qu’adviendra une nouvelle renaissance. Nous ne réclamons ni n’attendons plus rien de la société telle qu’elle va: nous faisons. Par-dessus tout, et fragilement. Parvenu à un certain degré, le désespoir devient une panacée. Puisque tout est fini, alors tout est permis. Nous sommes après la mort, et une certaine folie s’empare de nous. Pareils à des ballons déjà partis trop haut, nous ne pouvons plus redescendre: dans un ciel sans repères, nous cherchons les nouvelles couleurs. Le monde est une pâte à modeler, pas cette masse inerte et triste pour laquelle il passe. Des futurs multicolores nous attendent. N’ayez pas peur, il n’y a plus rien à perdre. Par le collectif Catastrophe Article originellement publié dans Libération: http://www.liberation.fr/debats/2016/09/22/puisque-tout-est-fini-alors-tout-est-permis_1506625
0 Commentaires
"Et sinon, pourquoi ne voulez-vous pas travailler dans le luxe ?" Je ne sais pas, mais c’est une bonne question. Peut-être, parce que sur mon CV ne figure aucune expérience dans le luxe. Peut-être que cela a à voir avec le fait que j’ai intégré la meilleure école de commerce de France, et pas la meilleure école de mode. Ou encore, peut-être bien que c’est parce qu’on est en plein entretien pour un stage en finance, que sur mon CV ne figurent que des expériences en finance et que je n’ai jamais parlé de luxe. Pas à un seul moment de l’entretien qui dure depuis maintenant une heure. Que le seul lien entre moi et le luxe est qu’en bas de mon CV est inscrit que je faisais partie de l’association de mode à HEC, comme trois autres activités extracurriculaires qui elles n’intéressent mon interviewer. Et que cet élément n’est pas là pour mettre en valeur que j’aime lire Vogue à mes heures perdues, mais que j’ai levé des fonds et trouvé des sponsors pour organiser un événement, aptitude qui peut faire sa différence quant à ma candidature. Si tenté soit-il que l’on ne fasse pas de raccourci stupide. Je ne suis pas féministe, mais je commence à être agacée. Je me sens obligée de m’en expliquer parce qu’il est de plus en plus difficile de parler des problèmes liés au genre, surtout quand on est une femme, et ce parce que le raccourci entre femme et féministe est rapide. Et alors, me direz-vous ? Ces dernières années le féminisme a pris une connotation péjorative – comme si défendre la cause des femmes faisait de celles qui le font des personnes virulentes dans le meilleur des cas et hystériques ou folles dans le pire. Je n’ai rien contre les féministes, mais je n’ai pas la prétention d’en être une. Je ne suis pas féministe. J’aime la différence fondamentale que l’on fait entre les hommes et les femmes. J’aime la galanterie, j’aime qu’on me tienne la porte, j’aime l’idée selon laquelle un garçon doit traiter une femme avec respect, justement parce que c’est une femme. Je ne suis pas féministe. Mais je suis convaincue que je me suis toujours battue autant, voire plus, que mes amis garçons pour arriver là où j’en suis aujourd’hui. Je ne suis pas féministe. Pas du tout féministe. Mais je suis exaspérée à un point inimaginable par les comportements qui me réduisent à mon genre. Cette question m’est posée à un entretien sur deux. Je garde le sourire, et j’explique que ce n’est tout simplement pas ce que je veux faire. Que ce n’est pas ce pour quoi je postule. Qu’un centre d’intérêt peut être un hobbie sans être la ligne directrice d’une carrière. Mais à chaque fois, je ne peux m’empêcher de me dire, dans ma tête, « et si c’était un garçon à ma place, et qu’il avait mentionné faire partie du club de foot à HEC, lui demanderiez-vous pourquoi il ne veut pas devenir footballer ? ». Poursuivons l’entretien. Arrive enfin le moment tant attendu des questions techniques. Je les connais toutes, j’y réponds. L’interviewer a l’air content, il enchaine sur un cas pratique. Donc tu prends par exemple une entreprise qui fait… Moment d’hésitation de sa part : pourquoi pas des composants chimiques, comme la dernière entreprise dans laquelle l’entreprise pour laquelle je postule a investi ? du maquillage … Et disons qu’elle commande à son fournisseur, je ne sais pas, de la poudre… La question prend par la suite la tournure d’une question de finance, et j’y réponds. Néanmoins je ne peux m’empêcher de relever, parce que je trouve ça triste qu’en 2016, on pense systématiquement luxe et maquillage lorsque l’on s’adresse à une candidate et non à un candidat. Je trouve ça dommage qu’à mon stage précédent, dans une banque de renommée internationale, sur un étage de 50 personnes, seules deux aient été des femmes. Et qu’il y soit donc normal, de faire des blagues – d’un gout discutable – sur les femmes sans se gêner. Ou qu’on m’envoie des mails avec une pièce jointe et un : « Tu m’imprimes ça ma jolie ? » Je trouve ça dommage pour la société, que lors de mes 15 derniers entretiens en fonds d’investissements, je n’ai rencontré qu’une seule femme, en dehors des assistantes. Et qu’un interviewer ait pourtant osé me dire que « être une femme peut être un avantage dans ce métier ». Alors qu’historiquement, ils n’en ont jamais engagé aucune dans le fond pour lequel il travaille. Une inégalité qui a souvent été une norme L’inégalité homme-femme, vaste sujet, mais surtout vieux sujet. L’origine de cette inégalité est ancrée dans notre culture et elle est à la fois historique, religieuse et culturelle. En effet, les cultures judéo-chrétiennes, la bible, la Grèce ancienne, et les civilisations arabo-musulmanes ont une vision différente et inégalitaire en ce qui concerne l’homme et la femme. Pour exemple, la Grèce antique voit de fait la femme comme en charge de l’intérieur de la maison (donc principalement des enfants et des travaux ménagers) tandis que l’homme lui, sort et va faire de la politique, la guerre, etc. Il est, lui, en charge de l’extérieur. Dans la bible, la femme est là encore dépeinte comme née de la côte de l’homme, en second : Dieu créa d’abord l’homme, puis la femme. Et elle devient très vite, avec la chute, source des malheurs des hommes. Cette culture de l’inégalité des genres a trouvé un parallèle dans la culture juridique où les textes codifient la dépendance de la femme à l’homme. Pour ne citer qu’un exemple, le Code Napoléon de 1804 définit clairement la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124: “Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.”. La France est le pays des droits de l’homme dès 1789, mais ne deviendra que bien plus tard un pays des droits de la femme et on constate que la transition vers les systèmes démocratiques n’a jamais donné lieu à un droit de vote mixte de prime abord. Aucun pays n’accordera en même temps aux hommes et aux femmes le droit de voter. Des incompréhensions : Once you are in, it does not necessarily get better. Les sociétés occidentales se battent certes pour une égalité homme-femme complète et multiplient les lois pour aller dans ce sens. Même si c’est positif, c’est triste en un sens qu’on en arrive à parler de quotas. Je m’adresse à nos lecteurs masculins, auriez-vous envie d’être un quota ? Si je conçois que soulever le problème et en parler nécessite de la part des hommes un effort de transposition, je trouve que cet effort n’est pas assez effectué ; qu’il est plus facile quelques fois pour les uns de s’identifier à des gens à l’autre bout du monde, vivant dans des sociétés complètement différentes, avec des problèmes auxquels ils ne seraient jamais confrontés, qu’à leurs homologues féminins. Quel meilleur exemple que l’art et les médias ? Prenons n’importe quel(le) livre, film, série : que le personnage éponyme, que l’interprète ou que l’héroïne soit une femme, d’emblée – et qu’importe le contexte – cela devient un livre, un film ou une série de filles. La réciproque n’est pas pour autant vraie. Ce phénomène est assez parlant et montre qu’il est difficile pour un homme de s’identifier à une femme en général. Ce qui mène à une moindre reconnaissance des talents féminins, en témoigne le scandale d’Angoulême de l’an passé. De cela découle un sentiment d’incompréhension lorsque l’on parle de sexisme à un homme, qui a certes pas toujours, mais néanmoins trop souvent tendance à amoindrir les choses. Il faut se rendre à l’évidence, les hommes ont souvent du mal à comprendre le sentiment de malaise que peut ressentir une femme qui se fait aborder dans la rue si elle n’a pas de raison de se sentir en insécurité. On admet volontiers que les femmes sont des cibles plus vulnérables aux agressions, mais on a plus de mal à reconnaitre que le harcèlement de rue est un problème réel. Un commentaire sexiste est souvent entendu par l’autre genre comme un compliment, une remarque flatteuse, alors qu’elle est souvent vécue comme une intrusion, comme une tentative de proximité indue. Donc oui, en soit, ce n’est pas la mer à boire. Je devrais peut-être m’estimer heureuse qu’on m’appelle ma jolie et pas mon hideuse au travail. Mais pourquoi est-ce qu’on me parle de mon apparence à moi et pas à mes collègues ? Pourquoi est-ce que quand un collègue fait une slide qui ne convient pas, on lui demande de la refaire, point, alors que quand il s’agit d’une des miennes, on m’explique qu’elle fait trop « Barbie » (bien qu’elle respecte la charte graphique de la banque) ? Pourquoi est-ce que je devrais supporter de me faire draguer sur mon lieu de travail par un supérieur marié et père de famille alors que mes collègues ne connaitront jamais cette gêne ? Ce n’est pas si grave, mais ces comportements sont ancrés dans les mœurs et continuent à contribuer au fait qu’il reste difficile, quand bien même on fait passer des lois, et quand bien même on pense à imposer des quotas, pour une femme de se sentir égale à un homme sur son lieu de travail. Aime le connard mais méprise la salope - ce n’est pas que de la faute des hommes
De mon point de vue, le problème est indéniablement un problème de société. Je le pense dû à un décalage certain entre l’évolution des mœurs, des lois, et des mentalités. Et cela n’est pas propre aux hommes. J’ai vu autant de femmes que d’hommes choquées de me savoir en finance dans des postes à hautes responsabilités et aux horaires impossibles, du fait de ma condition féminine. Les autres femmes sont premières sur le discours moralisateur du « mais quand même, tu as pensé un peu à ta future vie de famille ? Pour un homme ok, mais toi tu vas être maman un jour, comment tu crois que tu vas te débrouiller ? ». Et, si je ne me suis pas souvent faite accoster par des femmes dans la rue, j’ai néanmoins trop souvent entendu des femmes critiquer les tenues des unes et des autres, insulter les filles qui s’affichent comme ayant des « mœurs légères » tandis que les mêmes instigatrice de ces critiques tombent dans les bras du premier venu qui ait le même genre de comportement. Deux poids, deux mesures, disent-elles ? Il faut l’admettre, nous sommes les premières à nous freiner dans notre ascension vers le succès. C’est ancré en nous, le contexte a transféré, et nous ne nous considérons pas pleinement comme ayant droit à autant de liberté, pour ne parler que de ça, que les hommes. Aime le connard mais méprise la salope, c’est un peu le leitmotiv des femmes en 2016, qu’elles l’admettent ou non. Si la prépondérance des réseaux sociaux permet et mène de plus en plus de femmes à publier des clichés d’elles de plus en plus dénudées, ce n’est que pour affirmer une liberté qu’elles sentent trop fragile. Comparons. Qui serait choqué de voir un homme torse nu sur Instagram ? Pas grand monde. Mais pourquoi n’a-t-on alors pas de déferlement de photos d’hommes dénudés du haut sur les réseaux sociaux ? Ils n’en ressentent tout simplement pas le besoin. Ils ont le droit, pas nous. Si nous nous sentions pleinement en droit de faire ce que l’on veut de notre corps, alors pourquoi nous appellerions-nous les unes les autres si facilement des filles faciles ? La rivalité purement féminine pour plaire aux hommes n’est-elle finalement pas l’expression d’une rivalité aux hommes pour obtenir autant de liberté qu’eux ? Je pense que finalement, on ne se bat jamais pour l’attention des garçons, mais bien pour se prouver qu’on a autant de liberté qu’eux et finalement être leur égal. Il est toutefois malheureux que cela nous pousse à se juger les unes les autres. La morale de cet article J’ai eu beaucoup de mal à trouver la suite de cet article, parce que je lui cherchais une sorte de morale. Comme si en écrivant je voulais répondre à la question qui aurait été ma problématique idéale : du coup, on fait quoi ? Je ne pense pas qu’il y ait de solution, seul le temps fera les choses, il faut simplement que les mentalités s’adaptent aux mœurs et aux lois. Et c’est un processus qui met du temps et qui progresse un peu plus chaque jour. Les comportements normaux d’hier sont anormaux aujourd’hui, et les inégalités d’aujourd’hui seront illégales demain. J’aurais aimé voir cet article écrit par un homme, mais comme je l’expliquais plus haut, mon ressenti est qu’il est assez improbable de voir un homme se lever pour défendre la cause des femmes - en tout cas je demande à mes lecteurs un petit effort de transposition. Je l’ai dit plus haut, je ne suis pas féministe. Je n’ai pas le sentiment de me croire représentative ou défenseuse de la cause de toutes les femmes, je partage juste un ressenti. Je ne parle au nom de personne, mais je parle à tous, donc si des choses vous interpellent, l’équipe de l’objectif serait heureuse de voir éclore un débat ! Une jeune femme moderne.
C’est un jour pesant à New York, il fait lourd et c’est le cœur serré que se réveillent les habitants de la grande pomme quinze ans après les attentats du World Trade Center. Officiels, rescapés et proches de victimes sont réunis devant le mémorial érigé en l’honneur de ceux qui sont devenus les martyrs de l’Amérique. Soudain une silhouette s’effondre, à côté du maire de la ville, la candidate démocrate et favorite des sondages Hilary Clinton est prise d’un malaise. Prétextant l’émotion, ses communicants seront forcés d’avouer qu’elle est en réalité atteinte d’une pneumonie.
Tout au long de la cérémonie on pouvait apercevoir au loin une tour scintillante, reflétant les rayons du soleil, c’est la Trump Tower. Le destin aussi semble rayonner pour son propriétaire, ce gnostique qui affirme à demi-mots qu’il a été choisi par Dieu. Alors que l’écart avec sa rivale démocrate se resserre de semaines en semaines, ce coup de théâtre devrait faciliter encore un peu son ascension vers la Maison Blanche. Nombreux sont les commentateurs de la vie politique Américaine à rejeter l’élection de Trump dans l’irréel en pointant du doigt son irrationalité. Pourtant l’histoire a montré à bien des occasions que le réel pouvait être fort accommodant avec l’irrationnel. En fait, le scénario d’un Donald Trump à la Maison Blanche est tout à fait possible et même probable. N’oublions pas que jusqu’en septembre 1982, Reagan était largement moqué par la presse qui affirmait qu’il ne serait jamais élu, Georges Bush avait même qualifié le programme économique de son rival républicain « d’économie vaudou ».
De qui Trump est-il l’héritier ?
Donald Trump est loin d’être un phénomène ex-nihilo, il est l’incarnation d’une pensée populiste qui a toujours existé outre-Atlantique et que l’on a trop souvent voulu minorer. Si l’on ne comprend pas cet héritage on ne peut comprendre comment des républicains modérés et rationnels ont pu être dépassés par un candidat milliardaire qui prétend être celui qui « porte la parole de ceux que l’on entend pas ». Comme tous les populistes qui prospèrent aujourd’hui en faisant fructifier leur porte-monnaie électoral sur les débris encore fumants laissés par la crise, Donald Trump doit être pris au sérieux. Mais qualifier celui-ci de populiste n’est pas suffisant, il est indispensable d’abord de définir ce que signifie ce terme aujourd’hui devenu générique de populisme. Daniele Albertazzi et Duncan McDonnell dans le populisme au XXIème siècle le définissent comme une idéologie qui « oppose un peuple vertueux et homogène à un ensemble d'élites et autres groupes d'intérêts particuliers de la société, accusés de priver (ou tenter de priver) le peuple souverain de ses droits, de ses biens, de son identité, et de sa liberté d'expression ». On se trouve bien ici au cœur du problème, Trump alors qu’il est l’incarnation d’une partie de ces élites martèle à qui veut l’entendre qu’il va détruire celles-ci et rétablir le pouvoir des « vrais gens » à Washington. Il promet ainsi une option encore jamais essayée, celle de faire de la politique autrement sans organe intermédiaire. Cette ambition qui peut paraitre attractive pour une certaine partie de la population est en réalité néfaste et menace directement l’Etat de droit. En prétendant se débarrasser des élites en supprimant les corps intermédiaires comme les assemblée élues ou les administration -bref tout ce qui a permis de conserver une certaine concorde au sein de nos sociétés- on ouvre la porte au gouvernement des instincts, à la haine voir à la guerre civile. Trump utilise aussi largement le sentiment d’abandon de certaines franges de la population qui ne se sentent pas représentées alors qu’elles le sont de fait par les mécanismes électoraux. Cette rhétorique, c’est celle qui a fait prospérer McCarthy au début des années 50. Chez les deux hommes, la dimension psychologique occupe une place capitale, l’extravagance et l’usage de l’exagération comme outil rhétorique les rapproche en effet énormément. On prête d’ailleurs à McCarthy la fameuse phrase « plus c’est gros plus ça passe », l’adage Trumpiste par excellence.
Donald Trump est-il un conservateur ?
Il est courant d’utiliser la notion de malaise ou d’insécurité culturelle pour expliquer le succès électoral des conservateurs mais cette analyse est largement incomplète. Elle se base en fait sur des arguments psychologiques dépassés qui ont été utilisés pour tenter d’expliquer le nazisme (notamment chez Adorno). « La contestation des maccartistes doit être en toute précision nommée pseudo- conservatrice. Je prendrai ici le sens de conservateur à Adorno, car ses partisans quoi qu’ils utilisent la rhétorique du conservatisme et se disent eux mêmes conservateurs montrent une résistance constante et sérieuse quant au mode de vie Américain, aux traditions et à la société américaine. Ils ont peu en commun avec l’esprit de tempérance et de compromis qui est le propre du véritable conservatisme au sens classique du terme. Leur réaction politique montre plutôt une haine totale de notre société et de son fonctionnement qui même si elle est en grande partie inconsciente n’en est pas moins profonde. » Richard Hofstadter dans paranoid style Richard Hofstadter en plus d’être l’un des plus brillant observateur de la société Américaine note ici une distinction trop souvent négligée entre conservatisme et populisme. Au fond, si Trump et McCarthy en son temps sont si populaires, ce n’est pas parce qu’ils utilisent des thématiques chères aux conservateurs mais plutôt parce qu’ils prospèrent sur une vague d’indignation et de haine envers la société Américaine à un temps donné. Trump a tout à fait compris cet aspect et cherche désormais à séduire les électeurs de Bernie Sanders dont les affinités avec les conservateurs sont loin d’être évidentes ! L’adhésion des masses s’expliquerait donc ici bien plus par par un rejet du système en tant que tel et de ses élites que par des facteurs psychologiques. De même, on a souvent l’idée que l’électeur type serait , le "petit blanc déclassé" or une étude des soutiens de Goldwater montre que la majorité des militants appartiennent à la classe moyenne supérieure et ne sont pas mis à l’écart de la modernisation au contraire. Ce dernier fut par exemple largement plébiscité dans le compté d’Orange en Californie où la population est en moyenne très aisée et ne peut pas être considérée comme étant mise à l’écart de la modernité.
Surfer sur la peur de la mondialisation :
Trump doit aussi son succès à une compréhension aiguë des frustrations et des craintes qu'a crée une mondialisation loin d’être heureuse pour beaucoup d’Américains. Certes une partie de ses électeurs se sent bien en situation d’insécurité culturelle, craignant la transformation ethnique des Etats-Unis où ils deviendraient une minorité comme les autres. Mais ce sentiment a des motivations largement économiques. Trump ayant intégré cet aspect à son discours, il est le seul sur la scène politique avec Bernie Sanders à proposer de débattre des effets de la mondialisation. Il dénonce notamment les politiques de dérégulation abusives mises en place par Bill Clinton et dont il accuse Hilary Clinton d’être l’héritière. Mais comment ne pas comprendre ce malaise d’une partie de l’Amérique quand on sait qu’aujourd’hui 43 millions d’Américains sont réduits à utiliser des coupons alimentaires, que 15% du pays vit sous le seuil de pauvreté et que comme le démontre Isaac martin, 12 millions de personnes ont été contraintes d’abandonner leur maison pour vivre dans des mobil-homes ou de retourner chez leurs parents après la crise de 2008. Au fond Trump utilise les recettes qui ont fait prospérer le « people’s party » au début des années 1890, lors de la première mondialisation. La modernisation via les chemins de fer et l’urbanisation avait créé naguère un rejet massif des élites qui avaient prospéré grâce à des mesures telles que le railway act. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, face à ces changements, Trump rassure, en adoptant un discours irrationnel, allant jusqu’à affirmer qu’il ira négocier avec les Chinois pour annuler les accords de libre échange. En fait, le candidat républicain prospère grâce au vide laissé par une partie des élites, dont Hilary Clinton sur ce sujet qu’ils refusent d’aborder.
Trump ou la vanité du Narcisse :
Max Weber le savant et le politique, le politique comme métier et vocation : « Il n’existe tout compte fait que deux sortes de péchés mortels en politique : ne défendre aucune cause et n’avoir pas le sentiment de sa responsabilité – deux choses qui sont souvent, quoique pas toujours, identiques. La vanité ou, en d’autres termes, le besoin de se mettre personnellement, de la façon la plus apparente possible, au premier plan, induit le plus fréquemment l’homme politique en tentation de commettre l’un ou l’autre de ces péchés ou même les deux à la fois. D’autant plus que le démagogue est obligé de compter avec « l’effet qu’il fait », c’est pourquoi il court toujours le danger de jouer le rôle d’un histrion ou encore de prendre trop à la légère la responsabilité des conséquences de ses actes, tout occupé qu’il est par l’impression qu’il peut faire sur les autres. D’un côté, le refus de se mettre au service d’une cause le conduit à rechercher l’apparence et l’éclat du pouvoir au lieu du pouvoir réel ; de l’autre côté, l’absence du sens de la responsabilité le conduit à ne jouir que du pouvoir pour lui-même, sans aucun but positif. En effet, bien que, on plutôt parce que, la puissance est le moyen inévitable de la politique et qu’en conséquence le désir du pouvoir est une de ses forces motrices, il ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la politique que celle du matamore qui joue avec le pouvoir à la manière d’un parvenu, ou encore du Narcisse vaniteux de son pouvoir, bref tout adorateur du pouvoir comme tel. Certes le simple politicien de la puissance [Machtpolitiker], à qui l’on porte aussi chez nous un culte plein de ferveur, peut faire grand effet, mais tout cela se perd dans le vide et l’absurde. Ceux qui critiquent la politique de « puissance » ont entièrement raison sur ce point. Le soudain effondrement moral de certains représentants typiques de cette attitude nous a permis d’être les témoins de la faiblesse et de l’impuissance qui se dissimulent derrière certains gestes pleins d’arrogance, mais parfaitement vides. Une pareille politique n’est jamais que le produit d’un esprit blasé, souverainement superficiel et médiocre, fermé à toute signification de l’activité humaine ; rien n’est d’ailleurs plus éloigné de la conscience du tragique qu’on trouve dans toute action, et tout particulièrement dans l’action politique, que cette mentalité. » Ce texte pourtant vieux de plus d’un siècle n’est-il pas violemment actuel ? Ne peut-on pas transposer ces mots pour pour décrire la scène politique contemporaine ? Sans aucun doute. Trump par exemple –mais bien d’autres aussi- entre parfaitement dans le portrait type établi par Max Weber. Comme l’homme politique décrit dans le texte, Trump n’a qu’une conscience éloignée du tragique que peuvent provoquer les mots et pas de conscience du tout du vide et de l’absurde dans lequel il perd le discours politique. Sans aucun but positif, il se refuse à la pensée, qui pourtant doit gouverner les actes des dirigeants pour y substituer ce qu’il appelle « l’action réelle ». Tour de passe passe fort classique chez les populistes, il s’affirme comme anti-intellectuel et se repose sur la mythologie Américaine du « doer ». Mais Weber souligne également ici la différence entre populisme et démagogie. En effet, là où le démagogue cherche à plaire à tout le monde le populiste lui clive pour flatter une partie de la population en en stigmatisant une autre.
Trump Démagogue ou populiste ?
« Tous ces particuliers mercenaires, que le peuple appelle sophistes et regarde comme des rivaux, n'enseignent pas d'autres principes que ceux que lui-même professe dans ses assemblées, et c'est cela qu'ils appellent science. On dirait un homme qui, ayant à nourrir un animal grand et fort, après en avoir observé minutieusement les mouvements instinctifs et les appétits, par où il faut l'approcher et par où le toucher, quand et pourquoi il est le plus hargneux et le plus doux, à propos de quoi il a l'habitude de pousser tel ou tel cri, et quels sons de voix l'adoucissent ou l'irritent, qui, dis-je, après avoir appris tout cela par une fréquentation prolongée, donnerait à son expérience le nom de science, en composerait un traité et se mettrait à l'enseigner, sans savoir véritablement ce qui dans ces maximes et ces appétits est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste, ne jugeant de tout cela que d'après les opinions du gros animal, appelant bonnes les choses qui lui font plaisir, mauvaises celles qui le fâchent, incapable d'ailleurs de justifier ces noms, confondant le juste et le beau avec les nécessités de la nature, parce que la différence essentielle qui existe entre la nécessité et le bien, il ne l'a jamais vue ni ne peut la faire voir à d'autres. Au nom de Zeus, ne te semble-t-il pas qu'un précepteur serait bien étrange ? » PLATON la république Le texte ci-dessus nous montre l’étroitesse du lien entre démagogie au populisme. En fait la plupart des populistes ont souvent une utilisation populiste du raisonnement démagogique. La démagogie dans l’étymologie signifie l’art de savoir « conduire le peuple », ce qui est assez peu attrayant au final voir anecdotique pour un homme politique qui cherche à être élu. Le Pen dans son altercation veut à l'inverse prouver non pas qu'il est un guide du peuple mais qu'il en est un élément comme les autres. Surtout, une erreur d’analyse consiste à trop souvent vouloir minorer l’importance de ces mouvements en les qualifiants d’anecdotiques, affirmant que sur le long terme ils seront voués à disparaître. Ce phénomène ne disparaîtra pas, au contraire, il est le signe d’une déconnection à laquelle il nous faut remédier, le signe aussi que la gauche de pouvoir a complètement failli à sa mission, laissant son électorat traditionnel basculer dans le populisme. Car ne nous y trompons pas, les conservateurs souvent au caractère tempéré tombent rarement dans les excès de la sophistique. Rédouane Ramdani Cessons d'être pessimistes. Le monde de demain sera probablement meilleur que celui d'aujourd'hui. Il suffit de le vouloir... et d'y croire.
On nous fait peur. Sur la société qui nous attend, sur les bouleversements de nos métiers, sur notre capacité à nous - les plus de 35 ans - à faire face, à s’adapter, nous qui avons été formés de compétences déjà obsolètes, nous qui ne sommes pas nés un téléphone à la main, nous qui allons subir le tsunami de la génération Z … Et si nous faisions le choix collectif de dire non à la peur ? Le choix difficile de l’optimisme ? Et si nous décidions d’être nous, les acteurs du monde de demain ? Dans 15 ans, j’aurais 48 ans. 40 à 50% des métiers auront disparus en particulier à cause des machines . Ce n’est pas moi qui le dit ni Marty McFly, c’est Harvard, Oxford (1), et tout un tas de chercheurs très sérieux. La science aura fait des progrès énormes, pour le meilleur et aussi probablement le pire. Un monde chaotique ? Alors dans 15 ans, on imagine un scénario où l’on fait un métier sans trop savoir pourquoi, où les machines ont remplacé beaucoup de choses inintéressantes qu’on avait l’habitude de faire mais aussi des choses qu’on aimait faire, où l’on est tellement connectés qu’on chat avec un inconnu au bout du monde mais qu’on ne connait pas son voisin. Un scénario où l’on ne va plus à la pompe car un robot vient automatiquement recharger notre réservoir d’une essence de plus en plus difficile à produire, où l’on se nourrit de pilules aux goûts acidulés car nous avons épuisé nos ressources, où la science nous permet d’avoir 3 enfants tous nés de sexe masculin parce que c’est plus pratique le dimanche pour le programme foot. Un monde où l’on entend toutes les semaines qu’un pays disparaît de la carte pour manque d’eau , sans parler des conflits, des catastrophes naturelles et autres désastres humanitaires ….. Et là je dois le reconnaître, j’ai un peu peur. Un avenir radieux ? Ou alors dans 15 ans, on n’a pas un métier mais trois activités , complémentaires, épanouissantes, certaines rémunérées et d’autres pas. En France, le nombre d’indépendants a augmenté de 85% en moins de 10%. La « plateformisation » de l’économie va accélérer de façon exponentielle cette tendance. Dans 15 ans, on utilise les machines pour nous soutenir, mais on a su mettre des valeurs et de l’éthique au coeur de nos décisions, sans laisser le fantasme de l’homme augmenté nous brûler les ailes. Dans 15 ans, on connait son voisin et sa voisine, et avec eux, on troque, on partage, on rigole. On ne va plus à la pompe parce qu’on n’a plus de voiture. On mange des légumes biologiques produits en permaculture sur la ferme-terrasse de son immeuble. Dans 15 ans, on a 3 enfants qui sont tous très différents, très créatifs, très empathiques, et l’école elle aussi a changé. Elle apprend à réussir avec plutôt que contre les autres. A poser des questions plutôt qu’à réciter des réponses. Et du coup le programme du dimanche devient une vraie galère de créativité. On préserve nos ressources, on les partage, on vit ensemble sur une même planète. Surfer ou se noyer La vague est là. La question est de savoir si on surfe dessus ou si on se laisse noyer. On ne va pas se mentir, y a du boulot. Mais si l’on fait le choix du verre à moitié plein, fini la peur. En France, aujourd’hui, on invente des écoles pour que tout le monde puisse apprendre à coder. On sait comment remettre en selle des personnes cassées par la vie avec des modèles d’insertion qui ont fait leur preuve. Et certains vont même répliquer nos modèles dans la Silicon Valley. On innove pour généraliser l’économie circulaire et éliminer le gaspillage en créant d’énormes opportunités économiques. On réinvente la distribution du producteur au consommateur. Et de nouvelles formes de croissance. Simplon, Calso, La Ruche qui Dit Oui !, Phenix, …derrière toutes ces initiatives, des 35-45 ans, ceux-là même dont on dit qu’ils vont être submergés. Dans la définition du Larousse, la peur « est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre ». Choisissons le combat, celui de l’optimisme ! Laurence Lamoureux, fondatrice de MySezame Œdipe explique l'énigme du sphinx, Jean-Auguste-Dominique Ingres Quel est le point commun entre le héros du mythe de Sophocle, la gouvernance de la polis et les prochaines élections présidentielles ? Derrière cette équation apparemment insoluble se cache la trinité du pouvoir, de la culpabilité et de la responsabilité. En voici, schématiquement, le sens ; ou comment illustrer la politique actuelle par un mythe vieux de plusieurs siècles. La légitimité du pouvoir politique Oedipe est choisi par la Cité de Thèbes pour devenir son roi. Il tire donc la légitimité de son pouvoir de la volonté populaire qui a reconnu en lui des qualités exceptionnelles propres aux dieux. Aujourd’hui, on qualifierait de démocratique cet acte - sans que cela engendre pour autant, bien entendu, une démocratie. En effet, Oedipe est plus qu’un roi, il est un tyran au sens grec du terme, c’est-à-dire pas nécessairement quelqu’un de despotique et de machiavélique avec son peuple (au début de la pièce, dans les supplications adressées à Oedipe, on sent qu’il est manifestement très aimé des Thébains), mais un homme qui n’a pas hérité du pouvoir de son père. Le mot tuvrannoı implique qu’Oedipe n’appartient pas à une famille régnante ; lui a conquis le trône « par la faveur du peuple », donc démocratiquement. Comme les politiques contemporains. La passion du pouvoir Cependant, l’évolution de l’exercice du pouvoir par Oedipe peut s’apparenter à nos sociétés contemporaines, et, plus précisément, à la passion du pouvoir. Au fil de la pièce de Sophocle, l’hubris d’Oedipe prend le pas sur sa sagesse, et à l’image du protecteur succède une image dégradée du pouvoir qui se réalise dès le retour de Créon et l’affrontement avec Tirésias. Cette passion du pouvoir le rend aveuglant : Oedipe commence alors par réagir de manière « tyrannique » au sens où le français l’entend (il parle de tuer Créon sans le juger : attitude arbitraire qui est caractéristique du tuvrannoı). Or, « la violence fait le roi » écrit Jean Bollack : la démesure et la tyrannie sont donc mères et filles. Oedipe porte en lui la violence du tyran, aveuglé par les rayons du pouvoir, et oublie ses devoirs envers la cité. De nos jours, cela semble encore plus vrai. En effet, l’histoire d’Oedipe est le plus complet des mythes politiques, dans la mesure où chaque étape de son parcours retrace un moment dans l’accession au pouvoir (Marie Delcourt, Oedipe ou la légende du conquérant, 1981) : l’exposition de l’enfant, le meurtre du père, la victoire (sur la Sphinge), l’énigme, le mariage avec la princesse et l’union avec la mère. Or, nombre de présidentiables de 2017 retracent cette voie oedipienne sans en faire le moindre complexe. Mais d’où vient ce vice du pouvoir aveuglant ? De la culpabilité D’Oedipe, encore. Et de la culpabilité. Karl Jaspers a distingué quatre formes de culpabilités dans son essai La culpabilité allemande : criminelle, morale, métaphysique et politique. Où se situe la culpabilité oedipienne ? Un peu dans chacune d’elle : le meurtre du père, l’inceste, l’infraction des lois divines puis la trahison envers les citoyens de Thèbes - donc envers la Cité. Sophocle montre donc ainsi que c’est Oedipe qui a rendu tout pouvoir coupable : on ne peut exercer le pouvoir sans une quelconque culpabilité. Or, dans la langue de Jaspers, le mot « die Schuld » désigne à la fois la dette et la culpabilité : ce pouvoir coupable est une dette dont les générations futures devront payer le prix - celui du déni de responsabilité. « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » écrivit René Char (Feuillets d'Hypnos) : encore moins celui des politiques. Aux présidentiables de 2017, donc, de refuser ce legs que Sophocle a su s’y bien mythifier. Car ce pouvoir oedipien, c’est celui qui aveugle, qui culpabilise, qui tyrannise, qui perd sa raison d’être alors qu’il avait celle de naître. A eux et aux citoyens de « prendre leurs responsabilités », comme Antigone envers son père (Oedipe à Colone, Sophocle), au risque de tous terminer avec les pieds enflés. Tom Cailletétudiant à HEC Paris, passionné de philosophie, vous pouvez aussi trouver son article précèdent sur les jeux olympiques. CatégoriesNotre représentation du temps est polluée et restreinte. Nous l’abordons quasiment par réflexe sous l’angle unique de sa gestion. Nous adorons construire des emplois du temps plus ou moins précis et rigides, élaborer ou adopter des méthodes de Time Management pour gérer au mieux ce que nous percevons comme une ressource. Cette approche a comme simplifié et figé de manière rassurante le « temps ». Elle est héritée directement des Révolutions industrielles qui ont ouvert la voie par des techniques toujours plus élaborées à des gains de productivité toujours plus importants et associés à la croissance et au progrès en général. S’est alors opéré dans les esprits un basculement vers une représentation du temps ne pouvant être valorisé qu’en tant qu’il est rendu productif. On s’est mis à faire fructifier le temps comme l’on s’est mis à faire fructifier le capital : Time is money. Le temps de l’économie industrielle est né. On a inventé la « perte de temps », ce temps improductif, confondant non-action et passivité : il faut faire quelque chose. Et de fait en voulant éviter de ne rien faire et donc de « perdre son temps », nous perdons notre temps tout à fait. On ne réalise plus qu’en ne faisant « rien », qu’en laissant simplement ses pensées se délier dans nos esprits, on fait infiniment plus qu’en consultant son téléphone à la recherche frénétique d’informations vides mais donnant l’illusion de « faire ». "En voulant éviter de perdre notre temps, nous le perdons tout à fait : prendre son temps n’est pas perdre son temps" On a pensé que si ce temps-ressource a pu être le support d’une croissance économique fulgurante depuis 2 siècles, il pourrait être bon de le fixer et de le généraliser. Et si le Time management pouvait devenir un outil d’application rationnel et scientifique de notre volonté sur le monde, donc de contrôle de nos vies, donc de liberté ? Là où il y a égarement, c’est que l’on a commencé à appliquer à nos vies une logique issue de l’industrie et donc destinée à des machines. Le temps de la vie humaine est précieux, mais pas en tant que ressource au sens économique du terme. Les temps et les rythmes de l’homme ne peuvent être rapportés à ceux d’une machine. C’est de là que provient l’aveuglement : l’homme est assimilé à une machine dont l’on peut sans limite améliorer la productivité. Et l’on regrette presque que l’homme ne soit pas justement une « meilleure machine ». Et ce que l’on peine aujourd’hui à comprendre, c’est que ce n’est pas là un défaut ou une limite de l’homme. C’est au contraire là que réside toute sa force de création et toute sa capacité à donner du sens aux choses. Mon idée est que plutôt que d’être obsédé par la gestion optimale de son temps, il faut arriver à sortir de cette logique de « gestion du temps » ou « Time management » trop dépendante de la représentation du « temps-ressource » dont le seul destin est d’être rendu toujours plus productif. Non pas pour l’oublier, mais pour la combiner à d’autres approches. Il faut libérer le temps de sa gestion ! "On applique à nos vies des logiques issues de l’industrie et destinées à des machines" Le but de mon article est ainsi d’enrichir les représentations temporelles des lecteurs en suggérant d’autres schémas mentaux autour de la notion de temps. C’est une nécessité, non seulement parce qu’en enrichissant ses représentations, on enrichit sa vie, mais aussi parce le « temps-ressource » seul échoue même à ses propres objectifs. En n’envisageant le temps que sous l’angle de la productivité, l’on devient souvent paradoxalement et plus ou moins consciemment contre-productif à moyen et long-terme. J’ai consacré un mémoire de recherche assez conséquent sur ce phénomène dans la ville de Shanghai en explorant de nombreux cas tant dans le monde de l’entreprise que dans les vies personnelles des Shanghaiens. Mais un certain nombre des résultats de mes recherches à Shanghai s’applique au monde industrialisé et urbanisé en général. Plus proche de nous, les travaux du sociologue du travail Philippe Zarifian mettent très bien en évidence ce phénomène dans le monde de l’entreprise. Les éléments de cet article, très synthétiques, sont tirés d’une conférence que j’ai donnée à Shanghai sous le titre Time representations, happiness and efficiency et sont inspirés de mes observations, réflexions et lectures dont entre autres, outre les travaux de Zarifian, ceux de Hartmut Rosa et François Jullien. Leur objectif est d’enrichir les moyens dont disposent mes lecteurs pour penser la question du temps tant dans le cadre de leur vie personnelle que professionnelle. Car c’est bien là le vrai rôle du manager au passage : trouver des équilibres dynamiques en fonction des situations. Dès qu’il y a de l’humain, il n’y a jamais de recettes toute faites et fiables en toutes circonstances et il faut donc garder une posture ouverte, dynamique et consciente. Concevoir le temps uniquement comme une ressource économique c’est avoir un management infécond et justement contre-productif. Il s’agit de savoir alterner de façon pertinente les conceptions et pour cela il faut d’abord remettre du dynamisme dans une représentation du temps qui s’est figée ! Dans un premier temps il s’agit déjà de bien réaliser à quel point le concept de temps est en lui-même déjà un outil artificiel de régulation d’abord social (calendrier, etc.) puis économique (ressource au service de la productivité). Une fois cette mise à distance évitant de confondre carte et réalité intégrée on peut commencer à se libérer de représentations trop étroites. Voici à présent une proposition synthétique d’outillage conceptuel, tant pour sa vie personnelle que pour sa vie professionnelle, dans le but d’initier une réflexion et une mise en mouvement des schémas mentaux de la temporalité ancrés dans nos esprits modernes. J’y passe en revue un certain nombre de notions liées au concept de temps. Elles ne sont d’ailleurs pas exclusives, elles communiquent entre elles, et ont toutes l’avantage d’être de bonnes portes d’entrée pour repenser ce qu’est pour nous le « temps » au quotidien. Cet outillage appellera à des développements dans d’autres articles. Le moment
"Comment puis-je utiliser ce moment ?” ou “A quoi ce moment est-il favorable ?” Il peut être vu comme une « fraction » de temps face à laquelle on se demande : « comment puis-je utiliser ce moment ? ». Les concepts moteurs sont alors ici ceux de liberté, d’initiative, de volonté. Il peut aussi être vu comme un contexte spécifique qui amène plutôt la question : « Pour quelles actions ce contexte est-il favorable ? ». Ici le concept moteur est l’harmonie. Dans un cas, l’emploi du temps est une série de « créneaux-boites » que l’on veut remplir au mieux et dans l’autre cas, c’est une succession de terres fertiles appelant à féconder des graines différentes. La tension entre ces deux approches est perceptible à maintes occasions où l’on a du mal à lâcher prise sur le contrôle que l’on pense exercer sur son temps : voyager en suivant un plan et une liste précise de choses à faire ou bien se laisser aller à une appréciation plus spontanée de ce qui vient, répondre à des mails lorsque l’on est avec des amis, consulter son téléphone pendant une conférence, etc. Il n’y a encore une fois pas de manichéisme dans ces approches : tout est une question de conscience, d’arbitrage et d’équilibre. L’opportunité "L’opportunité-quantité ou l’opportunité-qualité ? (la boîte ou la graine ?)" Elle affecte directement notre conception du moment vue précédemment. L’opportunité peut être vue comme l’occasion unique d’un saisissement à l’image du dieu grec Kairos-opportunité dont il fallait savoir saisir les longs cheveux au moment où il se présentait à nous, ni avant, ni après. Mais aujourd’hui les opportunités à saisir et à ne pas rater sont partout, à tout moment, numérique aidant, et le risque est de se noyer, ne sachant comment prioriser. La conception chinoise traditionnelle de l’opportunité peut ici être pertinente. Le sens du sinogramme 时 shí signifiant « moment » mais aussi « saison » et « opportunité » en chinois traditionnel est « le soleil fait éclore les germes de vie contenus dans la terre » (Claude Larre). Il s’agit ainsi de « planter une graine » au bon moment et d’en attendre les fruits plus tard. En concevant l’opportunité aussi comme une graine à planter et pas seulement comme une chance à saisir et qu’il ne faut pas rater, on inscrit son action dans une perspective qualitative et long-termiste qui tempère la frustration dans laquelle on peut plonger lorsque l’on ne vit que selon la première perspective. Il faut apprendre à voir dans l’opportunité, outre l’irréversibilité qui nous met sous pression, les fruits que l’on espère en tirer à long-terme et le temps qu’il faudra consacrer à arroser la graine. Le rythme "Performance mesurable ou maturation subjective ?" Notre conception du bon rythme est perturbée par notre besoin de vitesse. On surestime toujours notre capacité à aller vite, ce qui ne fait que renforcer nos frustrations dans nos réalisations. Nous n’arrivons plus à regarder sereinement nos avancements dans nos activités diverses car nous les jugeons à la lumière de la performance numérique mesurable et tangible et pas assez à la lumière qualitative du processus même de réalisation. Lorsqu’on lit un livre par exemple, on se laisse trop souvent impressionné par le « +1 », par le nouveau score des livres achevés, sans considérer suffisamment la manière dont l’on s’est transformé ou pas dans la lecture. « J’ai fini ce livre » : tu n’as rien fini du tout car la fin, ce n’est pas le livre que tu as consommé, c’est toi-même. L’on pourrait passer sa vie entière sur un seul livre ! Combien de livres (ou équivalents de cette invention moderne) pensez-vous réellement qu’Aristote a pu lire à son époque ?… Du point de vue aussi de la productivité, en entreprise notamment, il faut savoir alterner de manière adéquate les visions du bon rythme. La perception adéquate n’est pas systématiquement celle d’une productivité mesurable où il s’agit de faire le plus possible dans un temps réduit au maximum. Il y a des rythmes, notamment ceux de la créativité et de la qualité (mais pas seulement), où il faut accepter que la productivité ne soit pas de l’ordre de la mesure mais d’un rythme interne non-objectif correspondant à celui d’une maturation et d’une assimilation qui garantit sur le long-terme un travail de bien meilleure qualité que celui élaboré sous une pression d’un résultat tangible court-termiste. On a oublié que prendre son temps n’est pas nécessairement perdre son temps, au contraire. Il s’agit là encore de juger du bon équilibre et du bon arbitrage entre les représentations. La continuité "Table rase ou changement transitionnel ?" Pour assurer la continuité sur le long-terme d’un processus, d’un projet, d’une relation, etc. il y a au moins deux façons : le changement radical lorsque le processus ne fonctionne clairement plus ou bien injecter déjà lorsque l’on sent poindre l’épuisement du processus un petit changement transitionnel qui lui donne un nouvel élan jusqu’à la phase de faiblesse suivante. Cette deuxième conception est très présente dans les sagesses traditionnelles asiatiques qui s’intéressent plus aux processus qu’aux événements qui ne sont souvent que des manifestations spectaculaires de « transformations silencieuses », selon l’expression de François Jullien, et qui sont à l’œuvre déjà bien en amont de manière certes moins visible mais plus ancrée. L’idée de cette sagesse est d’agir directement sur les processus par petites touches plutôt que d’attendre l’événement qui parfois sera celui d’une table rase apparente qui ne garantit pas même nécessairement la construction de quelque de chose de novateur derrière. Ces logiques et les arbitrages qu’elles appellent peuvent même s’appliquer à la petite échelle d’une conversation. Les catégories passé/présent/futur "Des actes de l’esprit précieux pour s’orienter et construire son récit" Ces trois catégories sont des actes de l’esprit ne renvoyant à rien de réel malgré la consistance que semble leur donner le langage. Le passé est avant tout une empreinte laissée dans la mémoire, le futur une orientation imaginée et le présent un contexte. Il faut savoir donc être agile à leur égard. La planification excessive et rigide du futur n’a aucun sens, bien que rassurante. Chercher par exemple absolument à concrétiser une action que l’on a planifié alors que le contexte ne s’y prête plus peut devenir destructeur. Planifier permet avant tout de s’orienter. Par ailleurs, un autre aspect intéressant de ces catégories est que « passé » et « futur », dans leur construction imaginaire, forment à eux deux le récit de l’histoire et donc l’identité d’un individu ou d’une organisation. Le bien-être se trouve du côté de la cohérence et de la progression de ce récit. Hartmut Rosa démontre brillamment dans Aliénation et accélération la manière avec laquelle nos vies d’aujourd’hui mettent sous tension la cohérence de ce récit et donc de notre identité débouchant sur un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de soi-même. Le repos “Nous ne savons plus féconder l’ennui” C’est peut-être la conception la plus mise à mal de notre époque du fait de ce que j’appelle « l’imaginaire de la machine ». Et c’est peut-être aussi la source de toutes les autres tensions temporelles qui nous traversent. Les moments de repos, de pause, de temps libre sont vus comme des moments improductifs. Mais ils sont inévitables du fait de notre condition humaine qui à vrai dire nous dérange presque. Si l’on avait le pouvoir de se débarrasser de ces moments perdus, l’on n’hésiterait pas. C’est là selon moi l’une des pensées les plus dramatiques de notre temps car l’on ne voit plus la force fondamentalement créatrice du repos qui est totalement complémentaire de l’action et non soumise ou opposée à celle-ci. Se reposer, ce n’est pas simplement « recharger ses batteries ». C’est un moment à part entière de l’action et de la création. C’est l’occasion d’une prise de recul et d’un moment réflexif qui nourrit l’action de manière féconde. Et ces moments de repos ne sont pas uniquement des moments de solitude réflexive. Il peut s’agir également d’un temps consacré à une activité physique ou à un ami. On fait souvent l’erreur de ne voir que le temps que ces moments nous font « perdre » à court-terme, mais une heure passée à faire du sport est largement compensée par le temps « gagné » en terme d’efficacité derrière. J’utilise sciemment ici le vocabulaire du Time Management pour souligner à quel point cette logique elle-même de production court-termiste échoue à ses propres objectifs et est en réalité inopérante et inadaptée à l’humain. Quant au temps passé avec un ami, une personne avec laquelle on apprécie discuter ou encore un collègue d’un autre département de son entreprise : les inspirations, les réflexions, les opportunités même pouvant naître de ces conversations représentent potentiellement un « temps gagné » inestimable ! Le court-termisme productif pousse même à l’aberration de temps réellement morts qui redéfinissent le repos d’une manière étrange : le besoin de faire quelque chose va plutôt nous amener, pour nous reposer « rapidement », à passer quelques minutes par exemple sur ton téléphone à faire défiler des platitudes sans but précis. Ce moment de repos est tué tout à fait car il se déploie sur un écran qui empêche de laisser libre cours à ses pensées créatrices. « Nous ne supportons plus la durée » écrit Paul Valéry dans son Bilan de l’intelligence… Parfois jusqu’à l’absurde. C’est un besoin frénétique : il faut faire quelque chose, même s’il s’agit de faire défiler de manière hypnotique des images et des textes sur un écran. L’on parle beaucoup du temps de vie perdu à chaque cigarette, mais qui parle du temps vie perdu sur les écrans de téléphone ? J’aime particulièrement l’image suivante : on explique souvent que dans la Bible, le Créateur a façonné le monde en 6 jours et s’est reposé le 7ème. Quel sens cela a-t-il pour Lui de se reposer ? Ce n’est pas un homme ! La raison est que le 7ème jour est aussi un jour de création : celle du repos. Cela permet de sortir de la vision du repos comme moment de faiblesse : le repos correspond à un jour entier de la création divine, ce qui laisse imaginer ses propres potentialités créatrices mises entre les mains des hommes ! Mais « nous ne savons plus féconder l’ennui » comme l’écrit superbement Paul Valéry… Les diverses sagesses développées par les religions, les philosophies, les systèmes de pensée des nombreuses traditions que compte l’humanité sont particulièrement pertinentes et rafraîchissantes. Elles peuvent redynamiser des représentations qui se figent dans un seul sens à l’ère que nous appelons « moderne ». Paul Valéry déplorait dans son Bilan de l’intelligence que nous ne regardions « plus le passé comme un fils regarde son père, duquel il peut apprendre quelque chose, mais comme un homme fait regarde un enfant ». Sur la question du temps, des hommes qui ont vécu à une ère agraire où la survie et la prospérité dépendaient d’actions menées au moment adéquat, et à une ère où la conscience de la haute valeur du temps n’était pas confondue avec la mesure de la productivité, ont beaucoup à nous apprendre. Le travail sur les habitudes passe par un travail préalable sur les représentationsMon ambition ici n’est pas de livrer des recettes mais d’engager une réflexion sur nos représentations mentales. Ma vision est que le préalable à tout changement profond de ses actions est un changement de ses représentations. Les actions correspondantes s’élaboreront ensuite presque naturellement autour de ces représentations pour peu que l’on ait la patience de les méditer et de les intégrer. Cet article synthétique veut d’abord mettre en mouvement ces représentations pour créer les récipients mentaux favorables aux changements de comportements. Suivront d’autres articles précisant et élaborant autour des éléments évoqués ici dans un premier temps. La meilleure conclusion à cet écrit se trouve peut-être dans ces mots tellement lucides de Paul Valéry dans le Bilan de l’intelligence : « L’interruption, l’incohérence, la surprise sont des conditions ordinaires de notre vie. Elles sont même devenues de véritables besoins chez beaucoup d’individus dont l’esprit ne se nourrit plus, en quelque sorte, que de variations brusques et d’excitations toujours renouvelées. Les mots « sensationnel », « impressionnant », qu’on emploie couramment aujourd’hui, sont de ces mots qui peignent une époque. Nous ne supportons plus la durée. Nous ne savons plus féconder l’ennui. Notre nature a horreur du vide, — ce vide sur lequel les esprits de jadis savaient peindre les images de leurs idéaux, leurs Idées, au sens de Platon. » Guillaume Alliel, suivez son blog medium « Rien n’égale en longueur les boiteuses journées, Quand sous les lourds flocons des neigeuses années L’ennui, fruit de la morne incuriosité, Prend les proportions de l’immortalité. -Désormais tu n’es plus, ô matière vivante ! Qu’un granit entouré d’une vague épouvante, Assoupi dans le fond d’un Sahara brumeux ; Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, Oublié sur la carte et dont l’humeur farouche Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couchent. » Ce fragment des Fleurs du Mal (Spleen et Idéal) de Charles Baudelaire nous place immédiatement dans le contexte de cet article. Celui d’une compréhension plus profonde de l’ennui, ce malaise dévastateur à la manière du Spleen Baudelairien. Il faut dire que l’ennui est un mal aussi ancien que les premiers hommes, et c’est en cela qu’il me fascine. Pour chacun d’entre nous, l’ennui se résume à un certain malaise face à une situation qui viendrait à contre courant de notre activité perpétuelle. Il nait aussi d’une suite d’exaspérations, et prend la forme d’un esprit de désœuvrement. On le ressent davantage quand la somme des énergies qui nous habite s’efface dans la routine et les mésaventures. C’est en ce sens un ennui existentiel, et chacun en a une expérience qui lui est propre. Mais il peut être aussi, je le conçois, un moment d’aspect plus neutre, qui nous fait nous évader de notre activité répétitive parfois éreintante bien qu’il puisse devenir parfois insupportable. C’est un ennui vécu quotidiennement. Je distingue donc deux types d’ennui : le premier qui se rapporte à la souffrance, et le second à une forme de passivité plutôt neutre. C’est bien le premier sens qui est le plus dévastateur, quand le deuxième n’est que de nature éphémère. Quand j’évoquais l’idée un peu saugrenue d’un ennui moteur de l’histoire, je pensais tout d’abord à l’exemple de la Première Guerre Mondiale, et à ses causes profondes. Mais nous pourrions nous appuyer sur d’autres faits historiques encore. Cette idée fut développée principalement par George Steiner dans son essai Dans le Château de Barbe-Bleue publié en 1986. Le XIXe siècle affirme-t-il est un « Siècle de l’ennui » (le premier chapitre de l’essai s’intitule à juste titre « Le grand ennui »). Même s’il caractérisé à l’évidence une aristocratie oisive du début du XIXe siècle, l’ennui se démocratise rapidement à toutes les classes sociales. Pour quelles raisons ? Il faut pour cela revenir quelques temps en arrière, à l’heure des batailles Napoléoniennes quand les idéaux révolutionnaires secouaient et déchiraient l’Europe de toutes parts. D’Arcole à Waterloo, les grandes batailles de Napoléon ont fait de lui un personnage qui a véritablement appris la manière de faire la guerre à l’Europe. Si bien que ses campagnes forgent des esprits passionnés par la nation, la force, et développent des énergies multiples qui se gonflent au fil du temps. Déjà la révolution française auparavant avait déchiré les passions et les Hommes dans des scènes de barbarie et d‘élans politiques impressionnants. Ce début du XIXe siècle marque véritablement une « Grande Épopée » qui ménera sa course au plus profond de l’esprit de chaque individu. Après cette épopée? Rien. Un immobilisme et des énergies qui restent bornées, frustrées, qui n’ont plus d’objet. Les champs de guerre diaboliques laissent leur place à des usines tout aussi diaboliques, ces « Dark satanic mills » comme William Blake les décrivait dans un de ses poèmes. Le développement industriel est fulgurant, si bien que « l’enfer urbain et ses hordes sans visages hantent l’imagination du XIXe ». Cette forme de dépression globale, de malaise dans la civilisation européenne, est aussi visible à travers les arts, dans la peinture et dans la littérature. Des courants de peintres produisent des figures apocalyptiques de ruines de capitales. Madame Bovary, personnage de l’œuvre éponyme de Gustave Flaubert se présente sous les traits d’une femme dont les rêves et les aspirations sont contrariés, écrasés sans pouvoir éclore. Une femme qui respire un profond ennui. Si bien que « Elle entra dans le corridor où s’ouvrait la porte du laboratoire. Il y avait contre la muraille une clef étiquetée capharnaüm […] saisit le bocal bleu, y fourra sa main, et, la retirant pleine d’une poudre blanche, elle se mit à manger à même […] Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus. » Malgré ces troubles, on trouve des refuges à cet ennui, visibles dans tout l‘apport de cet exotisme si propre au romantisme. Mais c’est bien cet exotisme qui trahit justement l’ennui latent ! Il est alors plus facile de lire les évènements survenus au début du XXe siècle, et notamment l’éclatement de la Première Guerre Mondiale mentionné plus haut à la lumière de l’ennui. Ce déchaînement de barbarie caractéristique du XXe siècle n’est-il pas au fond l’enfant batard de l’ennui ? : « Plutôt la barbarie que l’ennui » déclarait Théophile Gaultier ! Steiner écrit au début du chapitre Une saison en enfer : « Il y avait dans l’air des pressentiments de guerre et des fantasmes de destruction universelle ». Le sang versé par un 22 août 1914, jour le plus meurtrier de la Première Guerre Mondiale avec plus de 27.000 morts français, en est le témoin. Les énergies négatives accumulées lors du siècle précédent se déversent dans un torrent de haine de l’ennemi. L’ennui a été pour ainsi dire le terreau le plus fertile pour le développement de haines contre les races, contre les peuples, qu’a connu le XXe siècle. Il n’est pas le direct responsable, mais est une composante importante de cette grande matrice. Première caractéristique flagrante et stupéfiante de l’ennui : pour le rompre, rien de tel que la barbarie et la cruauté. D’ailleurs, la source latine du mot « ennuyer » provient du latin « inodiare » qui signifie « rendre odieux ». Mon œuvre favorite, L’ennui, écrite par Alberto Moravia en 1960, illustre parfaitement ce sentiment et la manière de s’extraire d’un tel malaise. L’ennui résulte dans le livre d’un manque de rapport entre Dino, jeune peintre qui ne trouve plus la motivation de peindre, et le réel formé des objets aussi bien que des personnes qui l’entourent. C’est une définition existentielle de l’ennui. Nous nous ennuyons quand le rapport avec notre environnement ne nous apparaît plus clairement. Encore une fois, chacun explore cette expérience à sa manière. Dino entame alors une relation avec une jeune femme, Cecilia mais leurs rapports sont creux, et mécaniques. Ils se résument à des rapports sexuels quotidiens et à des discussions vaines et de surface, ils se connaissent finalement assez peu. On trouve au chapitre III quelques phrases signifiantes : « L’ennui détruisait d’abord mon rapport avec les choses, puis les choses elles-mêmes, les rendant irréelles et incompréhensibles ». Pour donner un exemple de son ennui vis-à-vis des choses, il prend pour exemple son rapport avec un verre et dit un peu plus loin « Et, de même que le verre, lorsque mon ennui me le faisait apparaître incompréhensible et absurde, m’inspirait parfois un violent désir de le saisir, de le jeter à terre et de le réduire en miettes afin d’obtenir par sa destruction, une confirmation de son effective existence, ainsi à plus forte raison, quand je m’ennuyais avec Cecilia, l’envie me prenait sinon de la détruire véritablement, mais au moins de la tourmenter et de la faire souffrir ». Dino se sent plus existant et semble sortir de son ennui quand il fait souffrir Cecilia. L’aspect cruel et barbare de certains comportements pour rompre l’ennui est donc ici encore bien présent. Un exemple évident reste celui des relations amoureuses pour. Rares sont les couples qui échappent à l’ennui et pourtant celui-ci n’est pas nécessairement un mal qui serait le « propre de l’autre », on en est en réalité tout à fait responsable. Nous avons la tendance naturelle à reporter justement cet ennui sur tout ce qui n’est pas nous, en le pointant du doigt. Mais il nous concerne justement, il faut trouver comment on a perdu ce rapport avec ce qui nous entoure. Et bien souvent, l’ennui provient du fait que l’on cède à des images extérieures de réussite et de relation parfaite que l’on arrive pas à reproduire au sein du couple. Ce qui est normal car chaque situation est unique et mérite son propre cheminement. Quand vous interrogez un couple après séparation, l’ennui revient souvent comme motif de rupture, sans signifier forcément un « désamour ». Alors oui, parfois pour rompre l’ennui du couple, quand on se sent mal, sans forcément désaimer l’autre, des comportements cruels servent d’électrochocs pour le couple. Et l’achèvent bien souvent. La seconde forme d’ennui (l’ennui vécu quotidiennement) peut aussi se comprendre comme étant un moment, relativement long, où l’esprit se retrouve seul face à lui-même. Dans certains cas, il peut être une forme d’échappatoire face à une vie débordante et parfois couper certaines formes de rapports avec nos semblables, nos objets et lieux habituels, pouvant nous faire nous évader un court instant.
Pour autant, ce même ennui peut être mal vécu. Par exemple, quand vous arrivez en avance à un rendez-vous, et que vous devez attendre 40 minutes sans autre objectif que de réduire au maximum le « temps vécu » de l’attente. Ces minutes sont lourdes, même avec votre Smartphone entre les mains. Dans ce cas précis, l’esprit n’aime pas se retrouver seul avec lui-même, et cet ennui est bien souvent vécu comme un malaise. C’est l’objectif d’une étude de juillet 2014 conduite par Timothy D. Wilson et son équipe de l’université de psychologie de Virginie. Ils ont montré qu’un individu (il existe évidemment des différences entre genres) placé dans un endroit, seul, sans support écrit ou Smartphone pendant 15 minutes passait un moment désagréable et ne le supportait que très peu. Le pire étant, par la suite, qu’il est proposé aux candidats (toujours pendant ces 15 minutes) de presser un bouton pour recevoir une décharge électrique quand l’attente les dérange trop. Cela permet d’arriver directement à la fin des 15 minutes. 67% des hommes s’administrent l’électrochoc. La souffrance est donc préférable à l’ennui, dans ce sens précis, et rejoint alors en partie Théophile Gautier et son affirmation « Plutôt la barbarie que l’ennui ». L’ennui est donc une composante des relations humaines qui joue un rôle fondamental dans les évènements qui ponctuent nos vies. L’ennui existentiel est un mal obscur qui touche les individus au plus profond d’eux mêmes et donc leur entourage en conséquence. Mais l’ennui peut aussi toucher toute une société et la marquer durablement, ce qui se ressentira dans ses agissements de masse. On pourrait même analyser à travers le prisme de l’ennui les comportements de recrutement du groupe État Islamique, où l’on avance souvent que les jeunes qui sont enrôlés souffraient d’un profond malaise dans notre société. Nicolas Amsellem |
AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives
Juin 2017
Catégories
Tout
|
|
L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].
Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |










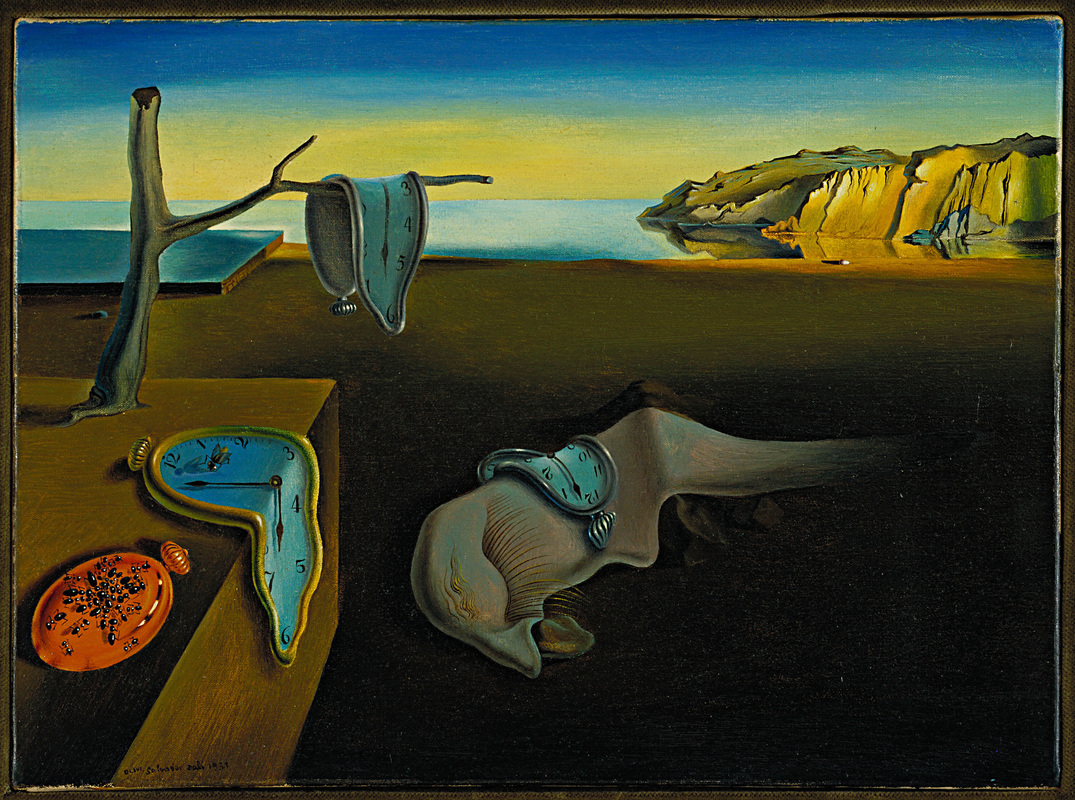






 Flux RSS
Flux RSS