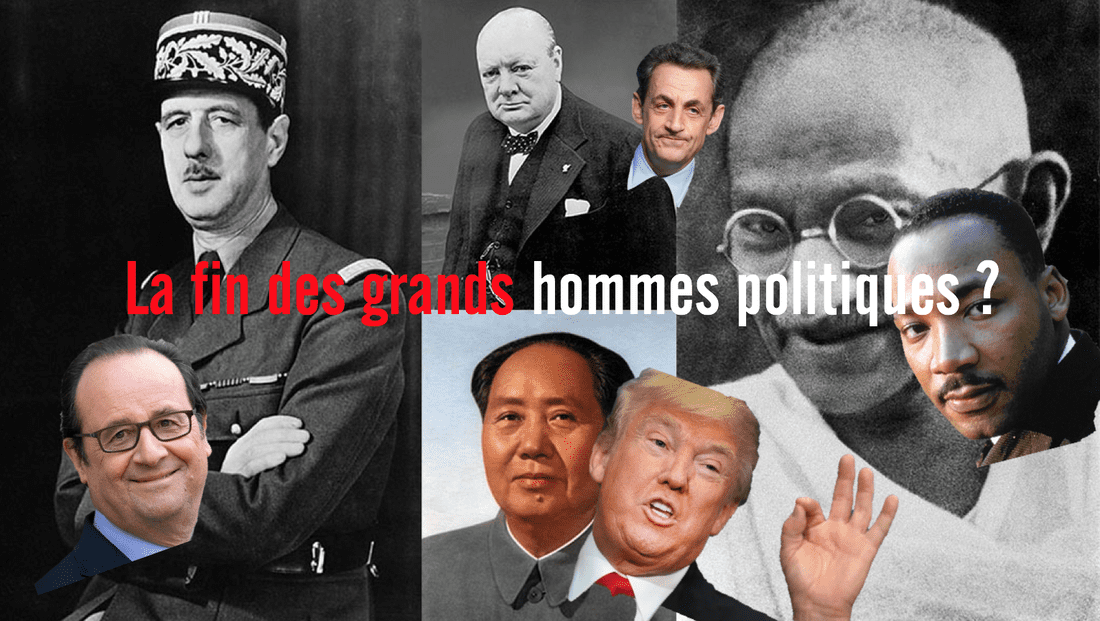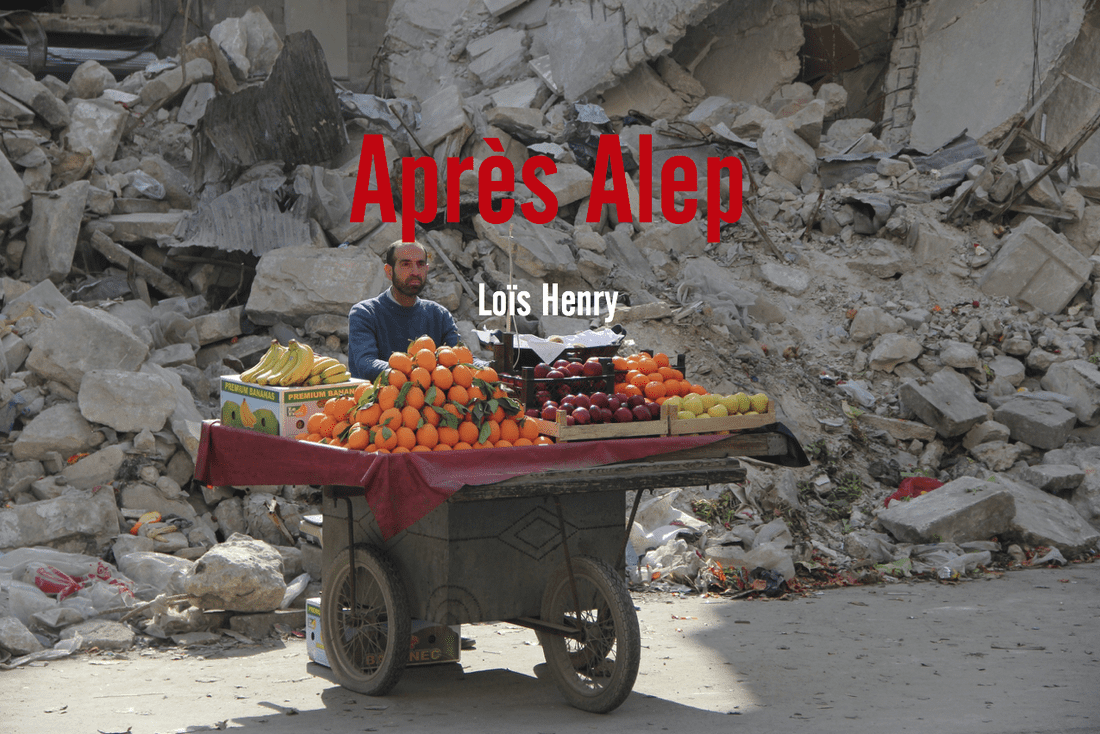|
C’est sûr qu’il ne s’y attendait pas. À 21 ans, ce jeune étudiant qui souhaite rester anonyme a frôlé la mort lors de son séjour Erasmus en Slovaquie. Et ce n’était pas lorsqu’il a chaussé des skis, pour la première fois, dans les régions montagneuses de Banska Bystrica. C’était simplement en allant prendre un verre.  J’ai 21 ans et je suis étudiant à l’université de Reims. Cette année, je suis passé en licence, et j’ai eu la possibilité d’effectuer un séjour Erasmus de deux semestres dans un des pays européens de mon choix. Avec trois copains, on a décidé d’effectuer ce séjour d’études ensemble. D’emblée, on a écarté l’Espagne, l’Italie ou la Belgique, car on souhaitait vivre une expérience totalement dépaysante. Ma filière, Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives), organise un partenariat avec la Slovaquie depuis plusieurs années et ça nous a parlé. En plus d’être originale, la destination était à la portée de nos petites bourses. On est donc parti à l’université en septembre 2016 à l'université Matej Bel à Banska Bystrica, une petite ville de 80.000 habitants au centre du pays. Parce que je suis noir, les gens me regardaient curieusement Au premier semestre, tout s’est bien passé. On a vécu la vie de tous les étudiants Erasmus : pas mal de sorties, de fêtes, et des visites du pays car les voyages en train sont gratuits là-bas pour les étudiants. Assez vite pourtant, j’ai remarqué que les gens me regardaient curieusement : il faut dire que je suis noir, et qu’il y en a très peu. J’étais le seul là-bas parmi les vingt étudiants français de ma promo au premier semestre. Mes parents m’avaient mis en garde en disant qu’il y avait beaucoup de racisme dans les pays de l’est, mais je ne voulais pas trop y croire. Tous ces regards sur moi, je les sentais bien sûr, mais je n’y accordais pas beaucoup d’attention. J’avais entendu des drôles de choses, comme quoi un vieux Slovaque avait fait un salut nazi devant un pote belge noir dans un bar, mais je ne m’affolais pas. "He wants to kill you" Au début du deuxième semestre, le 11 fevrier dernier, on est sorti dans ce même café, le Ponarka, où on avait nos habitudes depuis plusieurs mois. Je m’installe au bar pour fumer une cigarette en attendant que mes potes me rejoignent. À côté de moi, un mec, la quarantaine, assez petit et costaud, le crâne rasé, m’interpelle bruyamment en slovaque. Comme je ne comprends pas le slovaque et que j’ai l’impression qu’il est bourré, je l’ignore. Un client au bar me traduit alors en anglais ses paroles : "He wants to kill you." ("Il veut te tuer" en français) Je continue à fumer ma cigarette sans réagir et sans le regarder. Tout de suite après, j’entends un bruit de verre brisé et je me prends un violent coup sur la joue. Je me débats, j’essaie de me défendre. Mais j’ai beau faire 1m95, je suis plus fluet que lui. Pendant plus d’une minute, avant que des clients du bar l’écartent, je ne sais plus où je suis. Je me retrouve finalement seul, en train de pisser le sang partout, le visage lacéré par un objet tranchant, sans doute une bouteille de verre cassée dont le type s’est servi pour me frapper. Je suis emmenée en ambulance et hospitalisé la nuit même. Il a fallu 38 points de suture pour refermer les plaies, ce qui m’a pratiquement défiguré. Je ne voulais pas rentrer
Je suis allé porter plainte avec mes amis dès le lendemain matin. Pendant mes deux semaines d’arrêt, j’ai sérieusement morflé. J’étais vraiment au fond du trou. Je n’ai pas compris ce qui m’était arrivé. Mes parents m’ont dit de revenir immédiatement. Moi, j’étais mitigé. Mais mes potes m’ont énormément soutenu. On s’est dit qu’il ne fallait pas que je rentre dans cet état, que ce serait les faire gagner en quelque sorte. C’est aussi après mon agression que j’ai appris que la région était gérée par un gouverneur néo-nazi depuis quatre ans [ndlr : du parti LSNS , Parti populaire-Notre Slovaquie] qui avait créé sa propre milice dans la ville. Un fief de néo-nazis Heureusement, dès que j’ai été en état de remettre un pied en dehors de ma chambre d’étudiant, j’ai reçu pas mal de soutien. Plusieurs personnes m’ont arrêté dans la rue pour me dire qu’ils me soutenaient, l’affaire ayant été assez médiatisée là-bas. La directrice de l’université slovaque m’a offert un cadeau, les gens de l’Alliance française ont aussi été très présents. Malgré tout, je n’étais pas toujours tranquille. En avril par exemple, la responsable Erasmus de l’université a posté dans notre groupe Facebook un message pour nous informer de la teneur d’un meeting neo-nazi à proximité de l’université et qu’il fallait, par prudence, emprunter un autre itinéraire. Ce jour-là, je suis resté dans ma chambre sans oser sortir. Il y a un mois, on a croisé quatre jeunes slovaques à une soirée. Quand on leur a dit qu’on était Français, ils nous ont parlé de Pétain ! La France était mieux quand il était au commande selon eux. Ils n’étaient pas agressifs et cherchaient seulement à discuter. Mais au bout d’un moment, ils nous ont sorti: "On préfère vous le dire : on est des néo-nazis. Et on aime pas votre façon de penser." Je suis vivant et c’est l’essentiel Mon année vient de se terminer et je suis rentré hier en France. Au bout du compte, je suis quand même content d’être allé au bout de mon semestre. Je tire malgré tout un bon souvenir de mon séjour Erasmus : j’ai voyagé en Pologne, en République Tchèque, en Hongrie, en Autriche… J’ai fait du ski pour la première fois de ma vie, du hockey sur glace, des randonnées dans des coins splendides. Je sais qu’il va falloir me faire opérer pour une reconstruction de mon visage, mais chaque chose en son temps. Je suis vivant et c’est l’essentiel. À quelques millimètres près, j’aurais pu perdre un œil. Quant aux futures échanges Erasmus dans la région, j’ignore si le partenariat va se maintenir dans les prochaines années. La seule chose que l’université de Reims m’a dit au moment de mon agression, c’est qu’ils étaient désolés, mais qu’il valait mieux pour moi que je reste là-bas, car sinon je n’allais pas pouvoir valider mon année de Licence…
0 Commentaires
Dans les années 1970, dans le cadre d’une convention signée entre la France et le Maroc, la SNCF a embauché environ 2000 Marocains, promettant de garantir "l’égalité des droits et de traitement" avec les employés français. En 2015, la SNCF a été condamnée aux Prud’hommes pour discrimination, après qu’environ 800 personnes ont déposé plainte pour discrimination. Les auditions en appel ont eu lieu cette semaine. Abdel E., 62 ans, revient sur son histoire. En 1973, j’avais 19 ans. Je vivais dans mon petit village du nord du Maroc, non loin de Tétouan, que rien ne m’incitait à quitter. J’avais une maison et la plage à proximité. Pourtant, j’avais envie de découvrir le monde. Dans un petit coin de ma tête, je me demandais comment c’était derrière la mer, là-bas, à une vingtaine de kilomètres. Je savais qu’il y avait l’Espagne, d’où venaient mes ancêtres. Ça piquait ma curiosité. "Paris, c’est le cinéma et les jolies filles !" Un soir, alors que je rentrais de la plage, j’ai vu que le chef du village m’attendait. On était en très mauvais termes, je me suis demandé ce qu’il me voulait. À l’époque, il aurait fait n’importe quoi pour se débarrasser de moi. "Tiens, j’ai un bon truc pour toi. Un contrat de travail à la SNCF, à Paris !" Je lui ai dit que je n’étais pas intéressé, il a pété les plombs. J’avais mon confort ici, je n’avais aucune raison de m’en aller. Mais en même temps, je commençais à comprendre que je ne pourrais pas y passer ma vie. Quinze jours après, j’étais dans le bureau du recruteur de la SNCF pour un entretien. On a fait une partie d’échec. J’étais nul aux échecs. Il m’a demandé si j’avais déjà travaillé. Évidemment que non. Il voulait juste vérifier que je comprenais ce qu’on me disait. Je n’étais pas très motivé, il l’a bien compris. Alors il m’a sorti le grand jeu : "La SNCF c’est bien, c’est Paris ! C’est le cinéma, les jolies filles, tout ça !". Un copain, qui était pressenti aussi, m’a dit : "Viens, si ça te plaît pas, tu reviendras." Du nord du Maroc à la gare de Lyon À l'été 1973, on est parti de Casablanca, on a pris le train à travers l’Espagne et la France. C’est comme ça que je me suis retrouvé gare de Lyon. Je suis monté au secrétariat, j’ai tendu mon papier d’embauche. La dame m’a regardé en me disant : "On n’embauche pas les mineurs, ici." C’est vrai que je faisais très jeune. Après vérification, on a signé les papiers. Les quarante-trois années qui ont suivi, j’ai travaillé pour la SNCF. Le premier jour, on m’a présenté un lit au milieu d’un dortoir à Bercy. On m’a dit que c’était le mien. J’ai commencé à pleurer. Moi qui avais toujours vécu dans une maison, j’avais soudainement l’impression de me retrouver en prison. J’ai protesté, demandé une chambre individuelle. Ils m’en ont trouvé une dans un foyer de travailleurs célibataires. Tout le monde picolait, vomissait dans les escaliers. Les problèmes ont commencé. Comme les gnous dans la jungle Je ne savais pas en quoi allait consister mon travail. J’ai commencé par faire trois mois de stage, ensuite j’ai été affecté à l’accrochage de trains. On était en plein hiver, il faisait froid, c’était vraiment très difficile. Ensuite, j’ai été affecté au tri du courrier à la gare de Lyon. Ça ne me plaisait pas du tout, je ne voulais pas rester là. Mes chefs s’en sont rendu compte, c’est comme ça que je me suis retrouvé finalement à la manutention. Le quotidien à la SNCF est devenu très dur. C’était comme dans la savane. Il y avait la grande plaine, les lions, les lionnes, les guépards, les loups et les gnous… qui nourrissaient tout le monde. Les gnous, c’était nous. On faisait le sale boulot, on se faisait engueuler pour un oui, pour un non. À un moment, j’ai craqué. J’ai posé ma démission, qu’ils ont refusée. Ils n’avaient pas envie que j’essaie de négocier mon départ. Ils étaient prêts à me laisser partir sans rien, mais j’avais deux enfants à nourrir. Donc je suis resté. SNCF la nuit, université Paris III le jour
J’ai tenu parce que j’ai commencé à avoir une vie, en parallèle de la SNCF. Dans mon village du nord du Maroc, on n’était pas très bons en français, on était plutôt en contact avec l’espagnol. J’ai donc décidé d’apprendre vraiment le français et de me payer des études. J’avais l’esprit vif, j’étais quelqu’un de très sociable, j’avais envie de rencontrer des gens. Au bout de trois ou quatre ans, j’ai passé les examens d’entrée de l’université tout en continuant à travailler à la SNCF. Je faisais partie de ce qu’on appelle "la réserve". Je travaillais volontairement la nuit, les week-ends et les jours fériés, pour pouvoir aller en cours le jour. Je ne partais pas en vacances non plus. Physiquement, c’était très dur. Les profs me disaient qu’ils n’avaient jamais vu ça. 13 ans plus tard, un doctorat À Paris III, j’ai commencé par suivre un cursus de civilisation du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ensuite, j’ai soutenu une maîtrise en analyse du discours et sociolinguistique appliquée à l’histoire. Puis, j’ai réussi à entamer des recherches doctorales et reçu la nationalité française. Ça m’a pris treize ans, mais j’ai fini par soutenir ma thèse, en 1992. J’en suis sorti littéralement épuisé. Menant de front ma vie à l’université et mon travail à la SNCF, je n’avais plus de forces. À Paris VIII, où j’avais été transféré entretemps, j’ai fait la connaissance d’un linguiste qui voulait me proposer un poste d’assistant, à la condition que je publie un livre en amont. Le problème, c’est que je vivais vraiment au jour le jour, je n’avais ni le temps, ni l’argent pour me le permettre. Il fallait que je puisse subvenir aux besoins de mes enfants. Je ne pouvais abandonner ni mon salaire, ni ma protection sociale. Je me suis retrouvé coincé. "Vous n’êtes pas là pour être cadre" Entretemps, la SNCF a signé des contrats avec les pays du Golfe. Naïvement, j’ai écrit un e-mail à Guillaume Pépy en lui disant qu’avec mon excellent niveau d’arabe, j’étais disposé à accompagner ou encadrer les ingénieurs sur place. Je voulais sortir de mon quotidien de galères et de brimades. Mon e-mail a été transféré à la directrice régionale, qui m’a dit de "faire reconnaître mes diplômes". Le seul diplôme que j’avais, c’était un doctorat de l’université française, dont les photocopies certifiées finissaient à la poubelle : "Vous n’êtes pas là pour être cadre." Je me suis donc retrouvé à former des gens amenés à devenir mes supérieurs hiérarchiques. Ils avaient beau faire des erreurs, je n’avais soudainement plus la possibilité de me faire entendre parce que j’étais sous leur autorité, ou parce qu’ils trouvaient des soutiens autour d’eux. Quand j’ai obtenu la nationalité française, j’ai demandé à être intégré à la SNCF avec un statut de cheminot. En vain. Ça ne les a jamais empêché de me faire rester la nuit jusqu’à pas d’heure quand un train arrivait en retard, ou de me demander de gérer des erreurs d’aiguillages avec les moyens du bord. Chaque jour apportait son lot de mauvaises surprises. J’ai failli tout envoyer balader Je me suis demandé comment une entreprise d’État pouvait organiser la ségrégation entre ses employés. Un jour, j'ai eu un accident du travail. Je me suis rompu les ligaments croisés. Je me suis retrouvé devant le médecin du travail de la SNCF, qui m’a regardé en me disant : "Moi monsieur, je soigne les cheminots". N’ayant pas le statut de cheminot, je ne pouvais le consulter en dehors d’une visite d’aptitude. Non seulement je ne bénéficiais pas de la couverture sociale spécifique des cheminots, en plus, je n’avais pas accès aux infrastructures de soin de l’entreprise. J’ai vraiment failli tout envoyer balader, surtout pendant les dix dernières années. À la SNCF, les emplois sont répartis en catégories qui vont de A à H, de la base au sommet de la pyramide hiérarchique. A, B et C correspondant au collège dit "exécution", D et E au niveau maîtrise, F, et H, les cadres. J’ai demandé un certificat de travail à la SNCF (le résumé de mes affectations depuis 1973). Je n’ai rien compris de ce que j’ai lu, ça ne correspondait pas à la réalité des postes que j’avais tenus. Même si j’avais travaillé comme maîtrise ou cadre, j’étais payé en B. J’ai rarement gagné plus de 1500 euros par mois. J’ai bien essayé de me syndiquer, mais ça n’a pas duré longtemps. Un jour, on m’a dit que les gens comme moi "ne devaient pas prétendre à avoir les mêmes droits que les autres". J’ai rendu ma carte directement. Je ne pensais pas que je tiendrais jusqu’à la retraite J’ai quitté la SNCF il y a deux ans. Jamais je ne me serais cru capable de tenir jusqu’à la retraite. Il y a trois ou quatre ans, j’ai entendu par des collègues dans la même situation que moi qu’une plainte était en train de se former. J’ai décidé de constituer un dossier. Pas que j’avais un quelconque espoir de toucher quoique ce soit, je voulais simplement faire du bruit. Que les gens se rendent compte de la situation. Je ne pensais pas que la justice nous écouterait, j’étais assez désespéré. En 2015, le dossier est passé devant la justice. Quand la SNCF a été condamnée, je me suis dit : "Enfin, il reste un peu de justice dans ce pays." Après, l’entreprise a fait appel. Ça m’a remis un coup, je pensais que l’État allait mettre tous les moyens pour se protéger. Aujourd’hui, j’ai de l’espoir parce que je pense qu’on a réussi à montrer l’absurdité de nos histoires devant la cour d’appel. J’ai beau avoir passé quarante-trois ans de ma vie à travailler pour la SNCF, l’expérience a été si désagréable que j’ai beaucoup de difficultés à me souvenir de ce que j’ai fait là-bas. Aujourd’hui, je regrette d’y être resté. Si j’avais eu de l’argent, j’aurais continué dans la voie universitaire. Seulement, c’est trop tard. Je ne m’attends pas à toucher une somme mirobolante. Si jamais je devais avoir quoique ce soit, une bonne partie irait aux impôts et à nos avocats. Le reste sera pour mes deux petits-enfants. Mon bonheur, c’est eux. Moi, je n’en ai plus rien à foutre, j’ai déjà perdu ma vie. La magie de Cannes " je vais monter les marches de Cannes pour mon premier rôle au cinéma"5/22/2017 Premier casting, premier rôle principal, premier festival de Cannes…. Noée Abita, tout juste la majorité et encore au lycée, fait un parcours sans faute cette année dans le monde du cinéma. Elle joue le rôle d’Ava, une jeune fille de 13 ans malade, qui apprend qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Le film est en compétition officielle à Cannes. Pour la toute première fois de ma vie, je vais avoir la chance de présenter un long-métrage durant le célèbre festival du film. Je m’appelle Noée Abita, j’ai 18 ans, je suis lycéenne en terminale littéraire à Paris. Il y a quelques mois, j’ai décroché le premier rôle dans le film de Léa Mysius : "Ava". C’était la première fois que je jouais. Je n’ai jamais pris de cours de théâtre. Petite, j’ai toujours rêvé d’être comédienne. Je me voyais jouer dans des films… J’apprenais des répliques par cœur, que je récitais dans ma chambre. Ça m’a toujours attirée. Je me disais qu’un jour ou l’autre, il faudrait bien que je tente ma chance même si, je me disais que ce ne serait pas réalisable, ni véritablement possible. "Ava", c’était mon premier casting Avec Sara, une amie, nous avions un copain qui nous a donné le nom de son agence. Nous y sommes allées, elle nous a proposé un casting directement. On s’était un peu préparé, mais on n’imaginait pas être prise. On était surtout surexcité. C’était très sympa. On a parlé de nous, de notre vie d’interne, nos goûts. Après l’entretien, on a joué la scène chacune notre tour. J’étais un peu stressée au début, mais très vite plus détendue. Le film parlant d’une fille qui perd la vue, on m’a bandé les yeux. Léa voulait voir comment je me déplaçais dans l’espace sans aucune vision, comment je touchais le visage de la personne en face de moi pour essayer de m’imprégner de ses traits, sa sensibilité… Les jours ont passé et je n’ai pas eu de nouvelles pendant une ou deux semaines. Je me disais que c’était plié. Mes premiers pas devant la caméra Le tournage du film a duré deux mois, d’août à septembre 2016. C’était génial. Pendant les essais caméra, j’étais très impressionnée. J’avais du mal à faire ce que Léa me demandait. Au fil du temps, ça s’est fait naturellement. Les deux mois de tournage ont été intenses. Il y avait seulement le week-end pour se reposer. Je suis quasiment sur tous les plans donc je tournais tous les jours de la semaine, je ne pouvais pas être absente. Il y avait une entente incroyable sur le tournage. L’équipe était gentille et bienveillante, c'est devenue une seconde famille. Une complicité s'est naturellement installée entre nous. Avec Juan Cano, l’un des acteurs principaux, la relation s’est construite fraternellement, sans aucune séduction ni jugement. Avec Laure Calamy – qui joue ma mère –, la relation était différente, mais on s’entendait très bien. Au retour du tournage, les professeurs sont devenus très difficiles avec moi, j’ai des remarques constamment et la pression s’est accentuée. J’ai hâte de passer mon bac pour que cette situation se finisse. Je n’ai toujours pas vu le film en entier À Cannes, ce sera ma première fois. Je n’y suis jamais allée. Je suis très contente mais un peu méfiante. C’est un sentiment bizarre car j’y vais à la fois pour présenter un film, mais également en tant qu’observatrice, découvrir cet univers et se faire sa propre idée des choses. Finalement, je ne connais pas tellement le monde du cinéma. Ce qui est sûr, c’est qu’on a un programme très précis. Il y a la projection du film en compétition à la Sem aine, et toutes les interviews avec plein de médias. Je n’ai pas vu la version finale d'"Ava" mais le peu que j’ai vu, j’en suis super contente. Depuis, j’ai passé d’autres castings, je tourne actuellement dans "Le Grand bain" de Gilles Lellouche. J’ai un autre rêve... J’ai vraiment envie d’ouvrir ma propre école, une école avec une autre pédagogie ; on appelle ça une école Steiner. J’espère vraiment pouvoir le faire un jour. Après le bac, je vais essayer de rentrer dans un conservatoire d’arrondissement pour me préparer au national. Je suis en rehab. Fin 2016, j’ai pris la décision de ne plus être sur aucune application de rencontre. J’ai décidé de faire le test ultime, de donner une chance à la «vraie» vie et de voir si les astres pouvaient, un jour, être enlignés ailleurs qu’à 1.2 km de chez moi ou trois heures du matin un samedi soir. Tinder est apparu dans la vie des gens en 2012 et Grindr (pour les hommes gais et bisexuels) en 2009. Quand j’ai dit «fuck off» en décembre dernier, cela faisait donc respectivement cinq et huit ans que j’étais sur ces révolutionnaires applications de l’amour. Presque une décennie à magasiner des dudes comme on magasine un T-Bone et à me faire swiper à gauche ou à droite comme une page de la circulaire du Provigo. Se sentir spécial tsé. Car qu’on se le dise, durant toutes ces années de «dating» en ligne, les bons coups sous la couette se comptent sur mes dix doigts et les dates mémorables sur une seule main. Faites le test et effacez les contacts de gars ou de filles qui se sont accumulés dans votre téléphone et vous allez être surpris par l’absence de souvenirs que vous avez de ces supposés coups de foudre virtuels. Certes j’ai eu des flirts, frenché ma vie, rencontré des gars intéressants et je me suis même fait de merveilleux amis qui sont toujours dans ma vie, mais chose certaine, la constance de la qualité sur ces applications est comparable à celle d’un food court de centre d’achats. Je dis que je suis en rehab car c’est ainsi que je me sens. Même si je sais que c’est la bonne décision, ça fait cinq mois que je ressens qu’il me manque tout de même quelque chose, un sentiment superficiel d’exister ailleurs que dans mon cercle d’amis. Ça sonne vide et narcissique je sais, mais détrompez-vous, c’est bien plus profond que ça dans le fond. Ça en dit surtout très long sur l’importance qu’on accorde au regard des autres et à la valorisation instantanée qu’on cherche à coup de likes, de hashtag et de matchs Tinder qui mènent nul part. Je me suis dit «Vas-y mon Jord, lance-toi. Lâche ton téléphone, va prendre des cafés, souris aux gens, présente toi et fais ce que t’as jamais fait ou plutôt que tu ne fais plus depuis belle lurette, soit connecter avec le monde, le vrai.» Je me suis dit ça oui. Non seulement rien de tout cela ne s’est produit, préférant «Netflix and chill» avec mon chat que le café au coin de la rue, mais plus tristement, j’ai réalisé que je ne savais plus comment draguer sur le terrain. Or, j’ai déjà été bon «là dedans», usant de ma répartie et de mon sens de l’humour qui, malgré mon surplus de poids, me permettaient de faire valoir autre chose que mon meilleur profil cadré en haut des épaules et modifié sur Instagram avec le filtre Valencia. J’ai réalisé que Tinder, Grindr, Bumble, Happn, Hornet, Scruff et autres applications de «rencontres» ont créé autour de chacun de nous une bulle de verre très difficile à briser et ont, au fil du temps, vicieusement modifié nos interactions sociales et sont venues «fucker le chien» dans la confiance en soi de générations entières. Je suis dans un café, je respire durant quatre heures le même Co2 que la potentielle femme de ma vie assis à deux mètres de moi, mais au lieu de lui payer un latte ou de lui faire un sourire comme dans «le bon vieux temps», je préfère le chercher sur Facebook comme un enragé durant 2 semaines et réciter un chapelet en entier dans l’espoir de la recroiser. Comme probablement plusieurs d’entre vous, je fige devant une date potentielle, je baragouine, je deviens sot et gêné. Mais n’est-ce pas ça dans le fond la beauté des premiers échanges, soit vaincre sa peur de briser la glace et de se présenter, avec toutes les erreurs de débutants que l’on peut faire, se dévoilant ainsi pour vrai, en 3D et en entier ? J’ai beau le penser, je n’y arrive pas.
J’ai assurément depuis décembre, plus de temps pour lire le dernier prix Goncourt ou me taper tous les épisodes de 13 reasons why en rafale, mais reste que de retour à la maison, l’envie de ne pas être seul revient, inlassablement. Cinq mois plus tard, je me rends compte que d’avoir décidé de ne plus dater en ligne ne m’a pas ouvert aux autres, ne m’a pas forcé a faire les choses différemment et n’a pas mis sur mon chemin une belle brune dans l’allée trois de la pharmacie. Ce sevrage nécessaire m’a plutôt rappelé violement que je ne sais pas cruiser sans wifi, que ma sexualité dépend de ma géolocalisation et que le choix de ma photo de profil détermine si je suis «en spécial» ou si je «vaux le prix régulier». J’arrive au constat que si je veux coucher avec quelqu’un, dater quelqu’un, tomber en amour avec quelqu’un, vivre quelque chose avec quelqu’un, bin ce quelqu’un là est sur internet. Plate de même. Vais-je rechuter et me refaire un profil et recommencer à swiper jusqu’à m’en fouler le pouce ? Je ne sais pas. Probablement en fait. Je sais cependant que l’été s'en vient, que le parc Laurier sera plein à craquer et que j’ai encore quelques semaines pour me pratiquer à sourire devant le miroir de la salle de bain. Comment se fait-il que de lancer un «bonne journée» bien senti dans l’ascenseur du bureau devienne aussi tough que de gagner Survivor? Que l’on fasse tout pour se connecter à son intériorité en lisant Mange Prie Aime, en allant au yoga et en dépensant 120 «piasses» pour une séance de psy, mais qu’on ne soit pas capable d’endurer une dent croche sur le sourire sincère d’un gars sur Tinder ? Je me pose la question, mais je n’ai pas la réponse. Mon rehab est plus dur que prévu, je l’avoue. Mais comme tout toxicomane en manque de son «fix», je vis ça à un jour à la fois. Car dans le fond, quand on y pense, tout repose sur trois petits mots très simples au potentiel humain inestimable... « Salut. Ça va?» Jordan Dupuis La détention du pouvoir politique a longtemps été, dans les sociétés orientales ou occidentales, étroitement liée à la sphère religieuse. Cependant, ce fut principalement dans les civilisations orientales que cette fusion du politique et du religieux fut la plus précoce et profonde. L’une des caractéristiques des monarchies orientales antiques (et notamment en Egypte ou encore chez les Perses achéménides) étaient qu’elles divinisaient leurs souverains : ils étaient alors de vrais roi-dieux, d’où l’étonnement de certains auteurs grecs quant à l’adoration que certains rois perses exigeaient de leur peuple. En effet, les rois occidentaux, par opposition, n’avaient pas cette « double casquette » d’humain et de dieu. La double royauté lacédémonienne, les rois romains ou encore les rois celtes nous en donnent des exemples. Les rois occidentaux étaient par essences des aristocrates guerriers et des grands propriétaires terriens qui étaient élevés au-dessus des autres par leur prestige et leurs exploits guerriers. L’Odyssée d’Homère, l’un des textes fondateurs de la culture grecque et occidentale, est une mine de renseignement sur cette aristocratie guerrière et terrienne qui domina la politique occidentale pendant des dizaines de siècles. Le pouvoir était alors détenu par les guerriers les plus valeureux (Ulysse, Achille ou encore Nestor), qui passaient leurs journées à la chasse et à l’entrainement guerrier. Par leur valeur et leurs exploits, cette aristocratie s’enrichissait et pouvait ainsi posséder une vaste clientèle pour s’occuper de leur propriété foncière et des autres activités « non digne » de cette noblesse en échange de protection. Cette noblesse conquérante et guerrière est caractéristique des peuples indo-européens. On peut retrouver des traces de cette « orgueil » guerrier de l’aristocratie jusqu’à l’aube de la Révolution française. En 1788, l’abbé Sieyès écrivit ce fameux passage qui en disait long sur les origines supposées de la noblesse : « Le Tiers ne doit pas craindre de remonter dans les temps passés. Il se reportera à l’année qui a précédé la conquête ; et puisqu’il est aujourd’hui assez fort pour ne pas se laisser conquérir, sa résistance sans doute sera plus efficace. Pourquoi ne renverrait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d’être issues de la race des conquérants et d’avoir succédé à leurs droits ? ». Il pouvait paraître incroyable que la noblesse du XVIIIème siècle se réclame toujours de la race des conquérants Francs du Vème siècle et qu’elle légitime ainsi son pouvoir ! Et pourtant, cette façon de penser était caractéristique du vieux mythe de l’aristocratie guerrière, de la « race des conquérants », répandu dans l’ensemble de l’Occident et des peuples Indo-Européens. Les Spartiates étaient ainsi de la race des Héraclides, la descendance d’Héraclès, qui conquit le Péloponnèse dans l’Antiquité. Les Normands s’imposèrent comme l’aristocratie dominante après la conquête de l’Angleterre anglo-saxonne, les Prussiens firent de même après les épisodes des conquêtes des chevaliers teutoniques. Les exemples sont multiples et définissent ainsi la mentalité dans lequel se posait la noblesse occidentale, qui expliquait d’abord sa légitimité à exercer le pouvoir par son appartenance à la caste guerrière, conquérante et propriétaire terrienne. Dans l’orient antique, la légitimation du pouvoir était beaucoup plus complexe et possédait une facette religieuse et sacré qui était alors très peu présente en Occident. Le roi ou le pharaon était un dieu vivant, auquel on rendait un culte au même titre que les autres divinités des panthéons orientaux. Certes, son pouvoir gardait une dimension guerrière comme chez tous les peuples indo-européens avec le commandement des opérations militaires ou avec notamment la chasse au lion (animal noble par excellence) qui lui était réservée. Cependant, la dimension religieuse était l’un des points centraux de la différence entre les souverains orientaux et occidentaux dans l’antiquité : elle souligne une vision très différente de la place de l’égalité entre les hommes. Quelle surprise pour les Grecs ou les Romains de voir les Perses vouer un culte à leur Roi ! Dans ces civilisations où l’égalité (du moins hypothétique) entre les hommes/citoyens était un principe fondamental, que ce soit dans la République romaine ou dans la Polis grecque, on ne pouvait pas imaginer un homme vouer un culte à un autre, même si cet homme était le roi. Les Spartiates n’étaient-ils pas des Homoioi (Semblables/Égaux) qui mangeaient tous ensemble à la même table que leurs deux rois aux banquets (syssities) ? Les Romains n’avaient-ils pas chassé leur roi pour avoir violé l’innocente Lucrèce et ne louaient-ils pas l’humilité républicaine d’un Cincinnatus ? L’époque hellénistique et le règne d’Alexandre le Grand furent un véritable tournant dans cette conception du pouvoir politique pour l’Occident. En conquérant l’Empire achéménide et en repoussant les frontières de son empire jusqu’en Inde, Alexandre unit l’Orient et l’Occident pour la première fois et mélangea leurs cultures et traditions. Si Alexandre se considéra toujours comme un descendant de Zeus, cela n’avait aucune réelle importance aux yeux des Grecs. Nombreuses étaient les familles aristocratiques grecques ou romaines, ou même des cités entières, à établir une généalogie mythologique avantageuse. Les Rois de Sparte étaient ainsi les descendants d’Héraclès (comme tous les Homoioi). Jules César descendait lui de Vénus par Enée. Cela n’était guère plus qu’un artifice pour embellir une lignée ou l’histoire d’une cité, mais cela n’a aucune valeur politique ni ne donnait aucune légitimité à exercer un pouvoir quelconque dans le monde gréco-romain. Cependant, cette ascendance divine prit une grande importance dans le monde de la Méditerranée orientale, et un véritable culte à la personne Alexandre se mit en place. En effet, à l’oasis de Siwa, en Egypte, le nouveau pharaon Alexandre se fit confirmer par l’oracle de Zeus Ammon son ascendance divine. Dès lors, Alexandre construisit un véritable culte autour de sa personne, en reprenant ainsi les traditions orientales du Dieu-Roi. Son pouvoir était désormais autant dû à ses exploits guerriers qu’à sa propre divinité. Cette mutation de la légitimation de son pouvoir fut à l’origine de nombreux conflits avec ses plus fidèles généraux : en 327 av JC, Alexandre tenta d’imposer la proskynèse, rituel consistant à se prosterner complètement, front contre terre, devant un personnage plus important et traditionnellement, dans la culture Perse, devant le roi. Ses Compagnons (Hétaires), avec qui il avait été éduqué depuis l’enfance sur un modèle grec d’égalité, ne pouvaient accepter, en tant qu’hommes libres, de se prosterner devant le roi et d’en faire ainsi un sujet d’adoration. Alexandre dut se rétracter, du moins devant ses sujets grecs. Mais désormais, la nature du pouvoir avait radicalement changé en Occident, sous l’influence des royaumes diadoques issus de la succession du Conquérant. La proskynèse fut adoptée dans l’Empire Séleucide et les membres de la dynastie des Lagides, qui régna sur l’Égypte pendant des décennies, se firent diviniser comme les Pharaons d’autrefois. Cette divinisation du pouvoir se répandit en Occident latin grâce à l’Empire Romain qui prit l’habitude, à partir d’Auguste et sous l’influence de la culture orientale et hellénisée des royaumes diadoques, de diviniser les Empereurs défunts. En effet l’Empire Romain, en s’étendant vers l’Orient, absorba des populations de l’Orient hellénisé qui commencèrent à louer des cultes à l’Empereur comme ils avaient l’habitude de diviniser les détenteurs du pouvoir politique suprême ! Là aussi, cela parut étrange aux citoyens romains de voir un homme recevoir les honneurs divins dans des temples. Ce type de culte était en effet très éloigné de la conception très républicaine du pouvoir des Romains, mais peu à peu l’Empereur passa du statut de « princeps » (premier des citoyens) à celui d’un Empereur divinisé et sacré, notamment lorsque l’empereur Dioclétien introduisit la fameuse proskynèse en 291 ap JC à la place de la salutatio romaine traditionnelle. Cependant, la culture latine introduisit une distinction des plus importantes dans la nature des Empereurs. Les Empereurs étaient, à leur mort et après autorisation du Sénat, décrits comme « divus » (divin) et non « dius » (dieu) et ce « v » manquant était très important dans un Empire encore attaché à certaines valeurs républicaines. L’Empire fut donc la matrice d’une profonde refonte de la morale romaine, et plus précisément de la morale politique et républicaine des Romains. Le pouvoir des Empereurs fut de plus en plus légitimé par le fait religieux, ces derniers n’hésitant plus à se représenter sur des pièces de monnaie en compagnie de divinités solaires, d’égal à égal. La légitimation du pouvoir politique par une sphère sacrée et religieuse (qui lui était désormais rattaché en Orient comme en Occident) se renforça en Occident avec les Empereurs chrétiens et principalement les Empereurs romains d’Orient (puis Empereurs byzantins) qui se percevaient véritablement comme les lieutenants de Dieu sur Terre, dirigeant l’Empire des croyants, à vocation universelle. En effet, un problème apparut avec la christianisation de l’Empire : il était difficile pour les premiers Empereurs chrétiens d’être adorés comme Dieu et de se proclamer défenseurs de l’orthodoxie et du monothéisme dans un même temps.
Les premiers Empereurs chrétiens se déclarèrent ainsi « serviteurs de Dieu », afin de mettre fin à ce qui pouvait apparaître comme une idolâtrie païenne. Après la chute de l’Empire romain d’Occident, c’est l’Empereur d’Orient (futur Empereur byzantin) qui se posa comme le modèle des rois germaniques occidentaux dans leur conception du pouvoir. Elevé bien au-dessus des autres hommes, il était vénéré dans tout l’Empire comme un être d’une nature exceptionnelle. Les juristes voyaient en lui la loi vivante, et en lui conférant le pouvoir suprême, l’armée, le Sénat et le peuple ne faisaient que reconnaître la volonté divine qui s’exprimait à travers lui. L’armée du temps de Théodose le Grand prêtait d’ailleurs serment sur la Trinité « et par la majesté de l’empereur, lequel par décret divin doit être aimé par le genre humain, car en recevant le nom d’Auguste, il a droit à la fidélité due à un Dieu présent et corporel ». Les Empereurs byzantins étaient « élus par Dieu » ou « couronnés par Dieu » selon les épithètes officielles. N’était-ce pas un privilège impérial que d’avoir son portrait exposé dans les Eglises ? Il est difficile pour les modernes que nous sommes de concevoir ce lien qui était fait entre l’Empereur terrestre et Dieu, lien indissoluble qui faisait véritablement de l’Empereur le lieutenant élu par Dieu pour gouverner le royaume terrestre. On commença alors à parler d’un « droit divin » d’exercer le pouvoir. Cependant, ce même droit divin qui autorisait l’Empereur à exercer un pouvoir sur l’Empire, ne lui permettait pas de devenir un horrible tyran. On rattache souvent, dans nos démocraties libérales modernes et dans notre France républicaine, la concentration du pouvoir dans les mains d’un homme à une dictature injuste, à une tyrannie cruelle et liberticide. Loin de là, l’Empereur/Roi chrétien, rattachait aux droits qu’il tenait du ciel une responsabilité redoutable qui pesait sur lui. L’Eglise pouvait admettre la mission providentielle de l’Empereur et lui conférer à ce titre des honneurs et des privilèges qui l’élevaient au-dessus des autres Hommes, mais cela ne le rendait que plus strictement obligé de respecter les lois divines et, à travers son exemple, d’en imposer l’observation à ses sujets. La principale qualité exigée du Prince, à Byzance ou en Occident, était la justice et c’est par là qu’il était le véritable représentant de l’autorité divine. Le souverain juste est une vieille idée judéo-chrétienne avec l’image notamment du Roi Salomon. Cette notion chrétienne de justice, qui était désormais intrinsèquement liée à la notion de pouvoir, transforma la noblesse, qui devait désormais intégrer un idéal de justice à sa vie guerrière. Le noble n’était noble que dans la mesure où il se battait pour une cause juste, pour le Christ, le pauvre, les femmes et les orphelins et non plus pour sa richesse personnelle ou pour les exploits guerriers comme les aristocrates antiques. Cependant, ce portrait du Prince idéal qui punit et récompense selon le mérite de chacun, était loin de correspondre à la vérité des faits. Ainsi naquit la jurisprudence affirmant qu’il était légitime de ne pas obéir, et même de se révolter contre le mauvais Prince qui, « inspiré par le Diable, donne un ordre contraire à la loi divine. ». Ainsi pouvaient être légitimés les assassinats, les révoltes qui, même si elles touchaient un Empereur élevé à cette distinction par Dieu, n’étaient que le reflet que de la volonté divine de voir un nouvel Empereur prendre sa place. Dans l’Occident latin, cette vision du pouvoir se perpétua à travers les rois de France notamment, descendants des Empereurs Romains par Charlemagne, qui étaient sacrés et oints du Saint Chrême envoyé par Dieu à Reims : ils disposaient ainsi de pouvoirs surnaturels, comme la capacité de guérir les écrouelles. Ils étaient « par la grâce de Dieu, Roi de France » et ainsi lieutenants de Dieu sur Terre. Cependant, les monarchies occidentales n’allaient pas aussi loin que le culte impérial byzantin. Elles développèrent certes un fort lien entre la sphère religieuse et la sphère politique, mais jamais à un niveau équivalent à l’Empire byzantin. Cette légitimité religieuse du pouvoir prit fin avec les idéaux révolutionnaires, et les théories politiques des philosophes du XVIIIème siècle. Les Rois durent proclamer détenir leur pouvoir du peuple et non plus de Dieu, au risque de disparaitre. Finalement, ces idéaux des Lumières inspirés par l’élan philosophique de la Renaissance firent remonter à la surface des valeurs très antiques en Occident : égalité entre les Hommes, citoyenneté ou encore res publica. Benjamin Tonon Qu’ils travaillent auprès de Deliveroo, Foodora ou UberEats, les coursiers à vélo ne sont pas satisfaits par leurs conditions de travail. Le mercredi 15 mars, ils se sont mobilisés à Paris et à Lyon pour réclamer une revalorisation de leurs tarifs, mais aussi des contrats en bonne et due forme. Marc, 27 ans, livreur de repas à vélo, nous explique les raisons de cette colère qui gronde. En octobre 2016, j’ai commencé à livrer des repas en vélo à Lyon. C’est à la suite d’un long voyage réalisé en bicyclette que je me suis décidé : je voulais allier ma passion pour le deux-roues et la transformer en une activité rémunérée. Aujourd’hui, il s’agit de mon unique source de revenu.
Au départ, j’appréciais les libertés et l’indépendance que procure ce travail, mais plus les mois passent, et plus je réalise que nous, livreurs de repas à vélo, sommes en train de nous faire avoir comme des bleus. S'il m'arrive le moindre pépin, c'est pour ma pomme À 27 ans, je suis auto-entrepreneur et je suis lié par des "contrats de prestation" auprès de Deliveroo et Foodora. En réalité, ces "contrats" n’en sont pas dans la mesure où je ne dispose d’aucune garantie. Je n’ai ni congés, ni sécurité sociale, ni mutuelle de santé, ni assurance. Bref, je n’ai pas de réel statut et je vis avec une corde au cou. S’il m’arrive le moindre pépin, que je tombe malade ou que j'ai un accident, c’est pour ma pomme. J’aurais beau prévenir les plateformes, on me répondra simplement : "Bon rétablissement". Pour avoir plus de sécurité, j’ai décidé de souscrire à une assurance, même si ce n'est absolument pas une obligation. Hier, elle m’a été d’une grande utilité puisque je me suis fait voler mon vélo. En tant qu’auto-entrepreneur, je suis également prié de reverser chaque mois 25% de mes rentrées d’argent. C’est assez rageant de constater le nombre d’obligations que nous avons – comme celle d’avoir son propre matériel ou d’avoir des accessoires à l’effigie des marques – sans avoir de droits. J’ai bien conscience que notre profession est nouvelle, mais il est grand temps que les entreprises qui font appel à nous réagissent. Travailler 50 heures par semaine pour un Smic Quand j’ai débuté, j’ai été séduit par les primes proposées par UberEats et j’ai donc décidé de réaliser des courses pour eux. Mais très vite, quelques mois après le lancement de la plateforme, l’entreprise a réalisé qu’elle disposait d’une "flotte" de coursiers suffisamment conséquente. Résultat : les primes se sont réduites comme peau de chagrin et la plateforme a pu bénéficier d’une main d’œuvre à moindre coût. J'ai donc décidé d'arrêter. Actuellement, je livre pour Foodora et Deliveroo, mais là aussi, je dois faire preuve d’une certaine gymnastique puisque je dois m’adapter aux fonctionnements très différents de ces deux sociétés. Il n’existe aucune uniformité. Par exemple, Deliveroo propose des contrats entre 5,5 et 7,5 euros en fonction de la date de votre arrivée. Avec Foodora, je suis payé 7,5 euros par heure et 2 euros la course, mais les tarifs changent en fonction des besoins. Mes revenus sont très variables, car ils dépendent de mes créneaux horaires et des conditions tarifaires. J’ai calculé que pour gagner l’équivalent d’un SMIC mensuel, je dois travailler environ 50 heures par semaine. Il faut toujours s'adapter Pour être sûr de travailler, je dois systématiquement m’inscrire sur les plannings qui se remplissent en une heure seulement. Si je loupe le coche, tant pis pour moi. En règle générale, je travaille durant les créneaux du déjeuner et du dîner, c’est-à-dire entre 11 et 14 heures et entre 18 et 23 heures. Parfois, je suis néanmoins obligé de jongler entre Foodora et Deliveroo dans la même journée. Changer de tenue, penser à porter le bon t-shirt... S’adapter n’est pas toujours évident. À force, on s’y perd. Évidemment, il y a aussi la contrainte de ne pas avoir de congés. Décider d’être "off" une journée, c’est faire l’impasse sur la rémunération. Un vrai contrat et un peu de considération Aujourd’hui, de nombreux coursiers en ont marre de cette situation. Cela ne peut plus durer. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette mobilisation. Nous souhaitons que les entreprises de livraisons reconnaissent les collectifs et syndicats que nous avons mis en place. Nous voulons également participer aux négociations tarifaires et être concertés lors de la mise en place des plannings. Toutes ces avancées ne seront possibles que si nous obtenons la mise en place d’une nouvelle forme de contrat. Je crois que nos revendications ne sont pas si incroyables. Finalement, tout ce que nous demandons, c’est un peu de considération. Marc, livreur Un mythe à revisiter
La France, pays dit des droits de l’homme, est-elle porteuse d’une égalité exemplaire ? C’est à répondre à cette question que s’emploie Réjane Sénac, dans son ouvrage « Les non-frères au pays de l’égalité »* en analysant l’égalité « à la française » comme un mythe. De fait, analyser cette égalité comme un mythe, c’est examiner les enjeux contemporains des héritages conscients et inconscients du triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité ». Adopter cette démarche, c’est poser une question à la fois fondamentale et en angle mort : qui sont les frères et qui sont ceux qui ont été exclus de cette fraternité républicaine – qualifiés de “non-frères” ? Qualifier l’égalité à la française de mythe, c’est dire et dénoncer l’idéalisation d’un principe non réalisé. C’est aussi la comprendre comme une mythologie, dans le sens développé par Roland Barthes : c’est-à-dire comme révélant un univers de sens occulté et dépolitisé. Afin de lever le tabou sur le péché originel fraternel de la République française, elle interroge l’histoire, mais aussi la modernité des frontières entre les « frères » et les « non-frères ». Ainsi, malgré le fait que la République se définisse comme « une et indivisible », elle n’a cessé de classifier et hiérarchiser les citoyen.ne.s. Il apparaît donc nécessaire de déceler comment se manifeste aujourd’hui ce paradoxe républicain. Selon elle, les appels actuels à refaire fraternité pour répondre à la peur de la segmentation de la population, à sa “communautarisation », sont significatifs de la cécité d’une société française qui continue à prôner le lien et l’unité à travers un mot la fraternité, qui charrie une conception exclusive de la démocratie. La tentation d’une égalité sous conditions de performance La diffusion dans le débat public d’arguments tels que « les femmes font de la politique autrement », « plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, c’est une valeur ajoutée» ou « la diversité, c’est bon pour le business » relève-t-elle d’un pragmatisme efficace et bienveillant à l’égard des non-frères ou d’une idéologie conservatrice reconfigurée dans une apparence plus respectable ? Réjane Sénac répond à cette interrogation à travers l’étude de rapports, de discours, et d’enquêtes qualitatives portant sur les justifications publiques des politiques d’inclusion des « non-frères » – la promotion de la parité pour les femmes et de la diversité pour les « non-blanc.he.s ». Elle teste ainsi l’hypothèse de la modernisation croisée du mythe de l’égalité et de la complémentarité des non-frères. Selon elle, la dimension pragmatique de l’injonction à la performance de la mixité ne doit pas occulter son caractère politique. Dans un contexte de crise et de défiance, la tentation est forte de porter les politiques d’égalité comme un investissement social, sans prendre conscience que l’égalité s’en trouve sacrifiée à la démonstration de la performance de la différence comme valeur moderne et pragmatique. Pour dépasser cette tentation, Réjane Sénac analyse la continuité entre un processus historique qui a exclu les « non-frères » au nom de leur prétendue « moins-value » naturelle (cf. les arguments justifiant l’exclusion des femmes du droit de vote) et l’inclusion qui leur est aujourd’hui proposée en raison de la performance de la mixité. Elle montre comment et pourquoi il est rhétorique de croire que la fin justifie les moyens sans considérer que les moyens déterminent la fin. Le temps de la résistance : Libérer l’égalité de la fraternité et du marché La justification des politiques d’égalité par l’argument de la performance de la mixité ou de la lutte contre les discriminations soulève en effet, selon elle, des interrogations en termes de rigueur scientifique, de portée idéologique, et de conséquences concrètes. Les implications pratiques de ce type de justification sont de deux ordres. D’une part, quand la performance de la mixité est démontrée, les non-frères sont inclus comme complémentaires et non comme égaux. D’autre part, si la performance de l’égalité ou de la lutte contre les discriminations n’est pas démontrée, l’égalité deviendra une option irrationnelle. Ainsi, d’après Réjane Sénac, au lieu de sacraliser la fraternité et de vouloir la refonder, le moment est venu de la révoquer parce qu’elle est excluante. Il est en effet indispensable de penser une alternative pour porter une société de non-domination aussi bien au niveau individuel que collectif. Pour cela, le temps de la résistance est venu.: une double résistance qui demande de libérer l’égalité de la fraternité et du marché. En savoir plus sur le livre de Réjane Sénac « Quand naissent les blessures et humiliations de l’être, les frustrations et désillusions de la vie, la force du désir individuel, outrepassant la mesure, se fait l'autre de la raison : alors la vengeance devient désir furieux, à l'origine de représailles punitives et belliqueuses. » Raymond Verdier, Vengeance Définitions La notion de vengeance fait partie de ces concepts dont on croit savoir à quoi il se réfère, mais dont on ne saurait précisément définir sa nature, son origine et ses aspects éthiques. Lorsque l’on pense à la vengeance, une autre notion apparaît de fait : celle de la revanche. Or, ces deux concepts sont bel et bien distincts. S’ils sont issus de la même racine étymologique - du latin vindicare, réclamer justice -, une variante s’opère dans le sens commun donné à ces deux concepts, et une distinction majeure apparaît lorsque l’on étudie la notion de vengeance à travers différents prismes, notamment religieux et antique. Dans ses acceptions communes, la revanche est : 1) « l’action de rendre la pareille pour un mal que l’on a reçu » (Dictionnaire Larousse) et 2) la « seconde partie que l’on joue pour donner au perdant la possibilité de gagner à son tour » (Dictionnaire Larousse). Des similitudes et différences peuvent être notées en comparaison de la définition de la vengeance : « action de procurer la réparation d’une offense en punissant l’auteur » (Dictionnaire Larousse). La vengeance est donc issue d’une offense reçue, à distinguer d’un mal. L’offense est une injure, c’est-à-dire qu’elle trouve sa racine dans une mise à mal de l’égo ou de l’honneur, alors qu’un mal est bien plus général et recouvre différents champs. La vengeance implique alors un châtiment, a contrario de la revanche qui « rend la pareille ». Cela signifie que la mesure de la punition infligée est subjective - elle dépend de la libre appréciation de l’offensé - et non pas objective comme l’est celle de la revanche - où elle est l’égale du mal reçu. Si la définition de la vengeance se différencie de la première définition de la revanche, il y a cependant de nombreuses similitudes avec la seconde. La vengeance n’est donc pas tout à fait la revanche : elle se veut subjective et dépendante de la libre-volonté de l’offensé, alors que la revanche est davantage objective et indépendante. Aspects du concept de vengeance dans l’Antiquité gréco-latine La vengeance est un concept très ancien, il paraît donc juste de l’étudier dans un premier temps à la lumière de l’Antiquité gréco-latine. Celle-ci était même personnifiée, ou plutôt déifiée, en la divinité Némésis, déesse de la juste colère des dieux et de la rétribution céleste - à cet égard, une comparaison avec l’Epître aux Romains rédigée par l’apôtre Paul sera faite dans la section dédiée au christianisme. Les mythes liés à cette déesse nous en apprennent en effet un peu plus sur ce qu’est la vengeance. Entre autres, celui du rituel “Nemesia“ à Athènes. Selon Sophocle (Electre), les morts avaient la puissance de punir les vivants si leur culte avait été négligé. Dans cette optique, les Athéniens rendaient hommage aux morts par cet office particulier attribué de manière latente à la déesse de la vengeance, Némésis. Les conséquences de l’utilisation de la vengeance par l’homme sont donc manifestes. En premier lieu, elle s’avère être néfaste, voire destructrice, pour l’homme. Au-delà du rituel sus-cité, Hésiode, en référence à la déesse de la vengeance Némésis, écrit dans sa Théogonie qu’elle est le « fléau des hommes mortels ». Dès lors, elle est vengeresse de crimes, elle est implacable, et on ne peut y échapper (d’où son surnom Adrastée). Plus communément, la vengeance est à double-face pour l’hybris de l’homme : elle est à la fois, bien souvent, 1 catalyseur de cette caractéristique propre aux héros, et à la fois punitive sous l’aspect divin. En effet : 1. La vengeance est action de l’hybris de l’homme, car le héros antique, dans l’ivresse de réparer l’injure qui lui a été faite, dépasse sa condition d’homme pour tenter de se hisser à une condition divine, proportionnelle au châtiment qu’il souhaite infliger. Par exemple, Enée, chanté par Virgile (Enéide), lorsqu’il venge ses compagnons d’armes. 2. La Vengeance - dans son aspect divin, sous Némésis ou les autres dieux - punit précisément cet hybris, au sens où le héros est remis à sa place de mortel, comme en témoignent les nombreuses tragédies d’Eschyle. D’ailleurs, pour reprendre une définition du dictionnaire d'Anatole Bailly, Némésis était « la déesse de la justice distributive, qui châtie l'excès de bonheur ou d’orgueil [hybris] ». En second lieu, et cela fait partie des paradoxes de la vengeance, elle était également considérée comme positive à Rome. Némésis était souvent vénérée par les gladiateurs victorieux ainsi que par les généraux. Pour plus de renseignements sur la vengeance dans l’Antiquité, l’excellente analyse de Évelyne Scheid-Tissinier dans Les Régulations sociales dans l’Antiquité permet de comprendre plus en profondeur ce concept. Aperçu de la vision chrétienne de la vengeance Comme cela est écrit plus haut, la vengeance était d’aspect divin dans l’Antiquité. Mais il en est de même dans le christianisme. Tolstoy commence son chef-d’oeuvre Anna Karénine - figure de la vengeance féminine étudiée plus tard - par cet épigraphe extraits de l’Epître aux Romains de l’apôtre Paul : « C’est à moi que la vengeance appartient, dit le Seigneur. C’est moi qui rétribuerai. » (« Mihi Vindictam Ego Retribuam » en latin). Ce qui est intéressant ici est moins l’attribution à Dieu de la capacité de venger - que l’on retrouve dans l’épisode biblique de l’Arche de Noé par exemple - que le caractère exclusif de la possession. En effet, cela sous-entend que l’homme n’a pas le droit de venger. Dans le Lévitique (troisième des cinq livres de la Torah) il est d’ailleurs écrit : « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel. » Même la vengeance aveugle vis-à-vis d’un meurtrier est proscrite : dans la Genèse, alors que Caïn a tué son frère Abel, « le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue pas » afin qu’Abel ne soit pas vengé par un mortel soucieux de réparer le tort fait à Abel. A cette interdiction de vengeance est donc logiquement associée la punition si cette règle est outrepassée. L’aspect punitif par les instances divines est donc commun entre l’analyse de la vengeance à travers l’Antiquité gréco-latine et celle du christianisme. Toujours dans l’épisode du meurtre d’Abel par Caïn, Dieu s’exclame au moment où il se rend compte du crime commis : « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu travailleras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » (Genèse, 4.1-15). Ainsi la vengeance selon le christianisme est-elle divine - elle appartient à Dieu -, exclusive - à lui seulement -, et punitive - un châtiment est réservé à l’homme qui enfreint la règle. Deux paradoxes psychologiques de la vengeance D’un point de vue passif, le paradoxe du spectateur de la vengeance. Il y a un certain plaisir à vivre une vengeance par procuration - alors que celle-ci est proscrite - : les tragédies grecques, où s’opèrent la catharsis, en sont les plus dignes exégètes. Prenons, pour illustrer, la tragédie Les Perses d’Eschyle, écrite après les victoires grecques de Salamine et de Platées. Elle peint la victoire inespérée des Grecs sur leurs ennemis de toujours, les Perses, lors de la deuxième guerre médique. C’est une véritable vengeance de la part des Grecs, après avoir essuyés de nombreux affront de l’empire perse. C'est donc en vivant cette vengeance par procuration qu’a lieu la catharsis (« purgation des passions ») en jouant avec les émotions des spectateurs. La trame, les faits et la narration fascinent les spectateurs, alors que la souffrance des Perses les réjouit. D’un côté, cette souffrance représentée et imaginée est repoussante et amorale, mais, d’un autre côté, le spectateur a un intérêt personnel à cette contemplation, comme l’explique Luc Boltanski dans La souffrance à distance - Moral humanitaire, médias et politique (1993) : « Adoptons maintenant la place du spectateur. Soit un spectateur contemplant à distance un malheureux qui souffre et qu’il ne connaît pas, qui ne lui est rien, ni parent, ni ami, ni même ennemi. […] Celui qui observe la souffrance d’autrui sans indifférence et sans lever le petit doigt pour la soulager s’expose à l’accusation de regarder pour son propre compte, par intérêt, parce que ça l’intéresse, ou même par plaisir. » D’un point de vue actif, le paradoxe de la maîtrise de la vengeance. En effet, s’interroger sur sa dimension psychologique, c’est indéniablement s’interroger sur la place qu’elle occupe au sein du duo nature / culture de l’homme. Mais elle trouverait son origine ni exclusivement dans l’une, ni dans l’autre, mais puiserait sa source dans les deux. Concernant l’ancrage dans la nature de l’être humain, les neurologues pensent que le cerveau humain trouve du plaisir à la vengeance, tout comme il en ressent lors d’une addiction. Selon Michael McCullough, professeur de psychologie à l’Université de Miami, le concept de vengeance est profondément ancré dans l’évolution (Beyond Revenge : The Evolution of the Forgiveness Instinct, 2008). Pour autant, si elle s’ancre en partie dans la nature de l’homme, comment se fait-il qu’il lui est si difficile de la maîtriser (culture) ? En effet, la vengeance est bien souvent connotée négativement, mais quand vient le moment de la refouler, l’homme témoigne d’une grande faiblesse. Ce qu’explique Michael McCullough : « Avec tout [ce que nous savons], pardonner semble être la chose raisonnable à faire. Mais c’est dur. Il est facile de confondre pardon et faiblesse, et c’est la dure réalité de notre univers social d’aujourd’hui : l’inaction est facile à confondre avec un manque de courage. »2 Une des explications données à ce paradoxe : la satisfaction personnelle que procure la vengeance. Tolstoy, Dostoyevsky, Kafka : la vengeance en trois plumes Le thème de la vengeance est plus que jamais présent dans la littérature. Cependant, des aspects originaux de la vengeance, qui sortent des sentiers battus (comme la vengeance passionnelle, la vengeance romantique, etc), ont pu être traités par Dostoyevsky, Tolstoy et Kafka. D’abord, l’écrivain russe du XIXe siècle Fyodor Dostoyevsky avec son roman Les Carnets du Sous-sol. Il s’agit ici de vengeance maladive. Par vengeance maladive, il faut entendre celle qui nous ronge de l’intérieur, qui change notre être, qui devient profondément personnelle et que l’on ne peut guérir sans opérer un travail sur soi d’une grande ampleur. Bien souvent, elle sévit sous le joug de l’irrationnel, et elle ne peut être comprise par n’importe qui d’autre. Voici ici la brillante analyse de Nikola Milosevic dans Nietzsche et Strindberg : psychologie de la connaissance, à propos de la vengeance maladive du héros du roman de Dostoyevsky : « Le héros de l’Esprit souterrain tourne et retourne cette offense pendant des années, en cherchant à se venger, mais sans avoir assez de force pour en tirer vengeance. Il suit son tortionnaire, découvre son adresse, écrit une satire dont cet officier est le protagoniste et le comble de sa vengeance est que, après une série de tentatives manquées, il refuse de reculer devant lui dans la rue. Et, à la veille de cet « exploit » qu’il envisage d’accomplir, le héros de Dostoyevsky ne dort pas pendant deux ou trois nuits en attendant « le règlement de comptes » imminent. » Ensuite, son compatriote Tolstoy à travers son oeuvre Anna Karénine, où il s’agit, dans une certaine optique, de refus de vengeance. En effet, pour Tolstoy : « Ne vous préoccupez pas de la vengeance lors de votre vie : deux torts n’ont jamais donné un bienfait. » Il s’attache d’ailleurs à suivre la morale chrétienne : peu importe à quel point Anna Karénine est coupable (d’adultère notamment), ce n’est pas à nous de la condamner, mais à Dieu. En ce sens, ceux qui se sont senti, dans le roman, offensé ou humilié par Anna Karénine n’ont pas à se venger d’elle ; de même, le lecteur n’a pas à la blâmer pour son comportement qui va à l’encontre des moeurs russes de l’époque. Le refus de la vengeance, pour Tolstoy, est le début de l’acceptation du pardon. Enfin, Franz Kafka et Le Procès, qui est remarquable dans notre étude pour l’impossibilité de la vengeance. Il s’agit, peut-être, de l’un des pires aspects de la vengeance pour l’offensé : l’impossibilité de la réaliser, c’est-à-dire l’incapacité de réparer le tort et de punir en retour. Le thème de la vengeance n’est quasiment presque jamais associée à cette oeuvre de Kafka par les spécialistes ; cependant, à mon sens, on peut en faire une lecture assez intéressante qui met en lumière cette notion d’impossibilité de la vengeance. L’acharnement de la Justice et des huissiers, décrit par Kafka, envers le héros K. est le reflet d’une atrocité éthique et psychologique absolument abominable. K. est donc torturé, au sens littéral, moralement - voire physiquement, si on prend en compte l’épuisement physique du héros, qui est manifeste dans l’oeuvre, pour échapper des griffes de cette Justice injuste. En plus de cela, la vie de K. est ruinée. Compte-tenu de toutes ces données, il apparaît tout à fait légitime - nous reviendrons plus tard sur ce terme lorsqu’il est associé à la vengeance - que K. aspire à se venger de cette Justice inique. Cependant, Kafka décrit avec brio l’impossibilité de K. d’agir de quelques manières que ce soit envers cette Justice invisible et inatteignable : il est condamné à s’y soumettre et à accepter sa condition sans pouvoir se venger, tel Sisyphe condamné à pousser sa pierre au sommet pour l’éternité sans autre action possible. Petite histoire de la vengeance institutionnalisée Ce qui est frappant à propos de la vengeance, c’est qu’elle était, d’une certaine manière, institutionnalisée au sein des premières sociétés, avant qu’elle ne soit progressivement refoulée et vue d’un mauvais oeil - du moins en apparence - dans le monde contemporain. La Loi du Talion est l’une de ces premières formes institutionnelles de la vengeance ; elle consiste à « rendre la pareille », notamment pour éviter toute escalade de violence. Déjà, « les premiers signes de la loi du talion sont trouvés dans le Code de Hammurabi, en 1730 avant notre ère, dans le royaume de Babylone » (Wikipédia), mais on la retrouve aussi chez Eschyle dans ses Choéphores : « Qu’un coup meurtrier soit puni d’un coup meurtrier ; au coupable le châtiment. » Dans une optique religieuse, elle est présente aussi bien dans le judaïsme (« Ton oeil sera sans pitié : vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Deutéronome) que dans l’islam, mais elle est au contraire proscrite par le christianisme (« Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. » Matthieu 5,38-42), témoignant donc bien de sa présence dans la vie sociale. Une seconde forme institutionnelle de la vengeance est par exemple celle du duel d’honneur, apparaissant après 1547 en France. Il est notamment codifié en France après la Révolution, comme le montre François Guillet qui rapporte, dans La Mort en face, histoire du duel de la Révolution à nos jours, cette codification : armes légales (épée, pistolet, sabre) ; choix de l'offensé pour la date, le lieu et les armes du duel ; nombres de témoins (deux pour le pistolet, quatre pour l'épée ou le sabre) ; et types de duels (au premier sang ou à mort, au commandement, au visé, etc.). Le duel consiste bien à laver l’affront reçu en tentant de punir l’auteur de cette offense, si bien qu’il reflète une intégration de la vengeance dans les moeurs de la société. La vendetta fait également partie de ces formes institutionnelles de la vengeance, bien que légèrement différente. Il s’agit d’un mot d’origine italienne qui signifie vengeance et qui correspondait à une situation de guerre inter-familiale à caractère privée. Par exemple, Dominque Colas évoque dans son ouvrage Sociologie politique la particularité de la vendetta corse où, contrairement aux guerres modernes où des anonymes tuent des anonymes, on sait qui doit tuer et qui doit être tué. Pour autant, les formes institutionnelles de la vengeance ont été peu à peu déprécié. Déjà, Francis Bacon écrivait dans ses Essais que « la vengeance est une justice sauvage ». Or, le principe même de la justice étant le fait d’être propre à la société humaine, l’association de ce terme à celui de « sauvage » montre bien à quel point toute forme institutionnelle de vengeance n’en est que plus proscrite. Plus récemment, une des formes les plus extrêmes de la vengeance institutionnalisée a disparu en France : la peine de mort. Elle consistait en la forme ultime de ce type de vengeance, dans la mesure où, suivant la définition de la vengeance donnée en ce début d’article, donner la mort est le châtiment ultime qui implique la fin du processus de vengeance entre deux personnes - on ne peut punir à mort l’auteur de notre propre mort. Il pourrait donc être intéressant de poser la question d’une nécessité ou non d’une vengeance institutionnalisée au sein de notre monde contemporain, alors que certaines formes latentes subsistent toujours - quid de certaines guerres ? La quête de la vengeance Qu’est-ce donc qui nous pousse à poursuivre cette quête de vengeance alors ? Si les paradoxes et explications psychologiques présentés plus tôt en sont une cause, cela ne correspond pas à une étiologie complète de la vengeance. Beaucoup de notions on été mentionné dans cet article, mais il manque cependant celle de l’honneur, fondamentale dans notre explication de quête de la vengeance. Rousseau en a bien cerné les enjeux dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes : « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé, et l’estime publique eut un prix. […] De ces préférences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, et de l’autre la honte et l’envie. » De là naît aussi la vengeance, dans la mesure où si elle ne concernait que l’individu offensé et l’auteur de l’offense, sans n’avoir aucun écho au sein de la société, elle revêtirait bien souvent un caractère absurde - il s’agit, en quelque sorte, du prix de la publicité. Ce qui nous amène à nous poser la question de la légitimité de la vengeance. Si le cadre légal de la vengeance se rétrécit voire disparaît au fil des siècles - comme cela a été mentionné plus haut -, il en est autrement de sa légitimité qui se veut immuable. Mais comment l’évaluer ? Ce qui est légitime est ce qui est conforme à la loi, mais laquelle ? La loi positive (établie par la société civile) ou bien la loi naturelle ? Il s’agit ici d’un débat sans fin, compte-tenu de l’absence de définition précise et d’accord commun sur ce que sont les lois naturelles et leur degré d’application au sein du droit positif. C’est pourquoi le concept de vengeance est si intéressant : on ne peut pas en définir sa légitimité - elle est nécessaire pour l’offensé, et une bêtise pour un tiers neutre -, ce que montre l’évolution de son caractère légal au fil des siècles. Alternatives à la vengeance Trouver une alternative à la vengeance, c’est se défaire des griffes des remords lorsque celle-ci n’est pas totalement assumée, ou, mieux, éviter le pire dans le cas d’une vengeance extrême et disproportionnée. C’est également transformer le ressentiment que l’on éprouve face à l’auteur de l’offense en un sentiment nettement plus fertile. L’une des deux alternatives effectives est, évidemment, le pardon, notamment dans sa dimension chrétienne. Le pardon est à la fois le refus de la vengeance - comme dans le cas suscité de Tolstoy - et à la fois sa destruction - pardonner, c’est affecter durablement l’auteur de l’offense. A ce titre, le pardon chrétien est révélateur. Dans la parabole du fils prodigue (Lc 15. 11-32), si le pardon du père est le fruit de la repentance du fils, il n’empêche que le père abandonne toute idée de vengeance envers son fils une fois pardonné. Il convainc également son fils ainé, qui ne comprend pas son comportement, des bienfaits de pardonner à son frère cadet. Mieux, on retrouve ce refus de vengeance dans tous les aspects du christianisme, même les plus profonds : le pardon fait partie de la prière du Notre Père (« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés »). Ce refus de la vengeance est donc célébré dans le christianisme. D’ailleurs, il porte également en lui la destruction de l’acte de la vengeance, dans la mesure où pardonner, c’est briser la chaîne chronologique de la vengeance. De même que le pardon, l’oubli peut être une alternative à la vengeance. Oublier, c’est effacer volontairement ou involontairement les traces du passé : il créé une discontinuité dans le temps. En ce sens, si la vengeance perd son motif - si l’offense est oubliée à défaut d’être pardonnée -, alors elle n’a plus de raisons d’être. Un retour dans la mythologie gréco-latine s’impose ici. Homère raconte, dans l’Odyssée, le périple d’Ulysse qui le conduit, avec ses compagnons, sur l’île des Lotophages, c’est-à-dire mangeurs de lotos, le « fruit de miel » qui provoque un oubli artificiel permettant à ces indigènes de vivre en paix. Dès lors, par le fait d’oublier les querelles internes, ces indigènes ne connaissent pas la vengeance. Plus qu’une simple alternative donc, l’oubli est la capacité de se défaire du joug de l’égo pour vaincre l’envie de vengeance. Cependant, l’oubli n’est-il pas qu’une forme plus élevée de la vengeance ? C’est ce que suggère du moins l’écrivain espagnol du XVIIe siècle, Baltasar Gracian : « Il n’y a pas de plus haute vengeance que l’oubli » (L’Homme de cour). Conclusion In fine, avoir étudié la vengeance sous ses aspects historiques, religieux, psychologiques, littéraires, institutionnels et légitimes permettent de la comprendre, si ce n’est de mieux la maîtriser. Quoiqu’il en soit, cette étude nous apprend que la vengeance ne nous appartient pas totalement - elle était divine, elle devient juridique, puis se mue en interdit - mais qu’on ne cesse, pour autant, de la rechercher et de l’exécuter. La vengeance serait donc, somme toute, le dernier reliquat du sacré en l’homme : un enchantement divin pour contenir le désenchantement du monde. Tom Caillet Le titre de la chronique de Rafik Chekkat annonce déjà qu'on est mal barré. « On n'est jamais mieux sali que par soi-même » s'intitule, tout en finesse, cette critique de Divines, premier long métrage d'Houda Benyamina qui vient tout juste de rafler trois Césars (meilleur espoir féminin, meilleur second rôle et meilleur premier film). Il convient d'abord de s'arrêter sur la notion de « souillure » qui sous-tend le titre de cette chronique extrêmement violente, puisqu'elle apparaît comme le fil rouge de la critique opérée par Mr. Chekkat, qui semble ne pas se remettre du manque de pureté des femmes représentées dans l'univers fictif construit par Houda Benyamina. C'est depuis la « gauche radicale » et au nom du féminisme et de la défense des racisé-e-s que Mr. Chekkat s'exprime. Celui-ci opère, hélas, un dangereux renversement qui nous rappelle tristement qu'il est commun de se réclamer de ces valeurs (de « gauche » ou « féministe », indépendamment de la variété des spectres de chacun de ces mouvements de pensée) et de n'avoir de radical qu'un dangereux dogmatisme. C'est en fait une succession de normes morales et figées qu'en tant que « féministe », Mr. Chekkat semble exiger de la représentation que l'on fait des femmes racisé-e-s à l'écran, et plus encore qu'elles font d'elles-même. Cette « leçon de morale » sans rigueur dans son argumentation nous rappelle qu'il est toujours plus douloureux d'être confronté à la bêtise quand elle se réclame de notre propre camp. « Obscénité, exotisation et érotisation des corps des femmes noires et arabes », tonne d'emblée le chroniqueur. Ce sont les premiers mots qu'il aligne comme des cartouches pour descendre ce film de fiction qui met en scène Dounia et Maïmouna, deux jeunes adolescentes prêtes à tout, ensemble, pour s'extraire de la misère gluante de leur quotidien. Dès le départ, il est clair que ce qui dérange Mr. Chekkat, c'est bien la représentation de ces personnages féminins, à qui il reproche dans une agaçante litanie d'être « obscènes » « exotisées » et « érotisées » sans jamais expliquer pourquoi, ce qui nous amène à nous demander d'abord dans quel mesure un film est-il condamnable parce qu'il met en scène des personnages féminins non-exemplaires, si l'on concède au chroniqueur ces qualificatifs (en eux-mêmes contestables) contraires à une certaine idée de la morale. Il semblerait pour Mr. Chekkat que les femmes noires et arabes aient déjà assez de problèmes dans la vie pour qu'en plus elles soient représentées si amorales. Pourquoi la femme noire ou arabe n'aurait pas le droit d'être obscène ou érotique - ou les deux à la fois – on ne sait pas. Sous prétexte qu'il s'agit de minorités, doivent-elles être exclusivement représentées conformément à une certaine morale qui semble être – avant toute chose – celle de Mr. Chekkat ? Quand je pense aux deux personnages féminins au cœur de l'intrigue de Divines, c'est leur puissance qui me revient : à la manière de personnages de femmes des tragédies antiques, je me souviens de leur force, de leur détermination et de leur acharnement, qui m'ont bouleversée autant que leur fragilité et leur immaturité. Dans Divines, ce sont des histoires de rêves, entre autres, que l'on nous raconte : ceux de deux adolescentes qui veulent sortir de leur ghetto, conscientes que la réalisation de leur rêve dépend d'une condition sine qua non : l'argent. La force du film tient pour beaucoup à la justesse avec laquelle il dessine les contradictions de l'adolescence, cet âge charnière de la vie si délicat à représenter, celui des premiers troubles et des premières ivresses, celui où la lutte est toujours passionnée et la passion parfois funeste. « Comment a-t-on pu encenser et donner une portée politique et sociale à un film à ce point médiocre, pathétique et sans espoir ? » questionne le chroniqueur, sur le mode de la plainte voire du gémissement strident. Mr. Chekkat s'insurge, sans chercher, justement, a comprendre ce qui, dans Divines, a pu plaire, et plaît. On comprend bien qu'il ne trouve à Divines aucune qualité, et aucune originalité. Celui-ci ne cesse par la suite de se complaire dans son exaspération : c'est d'abord que c'est un film « pathétique » mais plus encore qu'il est « sans espoir » ; et là, on touche quelque chose d'important. Parce qu'il est sans espoir donc, Divines est condamnable. Mais pourquoi donc ? On ne peut pas décemment croire que Mr. Chekkat n'accorde ses grâces qu'aux films qui délivrent un message d'amour et d'espérance. Serait-ce parce qu'un film sur la banlieue, ça doit faire espérer ? Serait-ce donc qu'à ce pré- requis de l'ordre de la morale lui aussi, le film ose échapper ? Aïe aïe aïe, nous voila retombés dans un vieux débat vaste et stérile cher aux moralistes de tous temps : l'art doit-il être moral ? La question que l'on peut poser ici naturellement, c'est aussi : la banlieue a-t-elle le droit d'être désespérée ? Pour le chroniqueur, c'est un non vindicatif. Explications. « Aucun qualificatif n'est pourtant assez dur pour exprimer ce que l'on ressent face à un tel spectacle, au cours duquel la réalisatrice enfile les clichés les uns après les autres ». Face à tant d'immoralité, donc, c'est par la « dureté » qu'il faut répondre, assène Mr. Chekkat en vrai garant de la morale publique. L' « obscénité » et « l'érotisme » supposé de Divines, il faut le réprimer voire le punir. Divines est un film « ringard », composé d'une succession de scènes qui non seulement sont « ratées » (pourquoi et comment, on ne sait pas mais cela semble évident à notre chroniqueur qui, par ailleurs jamais n'évoquera la forme du film, se cantonnant à ce qu'il en a perçu du « fond »), mais aussi « gênantes » (retour aux bonnes mœurs de facto, donc). « Sur fond d'histoire d'amour douteuse dans une cité improbable, trois jeunes femmes ont pour unique préoccupation de se faire de l'argent. » Dounia, personnage féminin au coeur de l'intrigue de Divines, est fascinée par un jeune homme - vigile de jour et danseur dans son temps libre - , qu'elle va observer en secret pendant ses répétitions, submergée malgré elle par un trouble violent qu'elle a du mal à maîtriser. Le jeune homme, qui découvre la voyeuse, n'est pas indifférent non plus à la mystérieuse jeune fille qui s'échappe dès qu'elle est découverte. Cette histoire d'amour qui naît est donc « douteuse » : mais de quoi doute-t-on ? De son caractère réaliste ? Le cinéma et l'art en général ont-t-il pour impératif de représenter des histoires d'amour réalistes ? Non. Mais alors un film sur la banlieue, si ? Et pourquoi donc, Mr. Chekkat, je vous le demande. Et si ce n'est pas le réalisme qui est mis en doute, qu'est-ce donc alors ? Mystère. La cité dans laquelle se déroule l'intrigue est, elle, taxée d'« improbable » (même critique donc, puisqu'il s'agit d'attaquer le réalisme de la cité, décor de l'histoire d'amour « douteuse », et du reste du film). Le plus scandaleux aux yeux de notre chroniqueur visiblement, c'est pourtant cela : « trois jeunes femmes ont pour unique préoccupation de se faire de l'argent », alors là, voila la morale frappée en plein cœur. Comment ça, des femmes de banlieue qui rêvent d'argent ? A-t-on bien vu et entendu ? Pour Mr. Chekkat, rêver d'argent, c'est moche, ou plutôt sale, comme il le dit. C'est un postulat très contestable, et un peu hypocrite aussi. Il semblerait que rêver d'argent, aujourd'hui, soit plutôt commun, et pas très original. Ce qui me turlupine plus encore, c'est que derrière ce constat outré, il s'agit en fait pour Mr. Chekkat de dire que les jeunes noires et arabes, quand elles sont représentées à l'écran, devraient avoir des aspirations plus pures. N'ont elles pas le droit elles aussi de rêver d'argent, de fric, de thune, de flouz, de bif, pour avoir une vie meilleure, comme beaucoup d'entre nous, Mr. Chekkat ? Non, les personnages féminins de Divines ne manquent pas de noblesse. Plus encore, cette question nous ramène à un problème fondamental qui projette son ombre sur toute la réflexion de notre chroniqueur : en Dounia et sa meilleure amie, Maïmouna, celui-ci ne voit qu'une chose, qui l'aveugle : elles sont noires et arabes. La réussite de Divines, c'est précisément de ne pas raconter la saga d'une femme noire et d'une femme arabe en banlieue, mais de deux jeunes adolescentes immatures et pleines de fougue qui rêvent de renverser ce qui les entoure, prêtes à tout pour s'échapper de leur condition sociale (et, de fait, elles sont racisées et banlieusardes). Qu'est-ce qui est « le plus » constitutif de leur identité ? Etre femme ? Racisée ? Banlieusarde ? Adolescentes ? Françaises ? Pauvres ? Comme beaucoup d'adolescents, Maïmouna et surtout Dounia, sont animées puissamment par un sentiment d'injustice qui leur donne envie de tout cramer. C'est au nom d'un certain féminisme que Mr. Chekkat fustige Divines sans aucune délicatesse. Je condamne le fait de ne voir en elles que des « racisées » de « banlieue » ce qui est une façon de négliger la dimension bien plus grande d'un film qui raconte, pour reprendre les mots de la réalisatrice, l' « éducation sentimentale » de son personnage principal. Plus loin, le chroniqueur semble se rattraper en réalisant que la vraisemblance du film importe peu, concédant qu'il s'agit d'une « œuvre de fiction » et non d'un « documentaire ». C'est bien le seul point sur lequel Mr. Chekkat et moi sommes d'accord. Opérant alors un virage dans son argumentation, il assène que ce n'est pas le réalisme du film qu'il faut fustiger, (ce qu'il n'a quand même pas pu s'empêcher de faire) mais plutôt « l'intention de la réalisatrice » : « Des femmes qui doivent se faire une place dans un univers masculin ultra violent, on a déjà vu ça des dizaines de fois au cinéma. » Mais comment le sujet est-il traité dans Divines, avec quels moyens narratifs et cinématographiques ? Mr. Chekkat n'entre jamais dans les détails de la construction, à proprement parler, du film. « Quel est l'intérêt aujourd'hui de nous montrer les péripéties des dealeuses qui imposent leur loi au quartier et font jeu égal en matière de violence avec les hommes ? » se demande-t-il encore ? Le même intérêt que celui de montrer des péripéties de dealers hommes, et le même intérêt encore que de montrer des péripéties tout court, il me semble, ce qui est plutôt fréquent dans l'art en général. Je me demande d'ailleurs pourquoi « montrer les péripéties des dealeuses qui imposent leur loi au quartier et font jeu égal en matière de violence avec les hommes » est si problématique. Pas parce que ça manque de réalisme donc, si l'on suit le développement de l'argumentaire du chroniqueur qui affirme que le réalisme n'est pas la question. Parce que les femmes noires et arabes méritent d'être représentées autrement, en personnages « moraux », ni vulgaires ni obscènes, donc ? Il convient dès lors de se demander ce qui aux yeux de Mr. Chekkat fait de Dounia, Maïmouna et Rebecca des personnages « vulgaires » ou « obscènes » : serait-ce leur fascination pour l'argent, ou encore leurs fréquents jurons, combiné à leur rouge à lèvres rouge vif et à leurs robes moulantes quand elles s'incrustent dans une soirée mondaine ? La force de Divines, c'est de traiter ces personnages de jeunes filles au-delà du fait qu'elles soient racisées, et c'est cela au fond qui fâche peut-être notre chroniqueur. Combattre pour plus de justice pour les racisé-e-s signifie-t-il qu'il faille se cantonner à une représentation « positive » et sympathique des noirs et des arabes ? Et d'ailleurs est-on bien sûr que ces personnages soient si antipathiques ? Traitées avec tendresse, autant dans le fond que dans la forme, Dounia, Maïmouna et même Rebecca la dealeuse sans pitié, sont bercées de contradictions profondément humaines qui les rendent, non seulement admirables dans leur rage de vivre, mais aussi extrêmement attachantes. La caméra rend justice à cet éclat dont elles sont toutes trois empreintes. « Quel est le propos de Houda Benyamina et quel public ce propos vise-t-il ? En un mot, pour qui ces filles sont elles divines ? » s'interroge encore Mr. Chekkat. Le titre du film, Divines, renvoie selon les propos de la réalisatrice à l'importance du spirituel qui imprègne le film : illustré par la pregnance de la religion et des tiraillements qu'elle suscite en Dounia et Maïmouna, mais aussi par des questionnements plus métaphysiques qui traversent les deux amies en quête de sens. « Divines » elles le sont, parce que profondément vivantes jusqu'au bout, et leurs rires et leurs sanglots, filmés de près, crèvent l'écran et le coeur. « Parce qu'il est réalisé et interprété par des Arabes et des Noires et qu'il traite d'un sujet de société, le film a été qualifié d'oeuvre courageuse, progressiste, et même féministe. Un féminisme que viendrait illustrer la fameuse réplique « T'as du clitoris, j'aime bien ! » » C'est précisément, pour le chroniqueur, parce qu'il est réalisé et interprété par des racisées que le film aurait du être différent. C'est là la faille la plus flagrante de l'argumentation de Mr. Chekkat, obsédé par ce que devrait être une bonne représentation des femmes racisé-e-s et donnant par là, au passage, une leçon morale « d'homme à femme racisée » plutôt cocasse. Selon moi, Divines parle de la banlieue comme d'une toile dans laquelle quand on est pris, il est presqu'impossible de sortir, quelle que soit la puissance avec laquelle on se débat, ce qui est le cas, d'ailleurs, de tous les « ghettos » quels qu'ils soient. Que les personnages masculins soient presque absents dans le film, comme le note le chroniqueur, n'est pas un argument pour faire du film un film « féministe », c'est vrai. Au-delà de la fameuse réplique du personnage de Rebecca, « T'as du clitoris, j'aime bien ! », dont la réalisatrice revendique la maternité, dans Divines s'opère un indéniable renversement des attributs de la « masculinité » et de la « féminité » tels qu'ils sont construits et ancrés dans notre société. Le paysage est presque lavé de la présence masculine, les filles – et femmes – sont déterminées dans les quêtes qu'elles accomplissent sans les hommes, tandis que la seule histoire d'amour du film naît (et ce n'est pas par hasard) entre un jeune homme blanc passionné par la danse, que le personnage principal, Dounia, observe dans la posture de « voyeur », dans un renversement du cliché on ne peut plus clair. C'est précisément en cela aussi que Divines est un film précieux et politique : les hommes sont relayés au second plan, ils sont accessoires, sortent du domaine du nécessaire, de l'essentiel, et ça fait du bien. « L'inversion des genres n'est qu'apparente. Rebecca, Maïmouna et Dounia se comportent en réalité comme des caricatures de dealeurs de banlieue. Elles s'achètent des Air Max et rêvent de beaux mecs (blonds), de Ferrari et de vacances à Phuket. » écrit encore Mr. Chekkat. Qu'est-ce qui est si dérangeant dans la représentation de filles qui rêvent d'Air Max et de mecs bodybuildés ? Le plus aliéné d'entre tous n'est-ce pas celui qui s'insurge que des filles qui rêvent aux mêmes choses que certains garçons ? Que cette représentation du rêve de banlieusard soit caricaturale, pourquoi pas, mais n'est-ce pas justement une partie de la jouissance que procure le film, que de voir ces filles capables de s'offrir tous les clichés dont elles rêvent comme leurs confrères de la cité ? Aurait-il été plus « féministe » qu'elles rêvent d'acheter un appartement et de partir en vacances dans un gîte en Vendée, pour « briser les clichés » ? Si le chroniqueur considère que la réalisatrice « exotise » les personnages de Divines, il est intéressant de se demander à nouveau en quoi il est « exotisant » de rêver de Ferrari et d'Air max et si ces rêves là sont seulement ceux des racisé-e-s de banlieue, ou bien plutôt des rêves codifiés portés par toute une jeunesse française, et toute une génération. Indépendamment des trois personnages de jeunes filles, « les seules figures féminines que donnent à voir la réalisatrice sont une fonctionnaire dépressive, une prostituée et une sorcière », résume grossièrement Mr. Chekkat, désignant par la la prof de lycée exaspérée que l'on voit tenter de canaliser la rage de Dounia sans succès, la mère de Dounia (qualifiée de « prostituée » parce qu'elle a des relations sexuelles avec plusieurs hommes dans le film, sans qu'à aucun moment soit mentionné le fait qu'il s'agisse de relations tarifées ; raccourci intéressant, donc) et la mère de Maïmouna, qualifiée de « sorcière » au prétexte que Maïmouna évoque les « sorts » que celle-ci lui aurait jetée pour la punir. Ce qui se dit là encore entre les lignes de cette chronique, c'est que les femmes ne devraient pas être représentées si laides ; dépressives, légères, ou encore inquiétantes. Ces personnages de femmes adultes, asphixiant dans la misère économique et sociale dans laquelle elles progressent au ralenti, sont avant tout fragiles. C'est cette fragilité là que l'on retrouve aussi chez Dounia, Maïmouna et Rebecca, les trois adolescentes. Qu'aucun « rôle féminin positif » ne soit mis en avant peut nous pousser à nous demander, une fois de plus, pourquoi un film devrait nous imposer des modèles et surtout qui est légitime pour définir les critères de cette « modélité ». « Si un Blanc s'était amusé à compiler autant de clichés racistes et sexistes dans un long-métrage, à faire preuve d'une telle complaisance vis-à-vis de la violence, constamment euphémisée et esthétisée, beaucoup auraient crié au scandale. » Le problème de la réception de Divines n'est pas seulement qu'il est reçu exclusivement comme un film sur la banlieue, mais aussi qu'il est reçu exclusivement comme un film sur la banlieue réalisé par une femme racisée de banlieue. Cette incapacité à recevoir l'oeuvre indépendamment de l'individu qui en est l'auteur, voire de ses intentions affichées ou fantasmées, doit hélas faire se retourner Barthes, Foucault et tous les autres, dans leur tombes. En dépit des attaques personnelles faites à la réalisatrice, c'est enfin la « leçon » à tirer de Divines qu'il faut condamner selon le chroniqueur, puisque le « message » adressé aux racisé-e-s serait à ses yeux que le « ticket d'entrée {dans le monde du cinéma}consiste le plus souvent à cracher sur sa communauté, à répondre au cahier des charges raciste et sexiste ». Analyse finale aberrante, qui néglige tout ce qui fait que Divines est une œuvre d'art et non pas un pamphlet politique, un film et non pas un « message ». Réduire ce long-métrage bien rythmé, à l'intrigue haletante et aux actrices admirablement dirigées à un « crachat », est à la fois extrêmement violent et criant de mauvaise foi. Il n'en demeure pas moins que Divines a bouleversé le public parce qu'il raconte une histoire qui fonctionne, qui nous prend aux tripes, et nous laisse un peu de cette rage qui éclabousse l'écran.
Cléo Cohen "Tomber amoureux, c'est rendre du relief aux choses, s'incarner dans l'épaisseur du monde." La société actuelle dans son ensemble est "hypersentimentale", mettant l'amour à toutes les sauces, s'imagine même pouvoir devenir "une société de frères et d'amants".
Finalement, nous dit Pascal Bruckner, personne n'a gagné : ni ceux qui prétendaient libérer le désir sexuel, ni les défenseurs des bonnes moeurs qui escomptaient nous ramener au statu quo ante. Si la volonté de faire table rase a échoué, les plus rétrogrades ont été affectés, eux aussi, par le changement. Chacun de nous réunit les expériences de toutes les époques : du libertinage du XVIIIe siècle à la révolution sexuelle du XXe, en passant par le romantisme du XIXe. "La nouvelle femme est peut-être l'addition de toutes les figures apparues au cours de l'Histoire : beauté vénéneuse et vierge froide, vamp perverse et mère aimante, midinette et meneuse d'homme..." L'Echec du mariage d'amour Dans le mariage classique, l’amour et la volupté étaient bannis. Nos ancêtres estimaient que le désir et le sentiment étaient trop fragiles pour fonder une union durable. Ils étaient moins prudes que prudents. Aujourd’hui, l’amour est devenu obligatoire. La sexualité est même le baromètre de la santé du couple. Comme l’écrivait déjà Engels, dans Les Origines de la famille : « Seul le mariage d’amour est moral et seul l’est aussi le mariage où l’amour persiste. » Au XIXe siècle, il y avait du courage à célébrer les vertus du sentiment dans un monde adonné au culte de l’intérêt. À notre époque, c’est une banalité : l’amour devait apporter la solution, il est devenu un problème. Le désir comme le cœur sont soumis au régime de l’intermittence. Le mariage fond comme peau de chagrin depuis 1970 (de 400 000 à 250 000 unions célébrées, lesquelles finiront pour moitié en divorces). Et si le concubinage et le pacs sont plébiscités, c’est qu’ils proposent un lien révocable à tout instant. Nous voulons les avantages du couple sans les conséquences qu’il entraîne. La fin du lien familial? L’enfant n’est pas soumis à cette nature plébiscitaire de l’affection conjugale. On l’aime d’un amour inconditionnel. S’il y a un nouveau désordre familial, il se trouve là : dans le contraste entre la fragilité du sentiment amoureux et la solidité de la filiation. La sacralité réside dans le lien familial, la versatilité, dans le lien conjugal. Lors d’un divorce, l’enfant est souvent l’otage des dissensions. D’où l’importance de réussir sa rupture autant que son mariage. Dans les familles recomposées, la difficulté est de cohabiter avec les rejetons du nouveau conjoint, de sympathiser avec les ex. Ces fratries, présentées comme un modèle d’harmonie, me font penser aux appartements collectifs soviétiques où les gens étaient entassés ensemble, contraints de faire bonne figure. Ce n’est déjà pas simple de supporter les siens à temps complet. Et ces nouvelles tribus élargies font peser sur les épaules de chacun des responsabilités accrues. Famille, je vous aime, mais pas tous les jours… La famille autoritaire nous soumettait à la loi d’un tyran domestique, mais elle avait le bénéfice de désigner le chemin de la révolte. Avec la famille d’amour, c’est plus compliqué : comment se révolter contre un câlin ? Quelles remèdes? Nous devons apprendre à dissocier la famille et le couple. Parce que ce sont des régimes sentimentaux différents. La construction de la famille est un acte qui engage complètement. On aime plusieurs fois dans sa vie. Mais on ne renie plus ses enfants comme au temps de Rousseau. On les choisit, on les chérit avant même qu’ils ne viennent au monde. En revanche, le couple est un dialogue constant entre la raison et les passions, entre l’attachement à une personne précise et la versatilité du désir. Si l’amour veut brûler, qu’il s’abandonne tout entier au désordre des sens, qu’il se consume en quelques jours, quelques mois. S’il veut durer, il doit consentir au temps, se bâtir à partir du quotidien et non contre lui. Aujourd’hui, nous sommes sous l’emprise du mythe fusionnel : nous aimons l’amour plus que les êtres. Si l’autre ne vous inspire plus, il est coupable, vous le congédiez sur le champ. Mais pourquoi l’effervescence des premiers instants ne pourrait-elle se transformer en amitié amoureuse ? Pourquoi ne pourrait-on cloisonner sa vie en différents compartiments ? Vivre ensemble et séparés, recréer une utopie intelligente de la distance ? En l’absence d’un modèle et d’un contre-modèle faisant autorité, il revient à chaque couple d’emprunter toutes les recettes de sagesse disponibles. Enfin, en un temps qui célèbre la passion sauvage, je plaide pour assujettir les élans du cœur et de la chair au principe de délicatesse. Pardonnons-nous nos faiblesses réciproques, ne nous blessons pas inutilement. Gardons-nous de ce travers contemporain : la muflerie. Pascal Brukner Anne Marie
Premier jour de stage, je rencontre l'équipe de stagiaires avec qui je vais partager six mois dans un petit bureau de la place parisienne. Lucas, grande gueule, détente, je sens qu'on va être copains et Anne Marie, trop à l'aise et brusque. Elle se présente comme la reine des stagiaires. Tu comprends on est une grosse bande de stagiaires, on se fait tout le temps des soirées, tu vas te plaire ici. La première semaine passe, le travail est exigeant, les horaires lourdes mais le sujet passionnant. Au fil des pauses café, je commence à me faire une idée plus précise de mes deux collègues. Anne Marie porte une imposante chevalière dorée clinquante sur son auriculaire. Gloups. Quelle faute de goût, le genre noblesse de la dernière heure, je ne raffole pas. Surtout, qu'Anne Marie vient d'un milieu modeste en banlieue. Besoin de paraître. Elle me raconte que ses meilleures copines se marient cet été. Gloups. 21 ans, mariage arrangé, pressé. Un soir, elle m'ajoute sur Twitter. J'avais déjà reçu une demande d'amitié facebook le jour de mon arrivée. Un poil oppressant. Je parcours son fil de tweets. Elle joue dans la cathosphère, retweete paroles de prêtres et punchlines d'abbés. Et puis, un matin, Anne Marie arrive au bureau et dépose sa bible à quelques centimètres de mon clavier. GLOUPS. Soudain, contexte oblige, je me mets à imaginer Anne Marie à la tête d'un de ces groupes qu'on a vu défiler en 2013 au nom de la Manif pour tous. Bannières à l'épaule, panneaux sous le bras, étalage de rose et bleu, criant les slogans lancés au micro par la Barjot. Cette pensée m'agace. Pourquoi le lien entre foi catholique et Manif pour tous me parait-il si évident ? Pourtant, à quelques jours du retour du gang des Barjots dans la rue, Anne Marie explique qu’elle entend bien se rendre au rassemblement avec toute sa famille. Parce qu’il faut défendre les enfants. Anne Marie ou le jumeau maléfique de Frigide. Je passerais ici l’argumentaire nauséabond d’une Anne Marie partie en croisade contre son bon sens et ses précieuses valeurs chrétiennes. Car Anne Marie, tu te trompes : reconnaître à tous le droit de se marier est une marque de tolérance, d'amour et d'acceptation, des valeurs chrétiennes, précisément. Je veux convaincre Anne Marie que l'ouverture du mariage aux homosexuels n'est pas une menace pour sa foi mais une façon de défendre les valeurs chrétiennes. Forte de mes 18 années d'études passées dans un lycée privé catholique, voici donc ce que j’aimerais répondre à une Anne Marie en puissance : Protégeons les enfants Commençons par les arguments "antis". Au cœur de l’argumentation de la Manif pour tous, il y a le souci de protéger les enfants. Les protéger de qui ? de quoi ? La protection des enfants est un argument malin parce que fédérateur. Quoi de plus adorable et fragile qu'un nourrisson. Cet argument place, a contrario, les opposants de la manif pour tous dans un rôle de persécuteurs d'enfants. Une rhétorique démagogique et pernicieuse. La théorie du genre Un père et une mère donc, sont seuls nécessaires au bon développement de l'enfant affirment les "antis" au nom de la protection des enfants à naître. A cela, certains répondent par la théorie du genre. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Si l'identité sexuelle n'est qu'une construction sociale, si les codes de la féminité et de la virilité sont superficiels, archaïques et paternalistes, alors l'homme et la femme ne sont pas fondamentalement différents. Et, avoir un mère, un père, deux mères ou deux pères, cela reviendrait finalement au même. Autant le dire tout de suite, je ne suis pas d'accord. Un homme, une femme, c'est différent et c'est tant mieux. Donc non, avoir un père, une mère, deux mères ou deux pères, ce sont des situations chaque fois différentes. Pas mieux, pas moins bien, juste différentes. L'argument du "moins pire que" Hiérarchiser ces situations n’a pas de sens : aujourd’hui, dans le hit-parade des familles, les familles hétéros devancent les familles homos, qui devancent les familles décomposées, qui devancent les familles pourries. Et en dernière position pas de famille du tout. Non. Juste non. Certains affirment qu'un enfant préférera toujours être élevé par deux hommes que par un alcoolique et une mère absente, qu'un orphelin préférera toujours des parents, mêmes homos, que la solitude des foyers sociaux. Cette comparaison en forme de "moins pire que" n'est pourtant pas la réponse. Je suis convaincue que chaque famille est unique, car composée de plusieurs personnalités qui créent ensemble des liens très personnels. Ma famille ne ressemble à aucune autre. Elle a ses inconvénients et ses avantages. La comparaison entre familles hétéro-parentales et homoparentales ne peut pas prendre la forme du "moins pire que". Il y a du bon et du moins bon à chaque situation et ce n'est pas mieux en soi d'avoir un père et une mère, aussi parfaite la famille du bonheur puisse-t-elle paraître. Une famille en or Naître dans une famille homoparentale, vient avec une série d'inconvénients : discrimination, sentiment d'être différent, discrimination, moquerie, discrimination (encore)... Mais ces familles sont aussi pleines d'avantages. Oui oui des avantages. D'abord il y a l'ouverture d'esprit, la tolérance et l'acceptation des autres. Mais aussi le respect et l'amour. Je m'explique. Un enfant qui naît avec deux mères ou deux pères, apprend très tôt à comprendre et accepter les différences. La tolérance en somme. Et L'amour. Pourquoi l'amour ? Eh bien parce que pour braver les épreuves qui ponctuent la démarche de fonder une famille, il faut beaucoup (beaucoup) d'amour. Ce parcours semé d’embûches est une épreuve émotionnelle que seuls des couples suffisamment amoureux, attachés et solides parviennent à traverser. Et cet amour à toute épreuve, transmet aux enfants un modèle de couple, aimant et équilibré. Rien que ça. Le message d'amour Le message de Dieu, je l'ai entendu pendant 18 ans, tous les jeudis au catéchisme. Ce que j'ai retenu : Dieu est amour. L'amour aussi original soit-il, suivra toujours le message de Dieu, car Dieu accepte les Hommes pour ce qu'ils sont. J'ai fait un lien hâtif et faux entre le message chrétien et la Manif pour tous. Si la Manif pour tous légitime son discours de haine en l'embaumant de morale chrétienne, ce n'est rien d'autre que de la manipulation. Et la manipulation c'est mal. Mathieu 22:38 : Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Homélie Anne Marie, Reconnaître à tous le droit de faire officialiser son amour par le mariage est une façon d'affirmer le message de Dieu. Reconnaître à des couples qui s'aiment, d'un amour pur et solide, le droit d'avoir des enfants infiniment désirés et choyés, est la meilleure façon de porter haut les valeurs chrétiennes, de tolérance, d'amour et de charité. Charlotte Hector L’Âge d’or islamique est une période de six siècles (VIIIe – XIIIe) extrêmement riche sur les plans scientifique, culturel, philosophique, technologique… Même contestée sur plusieurs points, la grandeur de cette période fut un catalyseur indispensable pour le développement du Moyen Orient, mais aussi de l’Occident. Le Moyen-Orient peut-il aujourd’hui, ou dans les temps à venir, retrouver un semblant d’Âge d’or et inspirer le reste du monde, ou est-il condamné à un Âge de fer ? Même si la période traversée par le Moyen-Orient peut être comparée à une relecture de l’Age de fer de Hésiode, il est cependant certain que le passé magnifié de cette région reste dans les mémoires. Selon le philosophe, voici à quoi ressemble un Âge d’or : « Les mortels vivaient comme les dieux, ils étaient libres d’inquiétudes, de travaux et de souffrances ; […] loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins. […] La terre fertile produisait d’elle-même d’abondants trésors ; libres et paisibles, ils partageaient leurs richesses avec une foule de vertueux amis. » Il s’agit d’un épanouissement personnel couplé à celui de la société, où chaque individu s’enrichit paisiblement de ce qu’il donne et reçoit de la communauté. Dans le cas qui nous intéresse, les synergies qui ont eu lieu entre le VIIIe et XIIIe siècle au Moyen-Orient ont pleinement participé à l’élaboration de cet Âge d’or : « Les artistes et scientifiques musulmans, les princes et les travailleurs ont fabriqué ensemble une culture unique qui a directement et indirectement influencé les sociétés sur les autres continents. » (Howard R. Turner, Science in Medieval Islam) Mais quels sont les héritages de cette période faste ? Pour les techniques, ce sont le développement de la calligraphie, l’usage accrue du papier ou encore l’émergence des arts du feu (verre, métallurgie fine) ; pour les mathématiques, ce sont le développement de la trigonométrie moderne, la compréhension de l’astronomie ou encore la traduction de livres mathématiques ; pour les arts, ce sont l’édification de grandes mosquées ou la création de nouveaux courants architecturaux. Cependant, le plus bel héritage que peut laisser un Âge d’or, c’est justement le concept du legs, l’idée qu’il faut le perpétuer, le refaire vivre à tout prix dès que l’occasion se présente. Cet héritage peut constituer le vecteur d’identité d’une communauté humaine. Il y a donc l’idée d’une tradition qui est à la fois une mémoire et un projet. En un mot, une conscience collective : le souvenir de ce qui a été, avec le devoir de le transmettre et de l’enrichir.
Mais que veut dire hériter de l’Âge d’or islamique ? Comment recevoir et perpétuer la tradition comme telle, sans la trahir, si elle engage ceux qui en héritent à perpétuer un passé dont le présent ne veut peut-être plus, et parfois non sans raison ? Lors des derniers siècles, le souvenir de cet Âge d’or hantait les partisans du panarabisme, les scientifiques exilés, les grands hommes politiques ou encore les universitaires, nostalgiques de cette période ensevelie. Prenons l’exemple du panarabisme, qui marque d’une certaine manière la volonté de créer une société en écho à celle qui subsistait pendant l’Âge d’or. Idéologiquement, ce mouvement se fonde sur la Nahda (mouvement de renaissance arabe moderne de la première moitié du XIXe siècle). Il vise à refaire vivre l’unité arabe du VIIe siècle ayant eu lieu sous la dynastie des Omeyyades, pilier de l’héritage de l’Âge d’or islamique. Son principal avantage est qu’il se revendique laïque compte-tenu de la diversité religieuse de ses théoriciens (chrétiens, musulmans). Si ce legs hante les esprits, il n’a pas su se concrétiser à cause de la division engendrée par les accords Sykes-Picot et par les lendemains tumultueux de la Première Guerre mondiale. Pour autant, certains mouvements ont vu le jour après 1945, notamment avec le parti Baas et le Nassérisme. Mais les différends idéologiques, les conflits politico-religieux, les aléas économiques et les tensions géopolitiques ont tué dans l’oeuf les volontés nationales et régionales de refaire vivre un passé magnifié. Ainsi c’est davantage le souvenir d’une société unifiée de l’Âge d’or islamique qui est la plus présente dans les esprits, comme l’ont montré les mouvements nés de la Nahda. Pour autant, cela signifie-t-il que la prospérité économique, corrélative à l’Âge d’or, est impossible ? Aujourd’hui, elle est beaucoup trop hétérogène pour véritablement parler d’une prospérité régionale : en PIB par habitant (PPA), le Qatar, le Koweit, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie saoudite et le Bahreïn occupent respectivement la 1ere, 5e, 7e, 10e et 11e place, alors que l’Irak, l’Égypte et le Yémen occupent respectivement la 76e, 94e et 137e place (selon le FMI). Même sans prendre en compte les disparités économiques internes, les différences de développement entre pays sont telles qu’il est pratiquement impossible de parler d’une prospérité économique généralisée (signe d’un Âge d’or) au Moyen-Orient. Néanmoins, si les difficultés sont manifestes, nous avons vu que le souvenir de l’Âge d’or est bel et bien présent. Mais comment se manifeste-t-il concrètement aujourd’hui ? Quels sont les obstacles à surmonter et les défis à faire face ? Réponses dans la troisième et dernière partie du dossier « L’Âge d’or islamique est-il définitivement perdu ? ». Tom Caillet ’Âge d’or islamique est une période de six siècles (VIIIe – XIIIe) extrêmement riche sur les plans scientifique, culturel, philosophique, technologique… Même contestée sur plusieurs points, la grandeur de cette période fut un catalyseur indispensable pour le développement du Moyen-Orient, mais aussi de l’Occident. Le Moyen-Orient peut-il aujourd’hui, ou dans les temps à venir, retrouver un semblant d’Âge d’or et inspirer le reste du monde, ou est-il condamné à un Âge de fer ? Si le mythe de l’Âge de fer est d’origine grecque, il n’est pas absurde de le transposer à la période que traverse actuellement le Moyen-Orient. C’est en effet dans Les Travaux et les Jours que Hésiode expose les différents âges de l’humanité : l’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge d’airain et l’âge de fer. Ce dernier se caractérise par un chaos empli d’excès et de crimes, où la justice est absente : « L’un ravagera la cité de l’autre ; on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu ; on honorera de préférence l’homme vicieux et insolent ; l’équité et la pudeur ne seront plus en usage ; le méchant outragera le mortel vertueux par des discours pleins d’astuce auxquels il joindra le parjure […] ; il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables. » Bien que ce parallèle soit à nuancer, on peut en tirer plusieurs enseignements et, surtout, étudier en quoi la situation contemporaine du Moyen-Orient y fait écho. En premier lieu, si l’on adopte le point de vue démocratique occidental – qui est partagé par une partie non négligeable de la population locale, comme l’ont rappelé entre autre les Printemps arabes -, la naissance de l’Organisation État islamique (OEI), son expansion et sa capacité à entrer en conflit avec les valeurs défendues par l’Occident en font la raison majeure de ce retour au chaos décrit par Hésiode. La destruction de cités par l’OEI (Palmyre, Nimroud, Mossoul…) s’inscrit en effet pleinement dans la négation de l’Âge d’or. Ces villes, symboles d’une richesse culturelle, scientifique et humaine, étaient les places fortes des différents empires de la période faste de la région. La ville de Hatra, détruite, était par exemple classée au patrimoine mondial de l’Unesco et avait « des vestiges [qui] témoignaient de la grandeur de sa civilisation » (Unesco). Si les villes-symboles sont détruites, ce sont également des nœuds sociaux qui se délitent, l’appauvrissement des relations sociales qui apparaît, et la perte d’une chance unique de faire vivre une effervescence scientifique, philosophique et culturelle (Palmyre, l’irremplaçable trésor, Paul Veyne). Un autre aspect décrit par Hésiode est le conflit religieux joint à la négation de la justice. En cela, les exemples contemporains sont malheureusement très – trop – nombreux : les tensions frontalières entre l’Irak et l’Iran durant la Guerre du Golfe du temps de Saddam Hussein, les conflits internes à l’Arabie saoudite entre le pouvoir sunnite et les chiites duodécimains de la province du Hasa, l’émergence de milices claniques ou politiques… Cette énumération pourrait s’allonger, mais elle témoigne déjà de l’importance de la religion et des croyances dans le désordre qui sévit au Moyen-Orient actuellement (démontré notamment par Gilles Kepel).
Compte tenu des difficultés à résoudre ces conflits, ou du moins à les apaiser, ces tensions semblent insolubles et compliquent un peu plus la situation moyen-orientale contemporaine : l’impossible paix israélo-palestinienne, les cessez-le-feu non appliqués en Syrie (notamment celui de février 2016), l’escalade diplomatique entre l’Arabie saoudite et l’Iran (suite à l’incident de la Mecque), etc. Quant à la négation de la justice, elle va de pair avec l’absence d’État de droit – voire même à la présence d’États faillis. La stabilisation d’une région, où règne l’ordre et la justice – qui demeure néanmoins relative à l’État -, est une condition sine qua non pour parvenir à l’émergence d’un Âge d’or : « Facteur stabilisateur, l’État forme une institution qui contribue au maintien d’un ordre à la fois géographique, social, politique et juridique. » (Les États faillis et le terrorisme transnational, Kamal Bayramzadeh) Or, les États moyen-orientaux actuellement les plus en difficultés, et où le désordre règne, sont sans aucun doute ceux où la justice est arbitraire voire inexistante, notamment en Syrie et en Irak. L’État représente avant tout la personnification juridique d’une nation et est garant de la justice. L’État failli est donc un frein à un Âge d’or islamique et bien le terreau à l’Âge de fer selon les critères proposés par Hésiode. Dans sa définition de l’Âge de fer, Hésiode parle des « chagrins dévorants ». Là encore, ce sombre tableau trouve ses couleurs dans les événements contemporains du Moyen-Orient. Les réfugiés, les déplacés, les victimes de guerre, les civils et les familles en deuil en sont des exemples. Réfugiés syriens à Erbil dans le Kurdistan irakien / Flickr De « l’impossible comptage des victimes » en Syrie (Libération) au presque 20 millions de personnes déplacées par les conflits en Syrie, Yémen et Irak, ces chagrins innombrables fruits des guerres et des tensions sont propices à un climat où règnent la peur, la tristesse et le désespoir. Aujourd’hui, le Moyen-Orient est la région du monde qui concentre le plus de ces maux avec l’Afrique. Autant de caractéristiques, donc, que l’on retrouve dans la description de l’Âge de fer proposée par Hésiode. Enfin, les nombreuses ingérences et influences étrangères au Moyen-Orient constituent une autre faiblesse caractéristique d’un Âge de fer redéfini. Ne pouvant se suffire à lui-même, ne pouvant gérer et résoudre les problèmes auxquels il doit faire face, le Moyen-Orient est en proie à la prédation d’acteurs exogènes qui influent sur son destin : l’Europe à travers les accords Sykes-Picot, les États-Unis dans les années 1990 et 2000, le retour de la Russie récemment, etc. Ainsi, Kamal Bayramzadeh résume de la sorte la situation actuelle que nous avons qualifié d’ « Âge de fer » : « Le Moyen-Orient se trouve dans une situation de crise profonde marquée par la déstabilisation de plusieurs pays, l’aggravation de l’insécurité régionale, le risque de conflits religieux et, finalement, une possibilité de balkanisation. » Pour autant, ce tableau noir ne doit pas reléguer dans l’oubli certains aspects louables : « Toutefois quelques biens se mêleront à tant de maux. » (Les Travaux et les Jours, Hésiode) En effet, il s’agit d’apporter un regard critique sur la situation du Moyen-Orient que nous avons défini : s’il se trouve en effet dans une mauvaise passe qualifiée d’Âge de fer, il ne fait pas l’ombre d’un doute que le souvenir de l’Âge d’or islamique hante de nombreux acteurs de cette région. Il reste ainsi l’un des fondements de l’idéologie contemporaine du panislamisme ou du panarabisme. Dès lors, regarder la situation du Moyen-Orient à la lumière de l’analyse occidentale de Hésiode permet en effet d’y déceler des dynamiques qui passeraient inaperçues autrement. Tom Caillet Puisqu'il est de coutume de dresser le bilan de l'année passée, voyons un peu combien de libertés nous avons perdues en 2016. Je ne parle pas des grandes libertés civiles, déjà gravement mises à mal par la loi renseignement ou l'état d'urgence, mais des petites libertés quotidiennes qui font le charme de la vie en société. Nos sagaces représentants ont ainsi décidé de nous interdire, dans le désordre : les vitres teintées pour les voitures (dès lors que le taux de transparence, précise le décret, est inférieur à 70 %) ; la fessée pour les enfants (et même « tout recours aux violences corporelles » : quid alors des emmaillotages de nouveau-nés ?) ; la moto sans gants (pour savoir quels gants sont homologués, prière de vous référer à la directive CE 89/686, sans quoi vous perdrez 1 point de permis) ; les sacs de caisse en plastique (d'une épaisseur inférieure à 50 microns, merci de vérifier à l'aide d'un microscope) ; les véhicules anciens dans les rues de Paris (immatriculés avant le 1er janvier 1997 : place aux Millennials) ; la cigarette électronique sur le lieu de travail (car, comprenez-vous, le geste « rappelle celui de fumer » et « pourrait devenir un point d'entrée vers le tabagisme », nous dit le législateur) ; et, « last but not least », l'achat d'actes sexuels (mais pas leur vente : comprenne qui pourra !). Ce n'est plus l'Etat-nounou, mais l'Etat Folcoche, comme la marâtre de « Vipère au poing ». Ce sont des détails, me direz-vous ! Justement. Ainsi que l'écrit Tocqueville dans les derniers chapitres, fameux et hélas toujours aussi pertinents, de son livre « De la démocratie en Amérique », « on oublie que c'est surtout dans le detail qu'il est dangereux d'asservir les hommes » : ils perdent peu à peu la pratique de la liberté, et le goût de la défendre. C'est pour notre bien, me direz-vous : n'est-il pas préférable pour les enfants d'échapper à la baffe, pour la nature d'être préservée des plastiques et des pots d'échappement, pour les femmes (et les hommes) de ne pas être traité(e)s en objets sexuels, et pour la police de pouvoir observer les conducteurs de 4 × 4 suspects ? Justement. Tocqueville voyait émerger avec frayeur au-dessus des citoyens ce « pouvoir immense et tutélaire » qui « travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en etre l'unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit a leur securite, prevoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, [...] que ne peut-il leur oter entierement le trouble de penser et la peine de vivre ? » Nous abandonnons année après année des libertés trop fatigantes, en nous rapprochant toujours davantage de ce « despotisme démocratique » redouté par le lumineux philosophe il y a près de deux siècles. En dépit de nos badineries sur les moeurs et de nos prétentions progressistes, nous avons développé collectivement une forme de morale d'Etat plus répressive et ubiquiste que le clergé de jadis. Comme toute morale, elle génère une redoutable hypocrisie, qui pourchasse les vices des faibles plutôt que de dénoncer les crimes des forts. On impose des paquets neutres aux fumeurs, mais on déploie des trésors de diplomatie pour vendre nos Rafales sans images dissuasives de villes sous les bombes". On refuse aux vieilles guimbardes l'entrée de Paris, mais on continue à subventionner massivement les énergies fossiles. On invoque la dignité humaine, mais on dénie aux prostitué(e)s les garanties légales qui leur permettraient d'exercer correctement un métier difficile. Tartuffes ! A la symbolique de la sanction, il serait pourtant possible de substituer une éthique de la responsabilité. En instaurant une taxe carbone pour protéger notre environnement. En faisant payer, via des mécanismes d'assurance, ceux qui viennent engorger les hôpitaux pour avoir conduit une moto sans protection adéquate. En légalisant et régulant les activités prostitutionnelles pour mieux sévir contre la traite et l'exploitation. En appliquant l'article du Code pénal qui condamne à juste titre la maltraitance à l'égard des enfants. Bref, en élaborant des politiques publiques qui nous traitent en adultes. Faute de quoi, les trois quarts de Français qui, selon l'institut Viavoice, estiment souffrir d'un trop grand nombre d'interdits, risquent bien de se rebeller. Je propose donc une bonne résolution à nos responsables politiques pour 2017, facile à tenir, et inspirée de notre président-poète Georges Pompidou : « Arrêtez de nous emmerder. » Gaspard Koenig Publié dans les Echos Auguste, Louis XIV, Lénine, Churchill : des noms qui, parmi tant d’autres, sont des étiquettes que l’on pose sur des époques ou des doctrines politiques bien différentes ; pour autant, au moins un point commun les relie entre eux : ils appartiennent à des grands hommes politiques. Cependant, en cherchant dans le monde contemporain, on peine à en trouver de semblables (concernant Barack Obama, l’Histoire décidera s’il en est un ou non ; pour Vladimir Poutine, nous y reviendrons plus bas). Avant toute chose, il convient de définir ce que peut être un grand homme. Si ses actes prennent sens de son vivant, il se définit aussi au moment et après sa mort, au sens où un grand homme est un grand mort, c'est-à-dire qu'il assurera une certaine permanence au groupe auquel il appartient : il est immortel. L’autre aspect du grand homme est qu’il comprend mieux que quiconque la culture à laquelle il appartient. Condamné par le groupe, il n'évite jamais les sanctions de celui-ci ; il accepte la sentence de ceux qui le condamnent. On pourrait dire que la ciguë a fait Socrate, et que Ponce Pilate a fait Jésus. Donc, d'une part, le grand homme est celui qui persuade le groupe qu'il est un grand homme et surtout qu'il fera un grand mort, qu'il lui donnera une sorte de continuité, et, d'autre part, c'est celui qui le confronte mais l'accepte, ce n'est pas quelqu'un qui se dérobe à la loi du groupe. Enfin, celui qui devient grand homme est caractérisé intrinsèquement par l’hubris, cette démesure propre aux héros et dieux grecs, au sens où « la gloire est le soleil des morts » (Balzac). Ainsi la mort des grands hommes n’est-elle que l’allégorie de leur raréfaction, à plus forte raison de celle des grands hommes politiques : De Gaulle, Churchill, Mao, Lénine... Si certains d’entre eux sont controversés, on ne peut nier leur appartenance à la catégorie des grands hommes politiques si l’on s’en tient à la définition précédente. Leur disparition ou raréfaction est corrélative à celle du charisme en politique. Laissons place, ici, à ces extraits révélateurs de L’Empire Gréco-Romain de Paul Veyne : « Ce qui ressort du livre de Zanker [Augustus und die Macht der Bilder] est un tertium quid : ni propagande, ni faste, mais charisme. [...] Auguste a été l'objet d'une exaltation sui generis, celle que vouent au chef d'une croisade ceux qui suivent son entreprise avec enthousiasme, celle que désigne le mot “charisme“, si souvent employé à tort. Un chef charismatique doit éviter de déployer trop de faste [...]. Auguste n'en déployait guère ; son vêtement était aussi modeste que son logis. ll mit de l'éclat non sur sa personne ni sur sa couronne, mais sur sa mission et sur sa dynastie. [...] Ainsi s'est mis en place ce qui restera l'originalité unique (bien plus que la « couverture idéologique ») du césarisme pendant quatre siècles : le prince est un bon citoyen qui a pu se mettre en avant pour prendre en main les intérêts de ce qui s’appellera jusqu'à la fin la République. L'autorité d'Auguste fut celle d'un champion de la République qui devait son autorité a son mérite ; il avait été élu par les dieux pour remplir une mission patriotique : régénérer Rome ou du moins lui rendre un visage moral et religieux qui fût digne d'elle [...] et ouvrir en espoir, en intention, un âge de paix et de prospérité. Cette exaltation d'un chef de croisade par ses croisés est de tous les temps ; ce charisme, personnel par définition, est bien différent de l'attachement, aussi machinal que le faste, qui entourait jadis chaque souverain, ses prédécesseurs et ses successeurs. » Pourtant, doit-on les regretter, ou du moins se morfondre dans ce passé où le charisme, en plus des autres caractéristiques propres aux grands hommes, était présent dans les hautes sphères de la polis ? Certains l’affirmeront et y verront la déliquescence du monde politique et de ses dirigeants, l’avènement de ce qu’ils appellent la mesquinerie politique, la perte du pouvoir citoyen, la technocratie. Néanmoins, ici sévit le symptôme du pouvoir aveuglant qui n’est plus à la mesure de ses sujets. Ce pouvoir est devenu trop lourd à porter en ces temps incertains. Certains proposeront une alternative citoyenne, pensant qu’elle serait apte à résoudre les problèmes aussi bien nationaux (crise économique, chômage, injustices sociales) qu’internationaux (passivité de l’ONU, guerres à répétition). Mais la disparition du grand homme ne serait-il pas moins qu’un autre mythe politique ? Raoul Girardet, dans Mythes et mythologies politiques (1986), en identifie quatre : la conspiration, le sauveur, l’âge d’or et l’unité. Le mythe du sauveur est ici celui qui nous intéresse. Selon Raoul Girardet, la « constellation » du sauveur se structure autour de quatre types : le modèle de Cincinnatus, c’est-à-dire celui du vieil homme expérimenté, qui, après avoir autrefois rendu service à la nation, s’est retiré, et qu’on rappelle pour faire face à un nouveau danger (Philippe Pétain) ; le modèle d’Alexandre le Grand, dont la légitimité est ancrée dans le présent immédiat, et qui connaît le temps d’un éclair une gloire étincelante avant d’être foudroyé (Napoléon) ; celui de Solon, c’est- à-dire du père fondateur, dont la sagesse fait la légitimité ; et celui de Moïse, le prophète, le guide, tel Napoléon prophétisant la libération des peuples à Sainte-Hélène, ou De Gaulle en 1958. Si ces quatre modèles forment des types distincts, ils permettent aussi de relever des permanences, des structures parallèles. Ainsi le « processus d’héroïsation » se découpe-t-il toujours en trois phases : l’appel, l’avènement, puis les relectures postérieures de l’action du sauveur. Si certains ne seront que des grands hommes nationaux (Vladimir Poutine pour une majorité de Russes par exemple), il est sans conteste évident que les bouleversements politiques auxquels nous assistons (élection de Donald Trump aux Etats-Unis, montée des populismes en Europe) trahissent trop le vide de grands hommes qui est comblé par ceux qui ont le courage d’entrer dans le monde politique mais qui ont la peur de faire du politique. C’est donc en analysant l’exercice du pouvoir par les grands hommes politiques que l’on remarque que tous, sans exception, ont une maîtrise du pouvoir, au sens où il le possède. Il faut alors, au lieu de le limiter et de le séparer, redonner le pouvoir à l’homme politique, à la figure du dirigeant contemporain, c’est-à-dire jouer avec prudence (au sens étymologique, c’est-à-dire avec sagesse) sur la ligne qui sépare le pouvoir éclaté du pouvoir concentré. En effet, c’est que le pouvoir a été de plus en plus contraint au fil de l’Histoire, avec davantage de limites qui nuisent à l’avènement et aux actions des grands hommes que l’on chérit tant et que l’on aimerait voir revenir. Tom Caillet Irons-nous mourir pour Dantzig, demandait Marcel Déat lorsque le IIIe Reich revendiquait cette ville libre en partie peuplée par des allemands. C’est toujours sur les villes libres que s’abattent la barbarie et la dictature des puissants, ceux-là même qui ne reculent pas devant les martyrs. Et c’est dans ces villes symboles qu’intellectuels, politiques, peuples et idées humaines se cachent derrière les murailles de leur propre lâcheté. L’humanité se terre derrière les murailles qu’elle croit inébranlable. L’humanité a quitté Alep. Elle a trop peur.
Nos immobilismes, à l’abri des bombes, papillonnent sous les lumières tamisées de Noël et sur les pavés réchauffés par la cannelle et le vin chaud. Comme toujours, la France et les Français se sont gavés de leur prétention historique à être meilleurs que les anciens. Les uns pensaient que le courage était héréditaire et se riaient bien de ces Français ayant vécu entre 39 et 45 comme si le monde ne s’était pas effondré. Les autres observaient leurs aïeux d’un air consterné, ne cessant de se demander comment l’Humanité avait pu disparaître de la surface du globe pendant de si longues années. Si tous les crimes et toutes les compromissions étaient justifiables au nom de la lutte contre le communisme, c’est aujourd’hui la lutte contre Daech qui vient excuser les plus grandes atrocités. L’Histoire a frappé une nouvelle fois notre génération sans qu’elle ne s’en rende compte. Ses enfants jugeront son silence, attendant patiemment que leur lâcheté n’arrive à son tour. Il fut un temps où Alep était comme Paris, ce soir, après l’Opéra. Il y avait à Alep les lumières des hommes heureux. Il y avait à Alep ces couples avançant bras dessus bras dessous, dans les rues chaudes et dans le réconfort du calme et de la paix. Il y avait à Alep ces enfants qui courraient, malicieux, dans les rues peuplées et vivantes de l’inconscience étourdie. Mais nous sommes restés sourds face à ces mêmes cris qui insupportaient nos âmes au Bataclan, à Nice, à l’Hyper-Cacher, à Hozar-Atorah ou dans les locaux de Charlie. L’humanité avait pourtant besoin d’Alep heureuse. Non, nous n’avons pas entendu l’Humanité gémir au fond d’un trou, nous avons écouté bouchers et criminels justifiant tout par la « géopolitique ». Non, nous n’avons pas entendu les femmes et les enfants d’Alep bastonnés par les bottes des assassins. Médias et journalistes ont cru bon d’éclairer les choix de Poutine et d’Assad par des considérations politiquement rationnelles. Effrayés par la liberté, ravagés par l’idiotie et remplis de ce que la France sait faire de plus dégueulasse, des élus sans légitimité ont eu le culot de se faire photographier avec Assad comme des groupies avec leur icône. Quand Alep hurlait et implorait, la France était à Damas. Alep qui tombe, c’est la France qui gémit. Un peuple meurt devant nous sous les rafales de chasseurs qui vrillent dans les airs. L’esprit de la France est si loin. La France s’est éteint avec Alep. J’espère qu’un jour, la France redeviendra la France. Suffit-il de crier aux oreilles d’un peuple endormi par l’impuissance de croire en quoi que ce soit que la France existe ? Il faudra peut-être alors que politiciens et technocrates se taisent et que ce qui a fait la France redevienne la boussole d’un peuple que je ne reconnais plus. Pour le moment, la France contemple d’un œil sénile les horreurs d’un Poutine qu’elle admire car elle le pense courageux quand il n’a que le courage de l’oppression des plus faibles. De Gaulle disait qu’il y avait un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté des autres … Malraux ajoutait que notre pays ne trouvait son âme que lorsqu’il la trouvait pour les autres. C’est aux abimes que nous avons renvoyé notre âme, un par un. C’est sans voix qu’à mon tour je m’indigne sans avoir rien fait pour sauver ces vies qui en valaient la peine. Ce soir, lorsque le soleil se couchera, Alep sera vide. Millénaire, la ville n’avait jamais connu le silence éternel des cités mortes. Malgré les guerres et les crimes, malgré la barbarie et l’horreur, Alep avait toujours défendu son droit à la vie. Il aura fallu attendre 2016, le progrès, l’Europe, les Droits de l’Homme et l’ONU pour voir son pavillon se baisser et renoncer face au silence complice de ceux qui ne voulaient pas entendre les larmes et les cœurs. La mort, elle, continue son œuvre. Elle n’écoute pas les sanglots des enfants prisonniers des décombres et des vestiges des vies qu’ils ne verront jamais. Non, la mort est trop occupée à signer son passage d’une mare de sang sur les ruines gisantes d’Alep accablée. Loïs Henry Pourquoi voulons-nous que nos enfants croient au Père Noël ? Voici la réponse lumineuse du célèbre anthropologue, disparu le 30 octobre 2009. Et si les Indiens Pueblo d’Amérique de l’Ouest, avec leur croyance dans l’esprit des morts, nous permettaient de comprendre la fonction du Père Noël ? Voilà le détour étonnant que propose Claude Lévi-Strauss et qui lui permet de prédire un long avenir à ce « nouveau » rite païen. C’était en 1952, dans un article intitulé « Le Père Noël supplicié » paru dans Les Temps modernes. Les catholiques brûlaient alors l’effigie du Père Noël quand des intellectuels de gauche dénonçaient un mythe créé par la société de consommation. Dans une magistrale leçon d’anthropologie structurale appliquée, Lévi-Strauss démontre que la croyance au Père Noël n’est pas seulement une mystification infligée par les adultes aux enfants, mais une forme d’échange, « le résultat d’une transaction fort onéreuse » : en comblant les enfants de leur générosité, les vivants règlent leurs comptes avec les morts ! Comme toujours chez l’anthropologue, la comparaison des mythes a une fonction ultime qui est profondément philosophique. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé à Claude Lévi- Strauss l’autorisation de publier des extraits de ce texte à la veille de Noël. Il nous avait amicalement donné son accord le 17 octobre 2009. Aujourd’hui, au lendemain de sa disparition survenue le 30 octobre, c’est une occasion redoublée pour nous de saluer l’un des plus grands penseurs du siècle. Les fêtes de Noël 1951 auront été marquées, en France, par une polémique à laquelle la presse et l’opinion semblent s’être montrées fort sensibles et qui a introduit dans l’atmosphère joyeuse habituelle à cette période de l’année une note d’aigreur inusitée. Depuis plusieurs mois déjà, les autorités ecclésiastiques, par la bouche de certains prélats, avaient exprimé leur désapprobation de l’importance croissante accordée par les familles et les commerçants au personnage du Père Noël. Elles dénonçaient une « paganisation » inquiétante de la fête de la Nativité, détournant l’esprit public du sens proprement chrétien de cette commémoration, au profit d’un mythe sans valeur religieuse. Ces attaques se sont développées à la veille de Noël ; avec plus de discrétion sans doute, mais autant de fermeté, l’Église protestante a joint sa voix à celle de l’Église catholique. Déjà, des lettres de lecteurs et des articles apparaissaient dans les journaux et témoignaient, dans des sens divers mais généralement hostiles à la position ecclésiastique, de l’intérêt éveillé par cette affaire. Enfin, le point culminant fut atteint le 24 décembre, à l’occasion d’une manifestation dont le correspondant du journal France-Soir a rendu compte en ces termes : Devant les enfants des patronages, le Père Noël a été brûlé sur le parvis de la cathédrale de Dijon Dijon, 24 décembre (dép. France-Soir) Le Père Noël a été pendu hier après-midi aux grilles de la cathédrale de Dijon et brûlé publiquement sur le parvis. Cette exécution spectaculaire s’est déroulée en présence de plusieurs centaines d’enfants des patronages. Elle avait été décidée avec l’accord du clergé qui avait condamné le Père Noël comme usurpateur et hérétique. Il avait été accusé de paganiser la fête de Noël et de s’y être installé comme un coucou en prenant une place de plus en plus grande. On lui reproche surtout de s’être introduit dans les écoles publiques d’où la crèche est scrupuleusement bannie. Dimanche à trois heures de l’après-midi, le malheureux bonhomme à barbe blanche a payé comme beaucoup d’innocents une faute dont s’étaient rendus coupables ceux qui applaudiront à son exécution. Le feu a embrasé sa barbe et il s’est évanoui dans la fumée. […] « Il ne s'agit pas de justifier les raisons pour lesquelles le Père Noël plaît aux enfants, mais bien celles qui ont poussé les adultes à l'inventer »Le jour même, le supplice du Père Noël passait au premier rang de l’actualité ; pas un journal qui ne commentât l’incident […]. Le ton de la plupart des articles est celui d’une sensiblerie pleine de tact : il est si joli de croire au Père Noël, cela ne fait de mal à personne, les enfants en tirent de grandes satisfactions et font provision de délicieux souvenirs pour l’âge mûr, etc. En fait, on fuit la question au lieu d’y répondre, car il ne s’agit pas de justifier les raisons pour lesquelles le Père Noël plaît aux enfants, mais bien celles qui ont poussé les adultes à l’inventer. […] Nous sommes en présence d’une manifestation symptomatique d’une très rapide évolution des mœurs et des croyances, d’abord en France, mais aussi sans doute ailleurs. Ce n’est pas tous les jours que l’ethnologue trouve ainsi l’occasion d’observer, dans sa propre société, la croissance subite d’un rite, et même d’un culte ; d’en rechercher les causes et d’en étudier l’impact sur les autres formes de la vie religieuse ; enfin d’essayer de comprendre à quelles transformations d’ensemble, à la fois mentales et sociales, se rattachent des manifestations visibles sur lesquelles l’Église – forte d’une expérience traditionnelle en ces matières – ne s’est pas trompée, au moins dans la mesure où elle se bornait à leur attribuer une valeur significative. Depuis trois ans environ, c’est-à-dire depuis que l’activité économique est redevenue à peu près normale, la célébration de Noël a pris en France une ampleur inconnue avant-guerre. Il est certain que ce développement, tant par son importance matérielle que par les formes sous lesquelles il se produit, est un résultat direct de l’influence et du prestige des États-Unis d’Amérique. Ainsi, on a vu simultanément apparaître les grands sapins dressés aux carrefours ou sur les artères principales, illuminés la nuit ; les papiers d’emballage historiés pour cadeaux de Noël ; les cartes de vœux à vignette, avec l’usage de les exposer pendant la semaine fatidique sur la cheminée du récipiendaire ; les quêtes de l’Armée du Salut suspendant ses chaudrons en guise de sébiles sur les places et dans les rues ; enfin les personnages déguisés en Père Noël pour recevoir les suppliques des enfants dans les grands magasins. [...] En second lieu, il ne faut pas oublier que, dès avant la guerre, la célébration suivait en France et dans toute l’Europe une marche ascendante. Le fait est d’abord lié à l’amélioration progressive du niveau de vie ; mais il comporte aussi des causes plus subtiles. Avec les traits que nous lui connaissons, Noël est essentiellement une fête moderne et cela malgré la multiplicité des caractères archaïsants. L’usage du gui n’est pas, au moins immédiatement, une survivance druidique, car il paraît avoir été remis à la mode au Moyen Âge. Le sapin de Noël n’est mentionné nulle part avant certains textes allemands du XVIIe siècle ; il passe en Angleterre au XVIIIe siècle, en France au XIXe seulement. Littré paraît mal le connaître, ou sous une forme assez différente de la nôtre puisqu’il le définit comme se disant « dans quelques pays, d’une branche de sapin ou de houx diversement ornée, garnie surtout de bonbons et de joujoux pour donner aux enfants, qui s’en font une fête » (art. Noël). La diversité des noms donnés au personnage ayant le rôle de distribuer des jouets aux enfants, Père Noël, saint Nicolas, Santa Claus, montre aussi qu’il est le produit d’un phénomène de convergence et non un prototype ancien partout conservé. [...] Le Père Noël est vêtu d’écarlate : c’est un roi. Sa barbe blanche, ses fourrures et ses bottes, le traîneau dans lequel il voyage, évoquent l’hiver. On l’appelle « Père » et c’est un vieillard, donc il incarne la forme bienveillante de l’autorité des anciens. Tout cela est assez clair, mais dans quelle catégorie convient-il de le ranger, du point de vue de la typologie religieuse ? Ce n’est pas un être mythique, car il n’y a pas de mythe qui rende compte de son origine et de ses fonctions ; et ce n’est pas non plus un personnage de légende puisque aucun récit semi-historique ne lui est attaché. En fait, cet être surnaturel et immuable, éternellement fixé dans sa forme et défini par une fonction exclusive et un retour périodique, relève plutôt de la famille des divinités ; il reçoit d’ailleurs un culte de la part des enfants, à certaines époques de l’année, sous forme de lettres et de prières ; il récompense les bons et prive les méchants. C’est la divinité d’une classe d’âge de notre société (classe d’âge que la croyance au Père Noël suffit d’ailleurs à caractériser), et la seule différence entre le Père Noël et une divinité véritable est que les adultes ne croient pas en lui, bien qu’ils encouragent leurs enfants à y croire et qu’ils entretiennent cette croyance par un grand nombre de mystifications. « Le père Noël est d'abord l'expression d'un statut différentiel entre les petits enfants d'une part, les adolescents et les adultes de l'autre »Le Père Noël est donc, d’abord, l’expression d’un statut différentiel entre les petits enfants d’une part, les adolescents et les adultes de l’autre. À cet égard, il se rattache à un vaste ensemble de croyances et de pratiques que les ethnologues ont étudiées dans la plupart des sociétés, à savoir les rites de passages et d’initiation. Il y a peu de groupements humains, en effet, où, sous une forme ou sous une autre, les enfants (parfois aussi les femmes) ne soient exclus de la société des hommes par l’ignorance de certains mystères ou la croyance – soigneusement entretenue – en quelque illusion que les adultes se réservent de dévoiler au moment opportun, consacrant ainsi l’agrégation des jeunes générations à la leur. Parfois, ces rites ressemblent de façon surprenante à ceux que nous examinons en ce moment. Comment, par exemple, ne pas être frappé de l’analogie qui existe entre le Père Noël et les katchina des Indiens du sud-ouest des États-Unis ? Ces personnages costumés et masqués incarnent des dieux et des ancêtres ; ils reviennent périodiquement visiter leur village pour y danser, et pour punir ou récompenser les enfants, car on s’arrange pour que ceux-ci ne reconnaissent pas leurs parents ou familiers sous le déguisement traditionnel. Le Père Noël appartient certainement à la même famille, avec d’autres comparses maintenant rejetés à l’arrière-plan : Croquemitaine, Père Fouettard, etc. Il est extrêmement significatif que les mêmes tendances éducationnelles qui proscrivent aujourd’hui l’appel à ces katchina punitives aient abouti à exalter le personnage bienveillant du Père Noël, au lieu – comme le développement de l’esprit positif et rationaliste aurait pu le faire supposer – de l’englober dans la même condamnation. Il n’y a pas eu à cet égard de rationalisation des méthodes d’éducation, car le Père Noël n’est pas plus « rationnel » que le Père Fouettard (l’Église a raison sur ce point) : nous assistons plutôt à un déplacement mythique, et c’est celui-ci qu’il s’agit d’expliquer. Il est bien certain que rites et mythes d’initiation ont, dans les sociétés humaines, une fonction pratique : ils aident les aînés à maintenir leurs cadets dans l’ordre et l’obéissance. Pendant toute l’année, nous invoquons la visite du Père Noël pour rappeler à nos enfants que sa générosité se mesurera à leur sagesse ; et le caractère périodique de la distribution des cadeaux sert utilement à discipliner les revendications enfantines, à réduire à une courte période le moment où ils ont vraiment droit à exiger des cadeaux. Mais ce simple énoncé suffit à faire éclater les cadres de l’explication utilitaire. Car d’où vient que les enfants aient des droits, et que ces droits s’imposent si impérieusement aux adultes que ceux-ci soient obligés d’élaborer une mythologie et un rituel coûteux et compliqués pour parvenir à les contenir et à les limiter ? On voit tout de suite que la croyance au Père Noël n’est pas seulement une mystification infligée plaisamment par les adultes aux enfants ; c’est, dans une très large mesure, le résultat d’une transaction fort onéreuse entre les deux générations. Il en est du rituel entier comme des plantes vertes – sapin, houx, lierre, gui – dont nous décorons nos maisons. Aujourd’hui, luxe gratuit, elles furent jadis, dans quelques régions au moins, l’objet d’un échange entre deux classes de la population : à la veille de Noël, en Angleterre, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle encore, les femmes allaient a gooding, c’est-à-dire elles quêtaient de maison en maison et fournissaient les donateurs de rameaux verts en retour. Nous retrouverons les enfants dans la même position de marchandage, et il est bon de noter ici que, pour quêter à la Saint-Nicolas, les enfants se déguisaient parfois en femmes : femmes, enfants, c’est-à-dire dans les deux cas non-initiés. Or, il est un aspect fort important des rituels d’initiation auquel on n’a pas toujours prêté une attention suffisante, mais qui éclaire plus profondément leur nature que les considérations utilitaires évoquées au paragraphe précédent. Prenons comme exemple le rituel des katchina propre aux Indiens Pueblo, dont nous avons déjà parlé. Si les enfants sont tenus dans l’ignorance de la nature humaine des personnages incarnant les katchina, est-ce seulement pour qu’ils les craignent ou les respectent, et se conduisent en conséquence ? Oui, sans doute, mais cela n’est que la fonction secondaire du rituel ; car il y a une autre explication, que le mythe d’origine met parfaitement en lumière. Ce mythe explique que les katchina sont les âmes des premiers enfants indigènes, dramatiquement noyés dans une rivière à l’époque des migrations ancestrales. Les katchina sont donc, à la fois, preuve de la mort et témoignage de la vie après la mort. Mais il y a plus : quand les ancêtres des Indiens actuels se furent enfin fixés dans leur village, le mythe rapporte que les katchina venaient chaque année leur rendre visite et qu’en partant elles emportaient les enfants. Les indigènes, désespérés de perdre leur progéniture, obtinrent des katchina qu’elles restassent dans l’au-delà, en échange de la promesse de les représenter chaque année au moyen de masques et de danses. Si les enfants sont exclus du mystère des katchina, ce n’est donc pas d’abord ni surtout, pour les intimider. Je dirais volontiers que c’est pour la raison inverse : c’est parce qu’ils sont les katchina. Ils sont tenus en dehors de la mystification, parce qu’ils représentent la réalité avec laquelle la mystification constitue une sorte de compromis. Leur place est ailleurs : non pas avec les masques et avec les vivants, mais avec les dieux et avec les morts ; avec les dieux qui sont les morts. Et les morts sont les enfants. Nous croyons que cette interprétation peut être étendue à tous les rites d’initiation et même à toutes les occasions où la société se divise en deux groupes. La « non-initiation » n’est pas purement un état de privation, défini par l’ignorance, l’illusion ou autres connotations négatives. Le rapport entre initiés et non-initiés a un contenu positif. C’est un rapport complémentaire entre deux groupes dont l’un représente les morts et l’autre les vivants. Au cours même du rituel, les rôles sont d’ailleurs souvent intervertis, et à plusieurs reprises, car la dualité engendre une réciprocité de perspectives qui, comme dans le cas des miroirs se faisant face, peut se répéter à l’infini : si les non-initiés sont les morts, ce sont aussi de super-initiés ; et si, comme cela arrive souvent aussi, ce sont les initiés qui personnifient les fantômes des morts pour épouvanter les novices, c’est à ceux-ci qu’il appartiendra, dans un stade ultérieur du rituel, de les disperser et de prévenir leur retour. Sans pousser plus avant ces considérations qui nous éloigneraient de notre propos, il suffira de se rappeler que, dans la mesure où les rites et les croyances liés au Père Noël relèvent d’une sociologie initiatique (et cela n’est pas douteux), ils mettent en évidence, derrière l’opposition entre enfants et adultes, une opposition plus profonde entre morts et vivants. [...] Il est généralement admis par les historiens des religions et par les folkloristes que l’origine lointaine du Père Noël se trouve dans cet abbé de Liesse, Abbas Stultorum, abbé de la Malgouverné qui traduit exactement l’anglais Lord of Misrule, tous personnages qui sont, pour une durée déterminée, rois de Noël et en qui on reconnaît les héritiers du roi des Saturnales de l’époque romaine. Or les Saturnales étaient la fête des larvae, c’est-à-dire des morts par violence ou laissés sans sépulture, et derrière le vieillard Saturne dévoreur d’enfants se profilent, comme autant d’images symétriques, le bonhomme Noël, bienfaiteur des enfants ; le Julebok scandinave, démon cornu du monde souterrain porteur de cadeaux aux enfants ; saint Nicolas qui les ressuscite et les comble de présents ; enfin les katchina, enfants précocement morts, qui renoncent à leur rôle de tueuses d’enfants pour devenir alternativement dispensatrices de châtiments et de cadeaux. [...] Les explications par survivance sont toujours incomplètes ; car les coutumes ne disparaissent ni ne survivent sans raison. Quand elles subsistent, la cause s’en trouve moins dans la viscosité historique que dans la permanence d’une fonction que l’analyse du présent doit permettre de déceler. Si nous avons donné aux Indiens Pueblo une place prédominante dans notre discussion, c’est précisément parce que l’absence de toute relation historique concevable entre leurs institutions et les nôtres (si l’on excepte certaines influences espagnoles tardives, au XVIIe siècle) montre bien que nous sommes en présence, avec les rites de Noël, non pas seulement de vestiges historiques, mais de formes de pensée et de conduite qui relèvent des conditions les plus générales de la vie en société. Les Saturnales et la célébration médiévale de Noël ne contiennent pas la raison dernière d’un rituel autrement inexplicable et dépourvu de signification ; mais elles fournissent un matériel comparatif utile pour dégager le sens profond d’institutions récurrentes. Il n’est pas étonnant que les aspects non chrétiens de la fête de Noël ressemblent aux Saturnales, puisqu’on a de bonnes raisons de supposer que l’Église a fixé la date de la Nativité au 25 décembre (au lieu de mars ou de janvier) pour substituer sa commémoration aux fêtes païennes qui se déroulaient primitivement le 17 décembre, mais qui, à la fin de l’Empire, s’étendaient sur sept jours, c’est-à-dire jusqu’au 24. En fait, depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, les « fêtes de décembre » offrent les mêmes caractères. D’abord la décoration des édifices avec des plantes vertes ; ensuite les cadeaux échangés, ou donnés aux enfants ; la gaîté et les festins ; enfin la fraternisation entre les riches et les pauvres, les maîtres et les serviteurs. Quand on analyse les faits de plus près, certaines analogies de structure également frappantes apparaissent. Comme les Saturnales romaines, la Noël médiévale offre deux caractères syncrétiques et opposés. C’est d’abord un rassemblement et une communion : la distinction entre les classes et les états est temporairement abolie, esclaves ou serviteurs s’asseyent à la table des maîtres et ceux-ci deviennent leurs domestiques ; les tables, richement garnies, sont ouvertes à tous ; les sexes échangent les vêtements. Mais, en même temps, le groupe social se scinde en deux : la jeunesse se constitue en corps autonome, elle élit son souverain, abbé de la Jeunesse, ou, comme en Écosse Abbot of Unreason ; et, comme ce titre l’indique, elle se livre à une conduite déraisonnable se traduisant par des abus commis au préjudice du reste de la population et dont nous savons que, jusqu’à la Renaissance, ils prenaient les formes les plus extrêmes : blasphème, vol, viol et même meurtre. Pendant la Noël comme pendant les Saturnales, la société fonctionne selon un double rythme de solidarité accrue et d’antagonisme exacerbé, et ces deux caractères sont donnés comme un couple d’oppositions corrélatives. Le personnage de l’abbé de Liesse effectue une sorte de médiation entre ces deux aspects. Il est reconnu et même intronisé par les autorités régulières ; sa mission est de commander les excès tout en les contenant dans certaines limites. Quel rapport y a-t-il entre ce personnage et sa fonction, et le personnage et la fonction du Père Noël, son lointain descendant ? Il faut ici distinguer soigneusement entre le point de vue historique et le point de vue structural. Historiquement, nous l’avons dit, le Père Noël de l’Europe occidentale, sa prédilection pour les cheminées et pour les chaussures, résultent purement et simplement d’un déplacement récent de la fête de saint Nicolas, assimilée à la célébration de Noël, trois semaines plus tard. Cela nous explique que le jeune abbé soit devenu un vieillard ; mais seulement en partie, car les transformations sont plus systématiques que le hasard des connexions historiques et calendaires ne réussirait à le faire admettre. Un personnage réel est devenu un personnage mythique ; une émanation de la jeunesse, symbolisant son antagonisme par rapport aux adultes, s’est changée en symbole de l’âge mûr dont il traduit les dispositions bienveillantes envers la jeunesse ; l’apôtre de l’inconduite est chargé de sanctionner la bonne conduite. Aux adolescents ouvertement agressifs envers les parents se substituent les parents se cachant sous une fausse barbe pour combler les enfants. Le médiateur imaginaire remplace le médiateur réel et, en même temps qu’il change de nature, il se met à fonctionner dans l’autre sens. [...] Mais examinons plutôt le rôle des enfants. Au Moyen Âge, les enfants n’attendent pas dans une patiente expectative la descente de leurs jouets par la cheminée. Généralement déguisés et formés en bande que le vieux français nomme, pour cette raison, « guisards », ils vont de maison en maison chanter et présenter leurs vœux, recevant en échanges des fruits et des gâteaux. Fait significatif, ils évoquent la mort pour faire valoir leur créance. Ainsi au XVIIIe siècle, en Écosse, ils chantent ce couplet : Rise up, good wife, and be no’ swier (lazy) To deal your bread as long’s you’re here ; The time will come when you’ll be dead, And neither want nor meal nor bread. 1 Si même nous ne possédions pas cette précieuse indication et celle, non moins significative, du déguisement qui transforme les acteurs en esprits ou fantômes, nous en aurions d’autres, tirées de l’étude des quêtes d’enfants. On sait que celles-ci ne sont pas limitées à Noël 2. Elles se succèdent pendant toute la période critique de l’automne, où la nuit menace le jour comme les morts se font harceleurs des vivants. Les quêtes de Noël commencent plusieurs semaines avant la Nativité, généralement trois, établissant donc la liaison avec les quêtes, également costumées, de la fête de saint Nicolas qui ressuscita les enfants morts ; et leur caractère est encore mieux marqué dans la quête initiale de la saison, celle de Hallow-Even – devenue veille de la Toussaint par décision ecclésiastique – où, aujourd’hui encore dans les pays anglo-saxons, les enfants costumés en fantômes et en squelettes persécutent les adultes à moins que ceux-ci rédiment leur repos au moyen de menus présents. Le progrès de l’automne, depuis son début jusqu’au solstice qui marque le sauvetage de la lumière et de la vie, s’accompagne donc, sur le plan rituel, d’une démarche dialectique dont les principales étapes sont : le retour des morts, leur conduite menaçante et persécutrice, l’établissement d’un modus vivendi avec les vivants fait d’un échange de services et de présents, enfin le triomphe de la vie quand, à la Noël, les morts comblés de cadeaux quittent les vivants pour les laisser en paix jusqu’au prochain automne. Il est révélateur que les pays latins et catholiques, jusqu’au siècle dernier, aient mis l’accent sur la Saint-Nicolas, c’est-à-dire la forme la plus mesurée de la relation, tandis que les pays anglo-saxons la dédoublent volontiers en ses deux formes extrêmes et antithétiques de Halloween, où les enfants jouent les morts pour se faire exacteurs des adultes, et de Christmas, où les adultes comblent les enfants pour exalter leur vitalité. «N'est-ce pas qu'au fond de nous veille toujours le désir de croire, aussi peu que ce soit en un bref intervalle durant lequel sont suspendues toutes craintes, toute envie et toute amertume»Mais qui peut personnifier les morts, dans une société de vivants, sinon tous ceux qui, d’une façon ou de l’autre, sont incomplètement incorporés au groupe, c’est-à-dire participent de cette altérité qui est la marque même du suprême dualisme : celui des morts et des vivants ? Ne nous étonnons donc pas de voir les étrangers, les esclaves et les enfants devenir les principaux bénéficiaires de la fête. L’infériorité de statut politique ou social, l’inégalité des âges fournissent à cet égard des critères équivalents. En fait, nous avons d’innombrables témoignages, surtout pour les mondes scandinave et slave, qui décèlent le caractère propre du réveillon d’être un repas offert aux morts, où les invités tiennent le rôle des morts, comme les enfants tiennent celui des anges, et les anges eux-mêmes, celui des morts. Il n’est donc pas surprenant que Noël et le Nouvel An (son doublet) soient des fêtes à cadeaux : la fête des morts est essentiellement la fête des autres, puisque le fait d’être autre est la première image approchée que nous puissions nous faire de la mort.
[…] On a vu que le Père Noël est l’héritier, en même temps que l’antithèse, de l’abbé de Déraison. Cette transformation est d’abord l’indice d’une amélioration de nos rapports avec la mort ; nous ne jugeons plus utile, pour être quittes avec elle, de lui permettre périodiquement la subversion de l’ordre et des lois. La relation est dominée maintenant par un esprit de bienveillance un peu dédaigneuse ; nous pouvons être généreux, prendre l’initiative, puisqu’il ne s’agit plus que de lui offrir des cadeaux, et même des jouets, c’est-à-dire des symboles. Mais cet affaiblissement de la relation entre morts et vivants ne se fait pas aux dépens du personnage qui l’incarne : on dirait au contraire qu’il ne s’en développe que mieux ; cette contradiction serait insoluble si l’on n’admettait qu’une autre attitude vis-à-vis de la mort continue de faire son chemin chez nos contemporains : faite, non peut-être de la crainte traditionnelle des esprits et des fantômes, mais de tout ce que la mort représente, par elle-même, et aussi dans la vie, d’appauvrissement, de sécheresse et de privation. Interrogeons-nous sur le soin tendre que nous prenons du Père Noël ; sur les précautions et les sacrifices que nous consentons pour maintenir son prestige intact auprès des enfants. N’est-ce pas qu’au fond de nous veille toujours le désir de croire, aussi peu que ce soit, en une générosité sans contrôle, une gentillesse sans arrière-pensée ; en un bref intervalle durant lequel sont suspendues toute crainte, toute envie et toute amertume ? Sans doute ne pouvons-nous partager pleinement l’illusion ; mais ce qui justifie nos efforts, c’est qu’entretenue chez d’autres, elle nous procure au moins l’occasion de nous réchauffer à la flamme allumée dans ces jeunes âmes. La croyance où nous gardons nos enfants que leurs jouets viennent de l’au-delà apporte un alibi au secret mouvement qui nous incite, en fait, à les offrir à l’au-delà sous prétexte de les donner aux enfants. Par ce moyen, les cadeaux de Noël restent un sacrifice véritable à la douceur de vivre, laquelle consiste d’abord à ne pas mourir. Avec beaucoup de profondeur, Salomon Reinach a écrit une fois que la grande différence entre religions antiques et religions modernes tient à ce que « les païens priaient les morts, tandis que les chrétiens prient pour les morts » 3. Sans doute y a-t-il loin de la prière aux morts à cette prière toute mêlée de conjurations que, chaque année et de plus en plus, nous adressons aux petits enfants – incarnation traditionnelle des morts – pour qu’ils consentent, en croyant au Père Noël, à nous aider à croire en la vie. Nous avons pourtant débrouillé les fils qui témoignent de la continuité entre ces deux expressions d’une identique réalité. Mais l’Église n’a certainement pas tort quand elle dénonce, dans la croyance au Père Noël, le bastion le plus solide, et l’un des foyers les plus actifs du paganisme chez l’homme moderne. Reste à savoir si l’homme moderne ne peut pas défendre lui aussi ses droits d’être païen. [...] 1. Cité par Brand J., Observations on Popular Antiquities (nouvelle édition), Londres, 1900. [Lève-toi, ma bonne épouse, et ne traîne pas / Pour donner ton pain tant que tu es là / Viendra le temps où tu mourras / et ne voudras ni farine ni pain.] 2. Voir sur ce point Varagnac A., Civilisation traditionnelle et genre de vie, Paris, 1948, pp. 92, 122, et passim. 3. Salomon Reinach (1858-1932), archéologue et historien des religions, « L’origine des prières des morts », dans Cultes, mythes et religions, Paris, 1905, tome 1, p. 319. Nous remercions Claude Lanzmann et la revue Les Temps modernes, dans laquelle le texte « Le Père Noël supplicié » est paru initialement et intégralement (n° 77, 1952) avant d’être réédité en tirage limité aux éditions Sables en 1996 et dans la revue Incidence (n° 2, 2006). Chaque journée débute par un café, un lavage de dents et un #wakeuplikethis. C’est le premier post Instagram que tu publies/voies. En quelque sorte, c’est comme si tous les matins tu te réveillais avec une personne différente. Fort heureusement, c’est une teenager australienne maquillée nude qui se permet de te faire partager ce moment d’intimité. Difficile de ne pas se demander si cette intimité ne relève pas de l’impudeur ?
En premier lieu, dédouanons nous des traditionnelles jugements plus ou moins méprisants envers ces personnes qui partagent intensivement leurs vies sur les réseaux sociaux. Je souhaite vraiment m’émanciper de ces discours pour plusieurs raisons : 1) Mes parents m’ont toujours dit : « on ne tire pas sur une ambulance ». 2) C’est un métier aujourd’hui, et « il n’y pas de sot métier ». 3) Nous ferions tous la même chose si nous étions riches, beaux et nés en 1999. Spontanément, en faisant défiler le fil Instagram, l’occurrence de paires de fesses, de bouts de tétons et de couples goals amène l’idée d’une exhibition généralisée et débridée par le virtuel. Instagram est devenu le nouvel espace permettant d’évoluer grimé par des filtres et de hashtags plus ou moins « catchy ». A ce moment, une question, instinctive certes, mais tout de même légitime émerge « IL/ELLE N’A PAS HONTE ? ». En fait, non, il n’y aucune honte à avoir. Je m’explique, la honte est un sentiment qui nous accable brutalement. Evidemment, nous ressentons la honte dans un second temps, suite à un élément révélateur, comme le dévoilement d’un échec ou d’une faute. Ici, il est cette corrélation paradoxalement positive entre le caractère « honteux » de la photo et le nombre de « likes ». Dès lors, le sentiment de honte est annihilé par le soutien sans faille des « followers ». Si il n’y a pas de honte, la question de l’impudeur reste légitime. Back to the roots, l’impudeur se définit comme une attitude qui offense la pudeur. Fondamentalement, la pudeur peut se comprendre comme ce sentiment de gêne à l’égard de ce qui peut entamer l’estime de soi et qui interdit le regard d’autrui sur sa vie intime. Si l’estime de soi semble soutenue par une communauté avide d’images subjectives, il va sans dire que le fait même d’offrir sa vie intime publiquement reste questionnable. J’ai trouvé une réponse à cette interrogation dans Le Portrait de Dorian Grey, Oscar Wilde écrit : « un nouvel hédonisme (…) vous pourriez être le symbole visible. Avec votre personnalité, il n’y a rien que vous ne puissiez faire. ». Je pense que chaque image, parce qu’elle a été choisie, porte sa charge symbolique. Le nouvel hédonisme surfe sur l’image. La contemplation du moi atomisé en milliers de bout d’images, de likes et de hashatgs. Chaque îlot apporte des indices sur la nouvelle personne que je façonne. Instagram n’est que la partie émergée de l’Iceberg, la partie que l’on veut bien montrer. Aujourd’hui, ma page instagram ce n’est plus moi mais « me, I and myself ». Cependant, l’expression du moi prend des formes particulières que personnellement je n’explique pas : créer une page instagram « fan » parce qu’on adore Jenifer ou tenter d’humaniser son animal de compagnie parce qu’il est trop mignon. Finalement, chacun dévoile la partie de soi qu’il estime légitime de rendre public. Dès lors, libérée de toutes les contraintes de la présence physique ou morale, cette représentation via Instagram ne veut pas fidèle de la réalité. Nous ne nous dévoilons pas, nous nous mettons en scène. Instagram est donc un théâtre au sein duquel la honte et la pudeur n’ont pas leur place. @mrgx_baer Aujourd’hui, au cours de notre repas, j’ai entendu mon frère qui affirmait avec conviction que « la presse française critique tellement Trump que les gens vont avoir peur et ne vont plus voter Marine Le Pen ». Si seulement il avait raison mon petit frère. Mais je crois qu’il est bien naïf. Comme beaucoup de Français d’ailleurs. Comme toute la presse française. Comme de nombreux hommes et femmes politiques.
Trump est dénigré par les médias français, Trump est critiqué par toutes les personnes qui vous parlent de politique, Trump est critiqué dans les écoles et dans les universités, Trump est critiqué à la télé et à la radio. Il n’en reste pas moins que Trump a été élu. Par plus de la moitié du peuple américain. Donc réveillez-vous : Trump a été élu par la majorité silencieuse, celle-là même qui élira son alter ego français : Marine Le Pen. La majorité que l’on entend critiquer Trump à tout bout de champ n’est absolument pas la majorité. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est une minorité. Mais la véritable majorité, qui se cache derrière son silence, c’est celle qui secrètement désirait qu’un tel événement se produise, c’est celle qui défend Marine Le Pen lors des déjeuners de famille, c’est celle qui trouve des excuses aux propos racistes, sexistes et homophobes, mais sans jamais le crier haut et fort. Ne vous trompez pas, cette majorité-là n’est pas dupe et n’est pas dupée par les médias. Bien au contraire, cette majorité-là est persuadée de détenir la vérité : les médias seraient un carcan qui empêchent de penser autrement. En toute honnêteté, j’ai longtemps pensé que l’on pouvait agir pour démontrer rationnellement et en toute intelligibilité l’incohérence de certains propos scandaleux. Mais il ne s’agit plus de démontrer la haine et la bêtise par le bon sens. La raison et la logique ne sont pour l’instant plus des outils propices à la paix et au vivre ensemble en démocratie. L’ont-elles été un jour ? (Grande question historique qui ne sera pas traitée ici). Aujourd’hui, démocratie et communication en continue obligent, les longs discours qui cherchent à convaincre ne sont plus d’actualité. Face à une France qui a traversé une crise économique importante et qui s’embourbe dans une crise identitaire profonde, seuls les discours intenses qui cherchent à persuader et non à convaincre sont pertinents. Je ne fais pas l’apologie du populisme. Mais je pense qu’un peu de renouveau dans la manière d’exercer la politique ne pourra qu’être propice à la démocratie. Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle ? Pour ma part, cette question ne se pose plus. C’est une évidence. Marine Le Pen élue ? Ce n’est pas impossible, loin de là. Ce que ne comprennent pas nos hommes et femmes politiques actuels, c’est l’attente des Français envers eux. Qu’attendent-ils d’eux ? Qu’ils dégagent. Ce terme est violent ? Mais les Français désirent de la violence, ils n’aspirent pas à la paix sociale car ils savent qu’ils n’y auront pas accès avant qu’un certain nombre de problèmes ne soient réglés. Que proposent Trump et Marine Le Pen ? Qu’ont-ils en commun avec le phénomène du Brexit ? Ou même avec le parti d’extrême gauche espagnol Podemos ? Ils proposent une nouvelle vision : une rupture avec le modèle présent. Et voilà le mot clef : une vision. Ils proposent une vision du monde qui ne plait pas à tout le monde mais qui séduit parce qu’elle est globale, large et pleine de promesses (voyez comme tous les discours d’Hillary critiquent Trump au lieu de proposer un avenir et des réformes). A cela s’ajoute une énergie que ces nouveaux mouvements dégagent en proposant un avenir lointain avec un monde meilleur. Les Français ne sont pas stupides. Ceux qui votent pour Marine Le Pen savent pertinemment que tous les problèmes ne seront pas résolus grâce à elle. Mais ils envisagent simplement un changement, une rupture par rapport à ce qu’ils connaissent : ils aiment les « grandes idées », non pas qu’elles soient belles ou intelligentes mais remplies de promesses et de perspectives futures de long terme. Ils aiment les visions globales où tout est d’une simplicité logique. Peut-on réellement leur reprocher de rêver de désirer autre chose que le modèle existant ? De vouloir bouger les choses plutôt que de rester embourbés dans un modèle… non plutôt dans une absence de modèle. Il n’y a ni modèle, ni guide, ni vision. Marine Le Pen propose un modèle, une vision et en est le guide. Je ne vois qu’une absence de guide, de vision et de modèle dans tous les autres partis. Je ne suis pas la seule à le penser (Attali l’a écrit à de multiples reprises). Encore une fois, réveillez-vous : Hollande est détesté, Sarkozy aussi. Si c’est eux qui affrontent Marine Le Pen, soyez certain(e)s d’une chose : c’est elle qui va l’emporter. Diane B. La France Est-Elle Irréformable? Partie III: Pour Une Redéfinition Du Paysage Politique Français.10/12/2016 Le regard d’un expatrié: À travers une série de trois articles, notre chroniqueur basé à New-York nous offre une analyse pleine de recul et de bon sens: La France est le plus révolutionnaire des pays conservateurs. C'est un frondeur paralytique. Nos archives regorgent d'analyses perspicaces de nos défaillances, de propositions ingénieuses destinées à y remédier. Les analyses ont presque toutes été applaudies ; les propositions n'ont presque jamais été appliquées. Jean-François Revel, Le Voleur dans la maison vide, 1999 Penchons-nous sur ces Français qui protestent. Qui sont les militants de la Nuit Debout ? Qui sont les manifestants anti-loi travail ? Jeunesse désorientée Ces mouvements drainent une part non-négligeable de jeunes, désillusionnés par ce monde politique figé, décontenancés par les sombres perspectives du monde du travail français. Difficile de faire le procès de lycéens rêveurs dont la bonne conscience se laisse entrainer par l’air lancinant du « c’est la politique du gouvernement, un pas en avant, deux pas en arrière » - plaidoyer contre l’absurde du monde adulte, appel du cœur pour la lucidité, bonne occasion de ne pas aller en cours. Bien entendu, cette jeunesse ne se résume pas à cette masse coupée de la réalité et entrainée aveuglement dans le sillage des grévistes. Un part non-négligeable des jeunes en colère est bien informée, et consciente des enjeux de la Loi El Khomri. Mais une autre partie est en manque de repères… Comment ne pas le comprendre ? N’est-ce pas le fait de tout citoyen au XXIe siècle ? Dieu est mort, l’Etat s’affaiblit, le capitalisme a mauvaise presse : le monde ne semble plus porteur de convictions. Certains croient aveuglement a la science, d’autres, en France, s’attendent à ce que l’Etat soit à l’origine des valeurs (ce qui explique notamment les regains de popularité post-attentats du 13 novembre : l’Etat a l’occasion de conduire les français par la main, et de se porter garant de valeurs fortes et bienveillantes : solidarité, fraternité, liberté). Que faut-il croire aujourd’hui ? Difficile de répondre. Notre « système » mondial peut prendre les apparences d’un monstre ineffable, qui en déboussole plus d’un : certains se réfugient dans l’ultranationaliste bleu marine, d’autres cherchent leur voie dans l’islam radical… Fin du dérapage Face au monstre politique informe, une revendication naturelle est de réclamer plus de proximité avec les élus, de couper la distance avec les élites. Même si c’est une des conséquences inévitables de la démocratie représentative, la question de la gouvernance d’une société civile connectée, renforcée par le numérique et son flux d’info continus, mérite d’être posée. Et c’est ainsi, à mon sens, que le futur de la démocratie ne se dessine pas tant à la nuit debout, mais au gré des avancées de la Civic Tech. Les applications politiques des nouvelles technologies – agora numérique, sondages sur iPhone, apps permettant de classer les programmes électoraux, partis numériques (où le représentant s’engage à agir en fonction des internautes du parti) - peuvent potentiellement tracer les contours d’une démocratie améliorée, voire augmentée (vision optimiste) tout comme risquer de laisser le pouvoir aux minorités numériques les plus actives, au péril de la qualité des débats, des arguments échangés, et de la capacité de notre démocratie à dégager des positions communes (vision pessimiste). Sujet passionnant[i]. Revenons Place de la République. On comprend les aspirations de ses occupants. Mais une question me taraude. En 2011, l’action politique par l’occupation s’est globalisée et a pris forme dans de nombreuses villes : Tunis, Le Caire, Québec, Ouagadougou, New York (Occupy Wall Street), Madrid (Los indignados), Londres, Rio, Genève, mais aussi Turquie, Yémen, Russie et Chine. En France, on achète le petit livre de Stéphane Hessel, mais le mouvement des Indignes est un échec. Pourquoi les français n'ont-t-ils pas emboîté le pas aux autres pays en 2011 ? Les indignés à la française Pour le sociologue Albert Ogien, directeur de l'Institut Marcel Mauss à l'EHESS le mouvement n’a pas pris à l'époque « pour les mêmes raisons qui font que la Nuit debout risque d'échouer cette fois-ci encore, quel que soit le bien qu'on puisse penser du mouvement. Ce type d'action politique qui se fait par des citoyens contre les partis et contre les syndicats est une chose que ne savent pas faire les Français. Pour une raison simple : les Français refusent de faire comme Iglesias en Espagne, et de renoncer à la distinction entre droite et gauche. (…) Tout le paradoxe est d'observer les tentatives de reprise du mouvement par des organisations politiques instituées d'un modèle qui est justement fait contre les organisations. (…) Or se mettre sur une place et discuter n'a de sens que si ce vieux moule est cassé. En 2011, il était frappant de voir le NPA très mécontent, par exemple, devant les tentatives de mobilisation des Indignés : un mouvement qui n'a pas de stratégie, pas de programme, pas de leader apparaît vide de contenu politique en France, alors même qu'il est politique. (…) » Et même aujourd’hui, Nuit debout diffère de ce qu’on a pu voir à l’étranger : « aux Etats-Unis en 2011, on n'entendait pas les activistes adressé de défiance au gouvernement. Leur malaise s'exprimait contre une chose : le poids gigantesque de la finance et en particulier ce slogan "99% contre 1%". (…) A Paris, lors de la première manifestation du 9 mars contre la loi Travail qui s'était pourtant présentée comme une réaction citoyenne portée par une pétition sans précédent, vous trouviez les mêmes banderoles, et la même présence habituelle des syndicats CGT, Fidl, UNEF... Ces syndicats font leur travail et s'inventent une seconde vie... et pourquoi pas ! Mais ne regardons pas cette mobilisation contre la loi El Khomri comme une simple réaction citoyenne spontanée. (…) En France, on laisse sans doute mourir les vieilles structures que sont les partis et les syndicats qui ne suscitent plus l'adhésion... mais on n'est pas prêt à abandonner complètement les vieux cadres mentaux complètement vermoulus. »[ii] [i] http://www.lenouveleconomiste.fr/civic-tech-30837/ [ii] http://www.franceculture.fr/politique/nuit-debout-un-nouvel-occupy-wall-street CGT, qui es-tu ? A la question posée ci-dessus : « Qui sont les militants de la Nuit Debout ? Qui sont les manifestants anti-loi travail ? » La réponse est donc : quelques jeunes, mais surtout la vielle garde syndicaliste française, avec, en fer de lance, la CGT de Philippe Martinez. Rappelons certains chiffres[i] sur cette CGT qui aime tant faire parler d’elle : elle représente 11% de salariés syndiqués en France, soit 2,6% des salariés français, avec un âge moyen de 49 ans (les 26-30 ans représentent 4%), 42% de fonctionnaires (soit 2x plus que la part de la pop. active appartenant au secteur public), 67% d’ouvriers (vs 28% dans la pop. active), 38% de femmes (10 points au-dessous de la pop. active). Bref, on peut difficilement dire que la CGT est représentative de notre pays, et légitimer sa prise d’otage de nos infrastructures. Certes, ses manœuvres ont encore les faveurs d’une partie de l’opinion publique. Mais les actions de la CGT vont au-delà du rôle des syndicats, et s’apparente bien plus à un coup politique, dont l’objectif direct être de faire chuter Manuel Valls (on note au passage le peu de réactions des figures de droites, quand bien même il serait risqué pour les Républicains de voir CGT s’impose dans la rue, tant sa victoire établirai un précèdent indélébile). Monsieur Martinez, la démocratie – malgré tous ses défauts[ii] – se fait dans l’hémicycle, pas dans la rue. Si certains syndicats tels que la CFDT on joué le jeu de la négociation, la CGT a choisi de nuire au quotidien des plus démunis en organisant manifestations, blocages et grèves. Elle banalise la haine anti-flic et tolère les casseurs – on en oublierait presque que nous sommes en Etat d’urgence. Le summum aura été atteint lors du blocage des journaux qui ont refuses de publier la tribune de Martinez – cf ce passage honteux dans le petit Journal[iii] – ignoble chantage et atteinte stalinienne (oui, stalinienne) à la liberté d’expression. Certains rétorqueront que le vrai tyran est Manuel Valls, armé de son 49-3. On leur rappellera que le 49-3 est un outil démocratique que tous les gouvernements ont le droit d’utiliser faute de compromis législatif, au risque de se faire destituer par une motion de censure. Motion de censure que la gauche de la gauche n’a pas réussi à faire passer. C’est le jeu de la démocratie. Martinez et ses amis d’extrême gauche ont perdu, ils noient donc leur frustration politique et leur soif de pouvoir en protestant dans la rue. Seul point positif : on peut voir ces épisodes comme un suicide politique de l’extrême gauche syndiquée, tant l’opinion publique est excédée. Rappelons l’épisode des grèves des mineurs britanniques ayant abouti à l’élection de Thatcher, ou des législatives post-mai 68… 2017 nous dira si l’histoire se reproduit. Binarisme et montée des extrêmes La gauche de la gauche a le droit d’exister. Au-delà de ses manœuvres syndicales inappropriées, elle a une légitimité politique réelle et un poids électoral non-négligeable. Mais ce qui est à déplorer, c’est que notre gouvernement, qu’on le croyait voir prendre la bonne direction, soit frêné par la vieille garde des frondeurs du PS. Là encore, les frondeurs ont le droit d’exister. Ils se sont unis derrière Hollande en 2012 pour prendre le dessus sur la droite au pouvoir. Or ils ne sont plus la même longueur d’onde que le Président, et sont donc mécontents. C’est leur droit. A mes yeux, c’est surtout la preuve que les frontières politiques de nos partis politiques sont mal tracées. Car si la naissance des frondeurs a marqué une fracture politique interne au PS, il existe aussi des divergences majeures au sein des Républicains. Au fond, Valls et Macron ne sont-ils pas plus proche de Fillon et Juppé que d’Aubry et Hamon ? Le prisme droite-gauche déforme notre vision de la politique et met à dos des personnalités politiques pourtant proches. La France ne gagnerait-elle pas à voir émerger pour un Centre fort (du moins plus fort que la posture bégayante – with all due respect - de François Bayrou) ? A l’échelle européenne, on constate l’épuisement d’un modèle démocratique fondé sur l’alternance droite-gauche depuis les années 1970, qui se traduit par l’ascension fulgurante des politiciens antisystèmes, à droite de la droite, ou à gauche de la gauche. Tirons également des leçons de la montée de Sanders, et bien évidemment du succès de Trump aux Etats-Unis. Ce serait à mes yeux une grande erreur de faire du phénomène Trump un épisode uniquement américain. D’une part, personne ne l’avait vraiment venu venir outre-Atlantique (cf le mea culpa de tous les éditorialistes américains qui n’y avaient pas cru), d’autre part Trump est la personnification des dérives potentielles de nos démocraties contemporaines : assis sur sa légitimité de businessman succesful[iv] (peut-être la seule vraie différence avec la France, où un milliardaire est rarement en odeur de sainteté auprès du grand public), Trump a compris qu’une campagne en 2016 se gagnait a coup de buzz et de punchlines démagogiques. Pourvu que personne ne s’y essaye aussi gravement en France. [i] http://timetosignoff.fr/2016-05-24 [ii] http://us11.campaign-archive1.com/?u=d6ee788dc820b29b53815d1e5&id=9731f371bf [iii] http://mayotte.orange.fr/video/221/le-reporter-du-petit-journal.html [iv] Succès a relativiser. Si trump avait investi tout son héritage dans des bons du Trésor américains, il serait bien plus riche qu’aujourd’hui En Marche ?
Il serait dommage que le binarisme droite-gauche galvaude notre potentiel réformateur au profit des extrêmes (gauche ou droite). Dommage, car le tableau de la France n’est pas totalement noir – notre économie reste performante dans les domaines du tourisme, de l’industrie lourde (Aéronautique, Défense, Energie, Construction), du luxe ou de la santé - et que notre pays a un immense potentiel. Les succès de la French Tech en sont le plus bel exemple, les déclarations du patron de Cisco (« La France, un moment charnière de son histoire, au bord d’une profonde transformation (…) La France, c’est l’avenir ») un des plus beau motifs d’espoir. Il est donc nécessaire de rebattre les cartes du jeu politique français. D’unir ceux qui, au sein du PS ou des Républicains, sont enchainés par leurs extrêmes. Aujourd’hui, la France peut céder à la terreur et prendre la voie du nationalisme sécuritaire – c’est l’option Front National[i]. La France peut s’immobiliser davantage et s’enfoncer dans ses illusions socialistes archaïques – c’est l’option Front de Gauche. Enfin la France peut se reformer, tirer profit de son potentiel à l’aube de la quatrième révolution industrielle – cette option n’a pas de nom. La panacée s’appelle-t-elle Emmanuel Macron ? Attendons de voir. Aujourd’hui on oublierait presque qu’il a été ministre de notre économie, tant ses ambitions présidentielles ont pris le dessus. Mais la France a besoin d’hommes politiques qui, comme Macron, cherchent à casser les lignes – quand bien même cela aurait été fait par pur intérêt personnel. La France a besoin d’hommes politiques modérément libéraux – c’est-à-dire sociaux-démocrates ? - qui cherchent à casser les blocages français sans remettre en cause tous les bienfaits de notre Etat Providence ; qui sont prêt à faire un pas en arrière, si c’est pour en faire deux avant. Nous l’avons évoqué plus haut, la France est tout et son contraire, France n’aime pas le compromis. Prenons en conscience, et mettons notre cœur à l’ouvrage pour chercher une voie appropriée. Rappelons que nos économies et nos sociétés sont l’objet de mutations permanentes : il n’y a pas de réponse figée. Mais risquons des reformes pour chercher un juste milieu - au sens aristotélicien du terme : non pas le milieu géométrique d’un segment plat, mais le sommet en qualité d’un triangle constructif. Le juste milieu économique En guise d’illustration de notre haine du compromis, prenons l’exemple du tissu économique français. J’évoquais plus haut l’exemple de start-ups de la FrenchTech : pour elles le plus dur n’est pas tant de naître en France, mais d’y lever des fonds et de se stabiliser à une hauteur moyenne. Ceci s’explique notamment par la structure des investissements français, assurés a 15% par des fonds de capital risque (qui, en intégrant le capital d’une start-up, prennent le risque de chuter avec elle), et à 85% par des acteurs bancaires (qui agissent de manière peu risquée : ils prêtent à taux, la start-up s’endette avec un taux d’intérêt et devra rembourser ses créditeurs en priorité si elle fait faillite). Chez les anglo-saxons, c’est l’inverse. Aux Etats-Unis, les start-ups sont financées à 80% par des fonds, et à 20% par des banques. Certes, cela est dû en grande partie à l’importance des fonds de pensions, qui financent les retraites etc. Mais cela traduit en France une aversion de la bourse et du risque. Pourquoi ? La faillite, au XVIIIe siècle, alors que le capitalisme n’en est qu’à ses balbutiements, de la compagnie du Mississipi - compagnie coloniale française a l’origine d’une bulle spéculative dont l’éclatement ruinera tous ses petits actionnaires - a peut-être laissé une empreinte durable dans nos mentalités[ii]. On notera, en guise de premier palliatif, qu’un amendement de la loi Macron vise à faciliter la renaissance des bourses régionales, qui répondrait à un besoin de plus en plus sensible de fonds propres des PME et des ETI, qui n’ont quasiment pas accès aux marchés de capitaux (inspiré du modèle des Mittelstand allemandes ?) Mais cet exemple du financement à la française est l’exemple même de ce juste milieu qui nous échappe : effrayés par la volatilité des structures capitalistes anglo-saxonnes, nous avons mis en place des structures de financement opposées, timides et peu risquées, et qui ne permettent pas à nos jeunes entreprises de grossir et de prospérer sur la scène internationale – exemple Dailymotion. Dans un même registre d’idée, je rejoins le constat de Guillaume Sarlat, pour qui le problème de la France n’est pas tant l’opposition publique/privée (en effet les fonctionnaires ne représentent que 20% de la pop employée, cad moins que la médiane européenne[iii] ; certains, dans les collectivités territoriales surtout, ont des CDI 35h et un excès RTT surprotèges, mais c’est loin d’être le cas dans les secteurs de la santé ou de la sécurité par exemple), mais bien l’opposition petite entreprises/grosses institutions. Il n’y a pas en France de culture de l’entreprise moyenne : on est soit tout petit, soit avalé dans les méandres administratifs de nos colosses publics ou de nos grands fleurons nationaux. Il ne s’agissait que d’une illustration économique, mais prenons conscience de cette absence de juste milieu en France. Retrouvons notre gout du risque en économie, et traduisons-la dans notre monde politique. Ceci n’est pas un manifeste ultra-libéral, partisan d’une dérèglementation tous azimuts. Dans la position actuelle de la France, ceci est un modeste appel à la prise de conscience de nos retards, à l’inflexion de notre destinée. Osons réformer. Restons modeste sur le poids de la France au XXIe siècle, admettons nos erreurs, osons changer. Prenons l’exemple de ceux innovent, brisent les lignes. Risquons-nous à un avenir meilleur, quitte à nous casser la gueule. Un spectateur engagé [i] Point de vue intéressant du philosophe Marc Crépon dans Society Magazine : au cours de ces 10 dernières années, le Front National a constitué le seul pole influence stable de notre horizon politique – influence qui détourne en permanence l’opinion sur des débats nationalistes, modifiant les préoccupations politiques des française, et conduisant à la droitisation de tous les politiciens (n’est-ce pas Manuel Valls ?) [ii] Rappelons que c’est afin de répartir les risques liés aux financements des navires des grands explorateurs (dont une proportion non-négligeable échouait) que sont nées les compagnies d’assurance. Par extension, les incertitudes propres aux compagnies coloniales, dont l’économie reposait sur les denrées récoltées, ont conduit à la naissance des bourses en Europe (Royaume-Uni, France, Pays-Bas). La compagnie du Mississippi est une des premières actions cotées à la Bourse de Paris, qui n'était encore qu'un rassemblement de négociants rue Quincampoix au XVIIIe siècle. Par le biais d'une publicité exagérée et afin de susciter l'intérêt des acheteurs, John Law (qui contrôlait la compagnie) surévalua la richesse effective de la Louisiane, autrement dit les capacités de production de ce territoire colonial, encore largement inorganisé : par un procédé efficace de mise en marché, l'engouement de la demande pour les actions de la Compagnie conduisit à la formation d'une bulle spéculative en 1719, par ailleurs favorisée par l'émission excessive de papier-monnaie par la Banque générale. En raison des failles des régulations économiques et financières françaises, cette faillite a provoqué la ruine des tous les petits actionnaires de la compagnie (et non des plus gros) [iii]http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/03/17/29006-20160317ARTFIG00235-la-france-est-elle-un-pays-de-fonctionnaires.php [iv] Pour rappel Roland Garros est un aviateur français célèbre pour ses exploits sportifs en avion, dont la 1er traversée de la Méditerranée. Il est mort dans un combat aerien en 1918) Le regard d’un expatrié: À travers une série de trois articles, notre chroniqueur basé à New-York nous offre une analyse pleine de recul et de bon sens: La France est le plus révolutionnaire des pays conservateurs. C'est un frondeur paralytique. Nos archives regorgent d'analyses perspicaces de nos défaillances, de propositions ingénieuses destinées à y remédier. Les analyses ont presque toutes été applaudies ; les propositions n'ont presque jamais été appliquées. Jean-François Revel, Le Voleur dans la maison vide, 1999 Par où commencer ? Quand on joue avec les clichés, tous les arguments sont bons. Le Français est râleur, il n’est jamais content, c’est un expert du back-seat driving[i]. Le Français descend du Gaulois [au fond, pas vraiment, M. Sarkozy], résistant encore et toujours à l’envahisseur, cette mondialisation aux contours illuminato-americano-capitalistes (même s’il finira bien pas céder, à court de potion de magique). Car au fond, le Français est davantage résistant qu’il n’est révolutionnaire, en ce qu’il rejette plus qu’il ne cherche à construire, sans craindre de tourner à vide : il fait non avec la tête, mais oublie de dire oui avec le cœur. Ainsi, vu de l’étranger, le Français aime son petit confort, est snob, protecteur d’un trésor imaginaire, nostalgique d’un ancien monde révolu. De sorte que la France, finalement, se cantonne au sens étymologique du mot « réforme » : rétablissement dans l’ordre, dans l’ancienne forme. Y’a-t-il une part de vrai ? Peut-être. Le socle culturel de la France, qui tisse nos mentalités et notre inconscient, est une trame invisible, dont on ne pourra jamais saisir l’étendue. Et puis si nous détestons entendre des clichés sur la France venus de l’étranger, nous nous gardons le droit d’en proférer de toute part sur nous-mêmes. Car au fond s’il y a peut-être une constante chez le Français, c’est qu’il est plein de contradictions. Dès lors, comment ne pas l’être à l’échelle nationale ? Tentez, au-delà des clichés, d’apporter ne serait-ce qu’une définition englobante de la France, et vous passerez forcement à côté de ce qu’elle est – c’est-à-dire tout est son contraire. Bien sûr, cela n’est pas uniquement le propre de la France, et ce constat, Omnis determinatio est negatio, pourrait s’appliquer à toutes les nations du globe. Mais la France semble exceller dans ses incohérence, tantôt terre d’innovation, tantôt modèle de conservatisme, tantôt Gavroche, tantôt Napoléon – tantôt french flair, tantôt Ligue 1. C’est cliché, encore une fois, mais c’est l’idée que je me fais de la France, et c’est à mes yeux ce qui fait son charme. Malaise scolaire Tentons néanmoins de dépasser la tentation de l’aphorisme et de faire la généalogie de ces maux français – ou plutôt de la version française de ces maux. Plongeons-nous dès lors dans ce qui constitue un socle originaire commun à tous les français : l’école. Pourquoi évoquer l’éducation ici ? Parce que le schéma éducatif français est un formidable laboratoire de notre rapport à l’autorité d’une part, et aux élites d’autres part. A ce sujet, l’ouvrage de Peter Gumbel, Elite Academy : Enquête sur la France malade de ses grandes écoles nous offre une mise en perspective adroite de notre conception de l’éducation. Car avant de créer des élites, l’école française façonne notre conception de l’autorité. D’après Peter Gumbel, journaliste et écrivain d’origine anglaise, l’ambiance de travail des entreprises françaises, les mauvais rapports de groupes, la défiance réciproque entre les employés et leurs patrons, tout ceci découle directement de la conception de la hiérarchie que nous inculque l’école, où le professeur est roi, les cours sont magistraux – les élèves ne participent pas, souvent de peur de se tromper, car se tromper c’est la honte ; les « cancres » sont relégués (d’ailleurs la France est le pays qui a le plus fort taux de redoublement, quand de multiples études ont démontré son inefficacité). Le seul pays qui se rapproche de la structure hiérarchique à la française est le Japon, mais la France pousse les clivages encore plus loin (statistiques à l’appui). Ainsi, aux yeux d’un écolier français, le concept d’autorité n’inclut pas la notion de dialogue ; la discussion, la négociation, la recherche de compromis, ne sont pas naturelles (qu’en pensent nos arbitres de foot ?). Il s’agit de consentir ou de faire front. Pas étonnant que soit l’article 2 de la loi du travail – qui traite notamment des renégociations internes aux entreprises – soit au cœur du débat actuel. Le mal élitiste Au passage, le sujet principal du livre de Gumbel – la fabrique des élites françaises – vaut le coup d’être évoqué, même si l’on risque de s’éloigner de notre sujet initial. Car si la France se vante d’avoir un système éducatif méritocratique, où l’enseignement – de la maternelle jusqu’aux études supérieurs – peut être gratuit pour tous, elle ne peut fermer les yeux sur l’élitisme néfaste qu’elle institue. Dans un pays où l’on semble préférer l’intelligence au succès (ce que je ne condamne pas totalement), sortir d’une grande école vous offre un passeport pour la vie. Certes les Royaume-Uni présente son contingent d’élites, et se montre beaucoup plus sélective financièrement à l’entrée d’Eton puis d’Oxbridge, mais la part d’individus qui en sont issus dans les grandes entreprises ou en politique y est bien moindre, et ne cesse de décliner. Quant à l’Ivy League américaine, celle-ci concerne une part beaucoup conséquente d’élèves : 50 fois plus d’élèves que dans les grandes écoles françaises, alors que la population est uniquement x4 ; dont une part importante de MBA. Oui, notre système a certaines vertus[i], mais c’est en France que l’on constate le plus gros déterminisme à la sortie de l’école. Et ceci alimente en partie le sentiment de distance entre le « peuple » français et ses élites, intouchables[ii]. Nous nous sommes quelques peu égaré – ce n’est pas faute d’avoir prévenu - mais ces considérations pourraient se montrer à propos, tant le sentiment de distance avec l’élite au pouvoir – hommes politiques et grands patrons confondus – a conditionné l’élection de notre Président normal. François Hollande su ajuster son discours électoral : protéger les petits et clamer une volonté de changement pour mieux surfer sur le rejet d’un ultra président trop bling-bling. On en oublierait presque qu’avec sa carte de visite HEC-Sciences Po-ENA, François Hollande est un pur produit de notre machine à élites française. On oublierait presque François Hollande est issu d’un parti rongé de l’intérieur par ses orientations diverses, miné par ses clans, dont l’inertie est, en somme, incompatible avec le changement. On comprend dès lors la frustration des Français face aux manœuvres politiciennes d’un gouvernement pusillanime et non-exempté de scandales. Hollande ne s’est pas donné les moyens des convictions affiches en campagne (sont-ce vraiment des convictions ?), manquant du courage nécessaire pour « changer » notre pays. Osons continuer une autre citation de Revel : Hollande est à Mitterrand ce que Mitterrand lui-même était à de Gaulle : le théâtre sans l’héroïsme. Un virage raté
Mais après un début de quinquennat ubuesque, symbolisé à mes yeux par le sketch Arnaud Montebourg, François Hollande a su se faire une raison, pour entamer un virage pro-business nécessaire, incarné par Emmanuel Macron (qui, pour la petite histoire, n’avait rien demande à l’époque, et comptait s’éloigner de la politique). L’intention est louable, et on peut se réjouir des multiples initiatives qui ont été prises (Loi Macron, Loi travail, Loi sur le numérique), mais on tombe des nues face au manque de pédagogie dont fait preuve notre gouvernement. Finalement, s’il est une constante dans la présidence d’Hollande, c’est sa communication désastreuse [et son fiasco fiscal]. Et c’est bien dommage, tant la direction prise depuis un an semble insuffler un souffle nouveau. Certes, ce n’est pas qu’une affaire de forme : cet amateurisme pédagogique reflète une fâcheuse tendance à l’improvisation et aux bricolages au moment de pondre un projet de loi. Mais le caractère non-explicité du virage en cours fait le lit des revendications justicière de la gauche de la gauche - des frondeurs PS, de leurs proches du Front de Gauche, et, par extension, de la CGT - qui crie au scandale et cherche dénoncer la fourberie illégitime de la bande à Macron. Or si la maladresse du gouvernement explique les faveurs de l’opinion publique à la cause syndicale, les protestations du mois de mai sont – à mon goût – un signe (de plus) que les frontières des partis politiques français sont aujourd’hui obsolètes. [i] Laisser le volant mais donner ses instructions au pilotes depuis la banquette arriere [i] Et encore je vous ai epergne les rlst du classement PISA [ii] impossible de virer un X en France. Corréalaiton : + vous avez d’X dans votre CA, + l’entrperise (du CAC 40) a de mauvais rtls. Un spectateur engagé Crédit photo: Serge Hambourg
Nous avons grandi dans une impasse. Cernés d’un réseau de petites phrases anxiogènes qui s’aggloméraient comme des narcotiques dans nos cerveaux en formation. Enfants, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente: pas un jour sans qu’on entende à la radio des nouvelles de ces deux sœurs morbides, Mme Dette et Mme Crise, dont les ombres dans nos têtes enflaient sans cesse. Finiraient-elles par exploser? Non: c’est le chômage, le trou de la Sécu et son acolyte de la couche d’ozone qui s’en chargeaient. Les tours aussi, le 11 Septembre de nos 11 ans. Dans nos têtes d’enfants saturées de ces traumatismes subliminaux, l’idée de l’Apocalypse naissait au début des années 2000. Nous n'avions pas 20 ans: nous arrivions trop tard Au lycée, on nous avertit d’emblée que l’Histoire était finie. On nous expliqua que Dieu, le Roman et la Peinture étaient morts. Sur les murs de la capitale, on nous apprit que l’Amour l’était aussi. Nous n’en connaissions pas le visage que déjà, nous n’avions plus le droit d’y croire. Notre adolescence a passé comme ça, sans que jamais rien ne se passe. A l’université, nous nous découvrions «postmodernes» - dans les livres de Gilles Lipovetsky, d’Alain Finkielkraut, de Marcel Gauchet. La formule, ailleurs, revenait souvent, recouvrant indistinctement tout ce qu’il y avait de contemporain: on l’accompagnait généralement d’un sourire sarcastique, que nous imitions sans tout à fait le comprendre. On nous inculquait ce schéma ternaire «prémoderne, moderne, postmoderne», grille de lecture ou tenaille qu’on nous présentait comme neutre quand, insidieusement, celle-là avait déjà décidé pour nous qu’il n’y avait plus rien à faire. On était déjà à l’épilogue du récit mondial de l’humanité. L’hypothèse communiste? Un délire de pyromanes. Mai 1968? Une bataille de boules de neige. L’idéal du progrès ? On avait vu Hiroshima. Les utopies avaient toutes été ridiculisées, la poésie rendue barbare après Auschwitz, les rêves, n’en parlons pas. Nos ambitions se réduisaient au quart d’heure de gloire warholien, un éphémère, et puis s’en va. Avec les autres époques, nous avions le sentiment de ne plus tenir la comparaison. Français, nous étions saturés de rêves de gloire en même temps que divorcés de l’Histoire - comme affligés d’un complexe d’infériorité à son égard. Toujours, et sans que nous n’ayons décidé quoi que ce soit, nous nous situions après, une génération de retardataires qui se sentaient tout petits en face des statues de pierre. Nous n’avions pas 20 ans: nous arrivions trop tard. Alors que faire? Mourir, éventuellement. En restant vivant si possible. Devenir un spectre de soi-même avec l’ennui et l’orgueil comme seuls moteurs, prenant comme modèles des anti-héros mégalomanes : Michel Houellebecq («souvenez-vous-en : fondamentalement, vous êtes déjà mort»), Yves Adrien (l’auteur, virtuellement mort en 2001, de F. pour fantomisation) ou Frédéric Beigbeder («Je suis un homme mort. Je me réveille chaque matin avec une insoutenable envie de dormir»). A nouveau que faire ? Une autre issue: regretter. Avec Muray, Dantec et les autres, pester contre l’homo festivus. Le jour fustiger les Bisounours, puis la nuit, pudiquement, rêver aux chevaleries d’avant. A l’extrême rigueur, enfin, agir à l’extrême. Devenir une bombe, prôner la haine de l’autre, exercer la terreur; à défaut de savoir comment s’y comporter, travailler à l’extermination du monde tel qu’il est. Une nouvelle triade de la résignation: celui qui disparaît, celui qui regrette, celui qui tue. Pour les autres, il reste l’oubli: la consolation des objets, l’anesthésie par les loisirs. De toutes ces figures possibles, nous ne nous reconnaissons dans aucune. Alors, à nouveau, que faire? La réponse est simple: renaître, comme il nous plaira. Nous sommes comme les personnages de la pièce de Shakespeare fuyant désormais un modèle de société qui nous a déjà bannis. Etant tout sauf désabusés, nous n’avons plus d’autre choix que celui d’inventer une nouvelle voie. La place est déjà prise? Trop prisée? Nous irons ailleurs, explorer. Sur les ruines des Trente Glorieuses, certains d’entre-nous au-dessous du seuil de pauvreté, nous ferons très exactement ce que nous voulons. Tant pis pour le confort, tant pis pour la sécurité, et tant pis si nous ne sommes plus capables d’expliquer à nos parents ce que nous faisons de nos journées. Nous sommes soutenus par l’amour que nous nous portons. On nous l’a de toutes manières assez répété: il n’y a plus d’issue. Dont acte. Indépendants, multitâches et bricoleurs A distance d’un théâtre politique dont on ne comprend plus la langue, nous aspirons à l’émancipation, quitte à consentir à une certaine précarité. Le système D s’ouvre, comme une alternative possible au salariat. Nos petites entreprises côtoient, et à nos yeux égalent, les grandes institutions. Dans les marges et grâce à Internet, nous explorons les micro-économies souples. Les intermédiaires sont court-circuités. Nous produisons et distribuons notre propre miel. Plus rien n’est entre nous et la musique: l’énergie et la foi suffisent pour la créer, un ordinateur pour la mixer et la distribuer tout autour du monde. Nous sommes cosmopolites mais pratiquons le local: dans des sphères restreintes et de fait habitables, nous façonnons des objets qui nous ressemblent, puis nous les partageons. Dans nos potagers numériques, nous cultivons les liens, IRL comme URL, échangeant nos enthousiasmes, nos connaissances et les nuances de nos vies intérieures. Partout, nous nous réapproprions nos heures. Par la conversation, nous prenons le temps d’inventer des mots nouveaux pour désigner des choses nouvelles. Nous sommes indépendants, multitâches et bricoleurs. Conscients de notre chance comme de l’effort à fournir, nous refusons le cynisme et la plainte. S’il faut manger des pâtes, nous les mangeons sans rechigner. S’il faut sacrifier les vacances, nous l’acceptons. Nous échangeons nos vêtements, nos logements, nos idées. Sans faire de bruit, une révolution discrète, locale et qui ne cherche à convaincre personne a déjà eu lieu. Nous acceptons désormais d’être sans statut, retirés dans les marges joyeuses, par nécessité comme par choix. L’avenir est pour nous dans les friches. C’est dans les terrains encore vagues qu’adviendra une nouvelle renaissance. Nous ne réclamons ni n’attendons plus rien de la société telle qu’elle va: nous faisons. Par-dessus tout, et fragilement. Parvenu à un certain degré, le désespoir devient une panacée. Puisque tout est fini, alors tout est permis. Nous sommes après la mort, et une certaine folie s’empare de nous. Pareils à des ballons déjà partis trop haut, nous ne pouvons plus redescendre: dans un ciel sans repères, nous cherchons les nouvelles couleurs. Le monde est une pâte à modeler, pas cette masse inerte et triste pour laquelle il passe. Des futurs multicolores nous attendent. N’ayez pas peur, il n’y a plus rien à perdre. Par le collectif Catastrophe Article originellement publié dans Libération: http://www.liberation.fr/debats/2016/09/22/puisque-tout-est-fini-alors-tout-est-permis_1506625 "Et sinon, pourquoi ne voulez-vous pas travailler dans le luxe ?" Je ne sais pas, mais c’est une bonne question. Peut-être, parce que sur mon CV ne figure aucune expérience dans le luxe. Peut-être que cela a à voir avec le fait que j’ai intégré la meilleure école de commerce de France, et pas la meilleure école de mode. Ou encore, peut-être bien que c’est parce qu’on est en plein entretien pour un stage en finance, que sur mon CV ne figurent que des expériences en finance et que je n’ai jamais parlé de luxe. Pas à un seul moment de l’entretien qui dure depuis maintenant une heure. Que le seul lien entre moi et le luxe est qu’en bas de mon CV est inscrit que je faisais partie de l’association de mode à HEC, comme trois autres activités extracurriculaires qui elles n’intéressent mon interviewer. Et que cet élément n’est pas là pour mettre en valeur que j’aime lire Vogue à mes heures perdues, mais que j’ai levé des fonds et trouvé des sponsors pour organiser un événement, aptitude qui peut faire sa différence quant à ma candidature. Si tenté soit-il que l’on ne fasse pas de raccourci stupide. Je ne suis pas féministe, mais je commence à être agacée. Je me sens obligée de m’en expliquer parce qu’il est de plus en plus difficile de parler des problèmes liés au genre, surtout quand on est une femme, et ce parce que le raccourci entre femme et féministe est rapide. Et alors, me direz-vous ? Ces dernières années le féminisme a pris une connotation péjorative – comme si défendre la cause des femmes faisait de celles qui le font des personnes virulentes dans le meilleur des cas et hystériques ou folles dans le pire. Je n’ai rien contre les féministes, mais je n’ai pas la prétention d’en être une. Je ne suis pas féministe. J’aime la différence fondamentale que l’on fait entre les hommes et les femmes. J’aime la galanterie, j’aime qu’on me tienne la porte, j’aime l’idée selon laquelle un garçon doit traiter une femme avec respect, justement parce que c’est une femme. Je ne suis pas féministe. Mais je suis convaincue que je me suis toujours battue autant, voire plus, que mes amis garçons pour arriver là où j’en suis aujourd’hui. Je ne suis pas féministe. Pas du tout féministe. Mais je suis exaspérée à un point inimaginable par les comportements qui me réduisent à mon genre. Cette question m’est posée à un entretien sur deux. Je garde le sourire, et j’explique que ce n’est tout simplement pas ce que je veux faire. Que ce n’est pas ce pour quoi je postule. Qu’un centre d’intérêt peut être un hobbie sans être la ligne directrice d’une carrière. Mais à chaque fois, je ne peux m’empêcher de me dire, dans ma tête, « et si c’était un garçon à ma place, et qu’il avait mentionné faire partie du club de foot à HEC, lui demanderiez-vous pourquoi il ne veut pas devenir footballer ? ». Poursuivons l’entretien. Arrive enfin le moment tant attendu des questions techniques. Je les connais toutes, j’y réponds. L’interviewer a l’air content, il enchaine sur un cas pratique. Donc tu prends par exemple une entreprise qui fait… Moment d’hésitation de sa part : pourquoi pas des composants chimiques, comme la dernière entreprise dans laquelle l’entreprise pour laquelle je postule a investi ? du maquillage … Et disons qu’elle commande à son fournisseur, je ne sais pas, de la poudre… La question prend par la suite la tournure d’une question de finance, et j’y réponds. Néanmoins je ne peux m’empêcher de relever, parce que je trouve ça triste qu’en 2016, on pense systématiquement luxe et maquillage lorsque l’on s’adresse à une candidate et non à un candidat. Je trouve ça dommage qu’à mon stage précédent, dans une banque de renommée internationale, sur un étage de 50 personnes, seules deux aient été des femmes. Et qu’il y soit donc normal, de faire des blagues – d’un gout discutable – sur les femmes sans se gêner. Ou qu’on m’envoie des mails avec une pièce jointe et un : « Tu m’imprimes ça ma jolie ? » Je trouve ça dommage pour la société, que lors de mes 15 derniers entretiens en fonds d’investissements, je n’ai rencontré qu’une seule femme, en dehors des assistantes. Et qu’un interviewer ait pourtant osé me dire que « être une femme peut être un avantage dans ce métier ». Alors qu’historiquement, ils n’en ont jamais engagé aucune dans le fond pour lequel il travaille. Une inégalité qui a souvent été une norme L’inégalité homme-femme, vaste sujet, mais surtout vieux sujet. L’origine de cette inégalité est ancrée dans notre culture et elle est à la fois historique, religieuse et culturelle. En effet, les cultures judéo-chrétiennes, la bible, la Grèce ancienne, et les civilisations arabo-musulmanes ont une vision différente et inégalitaire en ce qui concerne l’homme et la femme. Pour exemple, la Grèce antique voit de fait la femme comme en charge de l’intérieur de la maison (donc principalement des enfants et des travaux ménagers) tandis que l’homme lui, sort et va faire de la politique, la guerre, etc. Il est, lui, en charge de l’extérieur. Dans la bible, la femme est là encore dépeinte comme née de la côte de l’homme, en second : Dieu créa d’abord l’homme, puis la femme. Et elle devient très vite, avec la chute, source des malheurs des hommes. Cette culture de l’inégalité des genres a trouvé un parallèle dans la culture juridique où les textes codifient la dépendance de la femme à l’homme. Pour ne citer qu’un exemple, le Code Napoléon de 1804 définit clairement la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124: “Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.”. La France est le pays des droits de l’homme dès 1789, mais ne deviendra que bien plus tard un pays des droits de la femme et on constate que la transition vers les systèmes démocratiques n’a jamais donné lieu à un droit de vote mixte de prime abord. Aucun pays n’accordera en même temps aux hommes et aux femmes le droit de voter. Des incompréhensions : Once you are in, it does not necessarily get better. Les sociétés occidentales se battent certes pour une égalité homme-femme complète et multiplient les lois pour aller dans ce sens. Même si c’est positif, c’est triste en un sens qu’on en arrive à parler de quotas. Je m’adresse à nos lecteurs masculins, auriez-vous envie d’être un quota ? Si je conçois que soulever le problème et en parler nécessite de la part des hommes un effort de transposition, je trouve que cet effort n’est pas assez effectué ; qu’il est plus facile quelques fois pour les uns de s’identifier à des gens à l’autre bout du monde, vivant dans des sociétés complètement différentes, avec des problèmes auxquels ils ne seraient jamais confrontés, qu’à leurs homologues féminins. Quel meilleur exemple que l’art et les médias ? Prenons n’importe quel(le) livre, film, série : que le personnage éponyme, que l’interprète ou que l’héroïne soit une femme, d’emblée – et qu’importe le contexte – cela devient un livre, un film ou une série de filles. La réciproque n’est pas pour autant vraie. Ce phénomène est assez parlant et montre qu’il est difficile pour un homme de s’identifier à une femme en général. Ce qui mène à une moindre reconnaissance des talents féminins, en témoigne le scandale d’Angoulême de l’an passé. De cela découle un sentiment d’incompréhension lorsque l’on parle de sexisme à un homme, qui a certes pas toujours, mais néanmoins trop souvent tendance à amoindrir les choses. Il faut se rendre à l’évidence, les hommes ont souvent du mal à comprendre le sentiment de malaise que peut ressentir une femme qui se fait aborder dans la rue si elle n’a pas de raison de se sentir en insécurité. On admet volontiers que les femmes sont des cibles plus vulnérables aux agressions, mais on a plus de mal à reconnaitre que le harcèlement de rue est un problème réel. Un commentaire sexiste est souvent entendu par l’autre genre comme un compliment, une remarque flatteuse, alors qu’elle est souvent vécue comme une intrusion, comme une tentative de proximité indue. Donc oui, en soit, ce n’est pas la mer à boire. Je devrais peut-être m’estimer heureuse qu’on m’appelle ma jolie et pas mon hideuse au travail. Mais pourquoi est-ce qu’on me parle de mon apparence à moi et pas à mes collègues ? Pourquoi est-ce que quand un collègue fait une slide qui ne convient pas, on lui demande de la refaire, point, alors que quand il s’agit d’une des miennes, on m’explique qu’elle fait trop « Barbie » (bien qu’elle respecte la charte graphique de la banque) ? Pourquoi est-ce que je devrais supporter de me faire draguer sur mon lieu de travail par un supérieur marié et père de famille alors que mes collègues ne connaitront jamais cette gêne ? Ce n’est pas si grave, mais ces comportements sont ancrés dans les mœurs et continuent à contribuer au fait qu’il reste difficile, quand bien même on fait passer des lois, et quand bien même on pense à imposer des quotas, pour une femme de se sentir égale à un homme sur son lieu de travail. Aime le connard mais méprise la salope - ce n’est pas que de la faute des hommes
De mon point de vue, le problème est indéniablement un problème de société. Je le pense dû à un décalage certain entre l’évolution des mœurs, des lois, et des mentalités. Et cela n’est pas propre aux hommes. J’ai vu autant de femmes que d’hommes choquées de me savoir en finance dans des postes à hautes responsabilités et aux horaires impossibles, du fait de ma condition féminine. Les autres femmes sont premières sur le discours moralisateur du « mais quand même, tu as pensé un peu à ta future vie de famille ? Pour un homme ok, mais toi tu vas être maman un jour, comment tu crois que tu vas te débrouiller ? ». Et, si je ne me suis pas souvent faite accoster par des femmes dans la rue, j’ai néanmoins trop souvent entendu des femmes critiquer les tenues des unes et des autres, insulter les filles qui s’affichent comme ayant des « mœurs légères » tandis que les mêmes instigatrice de ces critiques tombent dans les bras du premier venu qui ait le même genre de comportement. Deux poids, deux mesures, disent-elles ? Il faut l’admettre, nous sommes les premières à nous freiner dans notre ascension vers le succès. C’est ancré en nous, le contexte a transféré, et nous ne nous considérons pas pleinement comme ayant droit à autant de liberté, pour ne parler que de ça, que les hommes. Aime le connard mais méprise la salope, c’est un peu le leitmotiv des femmes en 2016, qu’elles l’admettent ou non. Si la prépondérance des réseaux sociaux permet et mène de plus en plus de femmes à publier des clichés d’elles de plus en plus dénudées, ce n’est que pour affirmer une liberté qu’elles sentent trop fragile. Comparons. Qui serait choqué de voir un homme torse nu sur Instagram ? Pas grand monde. Mais pourquoi n’a-t-on alors pas de déferlement de photos d’hommes dénudés du haut sur les réseaux sociaux ? Ils n’en ressentent tout simplement pas le besoin. Ils ont le droit, pas nous. Si nous nous sentions pleinement en droit de faire ce que l’on veut de notre corps, alors pourquoi nous appellerions-nous les unes les autres si facilement des filles faciles ? La rivalité purement féminine pour plaire aux hommes n’est-elle finalement pas l’expression d’une rivalité aux hommes pour obtenir autant de liberté qu’eux ? Je pense que finalement, on ne se bat jamais pour l’attention des garçons, mais bien pour se prouver qu’on a autant de liberté qu’eux et finalement être leur égal. Il est toutefois malheureux que cela nous pousse à se juger les unes les autres. La morale de cet article J’ai eu beaucoup de mal à trouver la suite de cet article, parce que je lui cherchais une sorte de morale. Comme si en écrivant je voulais répondre à la question qui aurait été ma problématique idéale : du coup, on fait quoi ? Je ne pense pas qu’il y ait de solution, seul le temps fera les choses, il faut simplement que les mentalités s’adaptent aux mœurs et aux lois. Et c’est un processus qui met du temps et qui progresse un peu plus chaque jour. Les comportements normaux d’hier sont anormaux aujourd’hui, et les inégalités d’aujourd’hui seront illégales demain. J’aurais aimé voir cet article écrit par un homme, mais comme je l’expliquais plus haut, mon ressenti est qu’il est assez improbable de voir un homme se lever pour défendre la cause des femmes - en tout cas je demande à mes lecteurs un petit effort de transposition. Je l’ai dit plus haut, je ne suis pas féministe. Je n’ai pas le sentiment de me croire représentative ou défenseuse de la cause de toutes les femmes, je partage juste un ressenti. Je ne parle au nom de personne, mais je parle à tous, donc si des choses vous interpellent, l’équipe de l’objectif serait heureuse de voir éclore un débat ! Une jeune femme moderne.
C’est un jour pesant à New York, il fait lourd et c’est le cœur serré que se réveillent les habitants de la grande pomme quinze ans après les attentats du World Trade Center. Officiels, rescapés et proches de victimes sont réunis devant le mémorial érigé en l’honneur de ceux qui sont devenus les martyrs de l’Amérique. Soudain une silhouette s’effondre, à côté du maire de la ville, la candidate démocrate et favorite des sondages Hilary Clinton est prise d’un malaise. Prétextant l’émotion, ses communicants seront forcés d’avouer qu’elle est en réalité atteinte d’une pneumonie.
Tout au long de la cérémonie on pouvait apercevoir au loin une tour scintillante, reflétant les rayons du soleil, c’est la Trump Tower. Le destin aussi semble rayonner pour son propriétaire, ce gnostique qui affirme à demi-mots qu’il a été choisi par Dieu. Alors que l’écart avec sa rivale démocrate se resserre de semaines en semaines, ce coup de théâtre devrait faciliter encore un peu son ascension vers la Maison Blanche. Nombreux sont les commentateurs de la vie politique Américaine à rejeter l’élection de Trump dans l’irréel en pointant du doigt son irrationalité. Pourtant l’histoire a montré à bien des occasions que le réel pouvait être fort accommodant avec l’irrationnel. En fait, le scénario d’un Donald Trump à la Maison Blanche est tout à fait possible et même probable. N’oublions pas que jusqu’en septembre 1982, Reagan était largement moqué par la presse qui affirmait qu’il ne serait jamais élu, Georges Bush avait même qualifié le programme économique de son rival républicain « d’économie vaudou ».
De qui Trump est-il l’héritier ?
Donald Trump est loin d’être un phénomène ex-nihilo, il est l’incarnation d’une pensée populiste qui a toujours existé outre-Atlantique et que l’on a trop souvent voulu minorer. Si l’on ne comprend pas cet héritage on ne peut comprendre comment des républicains modérés et rationnels ont pu être dépassés par un candidat milliardaire qui prétend être celui qui « porte la parole de ceux que l’on entend pas ». Comme tous les populistes qui prospèrent aujourd’hui en faisant fructifier leur porte-monnaie électoral sur les débris encore fumants laissés par la crise, Donald Trump doit être pris au sérieux. Mais qualifier celui-ci de populiste n’est pas suffisant, il est indispensable d’abord de définir ce que signifie ce terme aujourd’hui devenu générique de populisme. Daniele Albertazzi et Duncan McDonnell dans le populisme au XXIème siècle le définissent comme une idéologie qui « oppose un peuple vertueux et homogène à un ensemble d'élites et autres groupes d'intérêts particuliers de la société, accusés de priver (ou tenter de priver) le peuple souverain de ses droits, de ses biens, de son identité, et de sa liberté d'expression ». On se trouve bien ici au cœur du problème, Trump alors qu’il est l’incarnation d’une partie de ces élites martèle à qui veut l’entendre qu’il va détruire celles-ci et rétablir le pouvoir des « vrais gens » à Washington. Il promet ainsi une option encore jamais essayée, celle de faire de la politique autrement sans organe intermédiaire. Cette ambition qui peut paraitre attractive pour une certaine partie de la population est en réalité néfaste et menace directement l’Etat de droit. En prétendant se débarrasser des élites en supprimant les corps intermédiaires comme les assemblée élues ou les administration -bref tout ce qui a permis de conserver une certaine concorde au sein de nos sociétés- on ouvre la porte au gouvernement des instincts, à la haine voir à la guerre civile. Trump utilise aussi largement le sentiment d’abandon de certaines franges de la population qui ne se sentent pas représentées alors qu’elles le sont de fait par les mécanismes électoraux. Cette rhétorique, c’est celle qui a fait prospérer McCarthy au début des années 50. Chez les deux hommes, la dimension psychologique occupe une place capitale, l’extravagance et l’usage de l’exagération comme outil rhétorique les rapproche en effet énormément. On prête d’ailleurs à McCarthy la fameuse phrase « plus c’est gros plus ça passe », l’adage Trumpiste par excellence.
Donald Trump est-il un conservateur ?
Il est courant d’utiliser la notion de malaise ou d’insécurité culturelle pour expliquer le succès électoral des conservateurs mais cette analyse est largement incomplète. Elle se base en fait sur des arguments psychologiques dépassés qui ont été utilisés pour tenter d’expliquer le nazisme (notamment chez Adorno). « La contestation des maccartistes doit être en toute précision nommée pseudo- conservatrice. Je prendrai ici le sens de conservateur à Adorno, car ses partisans quoi qu’ils utilisent la rhétorique du conservatisme et se disent eux mêmes conservateurs montrent une résistance constante et sérieuse quant au mode de vie Américain, aux traditions et à la société américaine. Ils ont peu en commun avec l’esprit de tempérance et de compromis qui est le propre du véritable conservatisme au sens classique du terme. Leur réaction politique montre plutôt une haine totale de notre société et de son fonctionnement qui même si elle est en grande partie inconsciente n’en est pas moins profonde. » Richard Hofstadter dans paranoid style Richard Hofstadter en plus d’être l’un des plus brillant observateur de la société Américaine note ici une distinction trop souvent négligée entre conservatisme et populisme. Au fond, si Trump et McCarthy en son temps sont si populaires, ce n’est pas parce qu’ils utilisent des thématiques chères aux conservateurs mais plutôt parce qu’ils prospèrent sur une vague d’indignation et de haine envers la société Américaine à un temps donné. Trump a tout à fait compris cet aspect et cherche désormais à séduire les électeurs de Bernie Sanders dont les affinités avec les conservateurs sont loin d’être évidentes ! L’adhésion des masses s’expliquerait donc ici bien plus par par un rejet du système en tant que tel et de ses élites que par des facteurs psychologiques. De même, on a souvent l’idée que l’électeur type serait , le "petit blanc déclassé" or une étude des soutiens de Goldwater montre que la majorité des militants appartiennent à la classe moyenne supérieure et ne sont pas mis à l’écart de la modernisation au contraire. Ce dernier fut par exemple largement plébiscité dans le compté d’Orange en Californie où la population est en moyenne très aisée et ne peut pas être considérée comme étant mise à l’écart de la modernité.
Surfer sur la peur de la mondialisation :
Trump doit aussi son succès à une compréhension aiguë des frustrations et des craintes qu'a crée une mondialisation loin d’être heureuse pour beaucoup d’Américains. Certes une partie de ses électeurs se sent bien en situation d’insécurité culturelle, craignant la transformation ethnique des Etats-Unis où ils deviendraient une minorité comme les autres. Mais ce sentiment a des motivations largement économiques. Trump ayant intégré cet aspect à son discours, il est le seul sur la scène politique avec Bernie Sanders à proposer de débattre des effets de la mondialisation. Il dénonce notamment les politiques de dérégulation abusives mises en place par Bill Clinton et dont il accuse Hilary Clinton d’être l’héritière. Mais comment ne pas comprendre ce malaise d’une partie de l’Amérique quand on sait qu’aujourd’hui 43 millions d’Américains sont réduits à utiliser des coupons alimentaires, que 15% du pays vit sous le seuil de pauvreté et que comme le démontre Isaac martin, 12 millions de personnes ont été contraintes d’abandonner leur maison pour vivre dans des mobil-homes ou de retourner chez leurs parents après la crise de 2008. Au fond Trump utilise les recettes qui ont fait prospérer le « people’s party » au début des années 1890, lors de la première mondialisation. La modernisation via les chemins de fer et l’urbanisation avait créé naguère un rejet massif des élites qui avaient prospéré grâce à des mesures telles que le railway act. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, face à ces changements, Trump rassure, en adoptant un discours irrationnel, allant jusqu’à affirmer qu’il ira négocier avec les Chinois pour annuler les accords de libre échange. En fait, le candidat républicain prospère grâce au vide laissé par une partie des élites, dont Hilary Clinton sur ce sujet qu’ils refusent d’aborder.
Trump ou la vanité du Narcisse :
Max Weber le savant et le politique, le politique comme métier et vocation : « Il n’existe tout compte fait que deux sortes de péchés mortels en politique : ne défendre aucune cause et n’avoir pas le sentiment de sa responsabilité – deux choses qui sont souvent, quoique pas toujours, identiques. La vanité ou, en d’autres termes, le besoin de se mettre personnellement, de la façon la plus apparente possible, au premier plan, induit le plus fréquemment l’homme politique en tentation de commettre l’un ou l’autre de ces péchés ou même les deux à la fois. D’autant plus que le démagogue est obligé de compter avec « l’effet qu’il fait », c’est pourquoi il court toujours le danger de jouer le rôle d’un histrion ou encore de prendre trop à la légère la responsabilité des conséquences de ses actes, tout occupé qu’il est par l’impression qu’il peut faire sur les autres. D’un côté, le refus de se mettre au service d’une cause le conduit à rechercher l’apparence et l’éclat du pouvoir au lieu du pouvoir réel ; de l’autre côté, l’absence du sens de la responsabilité le conduit à ne jouir que du pouvoir pour lui-même, sans aucun but positif. En effet, bien que, on plutôt parce que, la puissance est le moyen inévitable de la politique et qu’en conséquence le désir du pouvoir est une de ses forces motrices, il ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la politique que celle du matamore qui joue avec le pouvoir à la manière d’un parvenu, ou encore du Narcisse vaniteux de son pouvoir, bref tout adorateur du pouvoir comme tel. Certes le simple politicien de la puissance [Machtpolitiker], à qui l’on porte aussi chez nous un culte plein de ferveur, peut faire grand effet, mais tout cela se perd dans le vide et l’absurde. Ceux qui critiquent la politique de « puissance » ont entièrement raison sur ce point. Le soudain effondrement moral de certains représentants typiques de cette attitude nous a permis d’être les témoins de la faiblesse et de l’impuissance qui se dissimulent derrière certains gestes pleins d’arrogance, mais parfaitement vides. Une pareille politique n’est jamais que le produit d’un esprit blasé, souverainement superficiel et médiocre, fermé à toute signification de l’activité humaine ; rien n’est d’ailleurs plus éloigné de la conscience du tragique qu’on trouve dans toute action, et tout particulièrement dans l’action politique, que cette mentalité. » Ce texte pourtant vieux de plus d’un siècle n’est-il pas violemment actuel ? Ne peut-on pas transposer ces mots pour pour décrire la scène politique contemporaine ? Sans aucun doute. Trump par exemple –mais bien d’autres aussi- entre parfaitement dans le portrait type établi par Max Weber. Comme l’homme politique décrit dans le texte, Trump n’a qu’une conscience éloignée du tragique que peuvent provoquer les mots et pas de conscience du tout du vide et de l’absurde dans lequel il perd le discours politique. Sans aucun but positif, il se refuse à la pensée, qui pourtant doit gouverner les actes des dirigeants pour y substituer ce qu’il appelle « l’action réelle ». Tour de passe passe fort classique chez les populistes, il s’affirme comme anti-intellectuel et se repose sur la mythologie Américaine du « doer ». Mais Weber souligne également ici la différence entre populisme et démagogie. En effet, là où le démagogue cherche à plaire à tout le monde le populiste lui clive pour flatter une partie de la population en en stigmatisant une autre.
Trump Démagogue ou populiste ?
« Tous ces particuliers mercenaires, que le peuple appelle sophistes et regarde comme des rivaux, n'enseignent pas d'autres principes que ceux que lui-même professe dans ses assemblées, et c'est cela qu'ils appellent science. On dirait un homme qui, ayant à nourrir un animal grand et fort, après en avoir observé minutieusement les mouvements instinctifs et les appétits, par où il faut l'approcher et par où le toucher, quand et pourquoi il est le plus hargneux et le plus doux, à propos de quoi il a l'habitude de pousser tel ou tel cri, et quels sons de voix l'adoucissent ou l'irritent, qui, dis-je, après avoir appris tout cela par une fréquentation prolongée, donnerait à son expérience le nom de science, en composerait un traité et se mettrait à l'enseigner, sans savoir véritablement ce qui dans ces maximes et ces appétits est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste, ne jugeant de tout cela que d'après les opinions du gros animal, appelant bonnes les choses qui lui font plaisir, mauvaises celles qui le fâchent, incapable d'ailleurs de justifier ces noms, confondant le juste et le beau avec les nécessités de la nature, parce que la différence essentielle qui existe entre la nécessité et le bien, il ne l'a jamais vue ni ne peut la faire voir à d'autres. Au nom de Zeus, ne te semble-t-il pas qu'un précepteur serait bien étrange ? » PLATON la république Le texte ci-dessus nous montre l’étroitesse du lien entre démagogie au populisme. En fait la plupart des populistes ont souvent une utilisation populiste du raisonnement démagogique. La démagogie dans l’étymologie signifie l’art de savoir « conduire le peuple », ce qui est assez peu attrayant au final voir anecdotique pour un homme politique qui cherche à être élu. Le Pen dans son altercation veut à l'inverse prouver non pas qu'il est un guide du peuple mais qu'il en est un élément comme les autres. Surtout, une erreur d’analyse consiste à trop souvent vouloir minorer l’importance de ces mouvements en les qualifiants d’anecdotiques, affirmant que sur le long terme ils seront voués à disparaître. Ce phénomène ne disparaîtra pas, au contraire, il est le signe d’une déconnection à laquelle il nous faut remédier, le signe aussi que la gauche de pouvoir a complètement failli à sa mission, laissant son électorat traditionnel basculer dans le populisme. Car ne nous y trompons pas, les conservateurs souvent au caractère tempéré tombent rarement dans les excès de la sophistique. Rédouane Ramdani Cessons d'être pessimistes. Le monde de demain sera probablement meilleur que celui d'aujourd'hui. Il suffit de le vouloir... et d'y croire.
On nous fait peur. Sur la société qui nous attend, sur les bouleversements de nos métiers, sur notre capacité à nous - les plus de 35 ans - à faire face, à s’adapter, nous qui avons été formés de compétences déjà obsolètes, nous qui ne sommes pas nés un téléphone à la main, nous qui allons subir le tsunami de la génération Z … Et si nous faisions le choix collectif de dire non à la peur ? Le choix difficile de l’optimisme ? Et si nous décidions d’être nous, les acteurs du monde de demain ? Dans 15 ans, j’aurais 48 ans. 40 à 50% des métiers auront disparus en particulier à cause des machines . Ce n’est pas moi qui le dit ni Marty McFly, c’est Harvard, Oxford (1), et tout un tas de chercheurs très sérieux. La science aura fait des progrès énormes, pour le meilleur et aussi probablement le pire. Un monde chaotique ? Alors dans 15 ans, on imagine un scénario où l’on fait un métier sans trop savoir pourquoi, où les machines ont remplacé beaucoup de choses inintéressantes qu’on avait l’habitude de faire mais aussi des choses qu’on aimait faire, où l’on est tellement connectés qu’on chat avec un inconnu au bout du monde mais qu’on ne connait pas son voisin. Un scénario où l’on ne va plus à la pompe car un robot vient automatiquement recharger notre réservoir d’une essence de plus en plus difficile à produire, où l’on se nourrit de pilules aux goûts acidulés car nous avons épuisé nos ressources, où la science nous permet d’avoir 3 enfants tous nés de sexe masculin parce que c’est plus pratique le dimanche pour le programme foot. Un monde où l’on entend toutes les semaines qu’un pays disparaît de la carte pour manque d’eau , sans parler des conflits, des catastrophes naturelles et autres désastres humanitaires ….. Et là je dois le reconnaître, j’ai un peu peur. Un avenir radieux ? Ou alors dans 15 ans, on n’a pas un métier mais trois activités , complémentaires, épanouissantes, certaines rémunérées et d’autres pas. En France, le nombre d’indépendants a augmenté de 85% en moins de 10%. La « plateformisation » de l’économie va accélérer de façon exponentielle cette tendance. Dans 15 ans, on utilise les machines pour nous soutenir, mais on a su mettre des valeurs et de l’éthique au coeur de nos décisions, sans laisser le fantasme de l’homme augmenté nous brûler les ailes. Dans 15 ans, on connait son voisin et sa voisine, et avec eux, on troque, on partage, on rigole. On ne va plus à la pompe parce qu’on n’a plus de voiture. On mange des légumes biologiques produits en permaculture sur la ferme-terrasse de son immeuble. Dans 15 ans, on a 3 enfants qui sont tous très différents, très créatifs, très empathiques, et l’école elle aussi a changé. Elle apprend à réussir avec plutôt que contre les autres. A poser des questions plutôt qu’à réciter des réponses. Et du coup le programme du dimanche devient une vraie galère de créativité. On préserve nos ressources, on les partage, on vit ensemble sur une même planète. Surfer ou se noyer La vague est là. La question est de savoir si on surfe dessus ou si on se laisse noyer. On ne va pas se mentir, y a du boulot. Mais si l’on fait le choix du verre à moitié plein, fini la peur. En France, aujourd’hui, on invente des écoles pour que tout le monde puisse apprendre à coder. On sait comment remettre en selle des personnes cassées par la vie avec des modèles d’insertion qui ont fait leur preuve. Et certains vont même répliquer nos modèles dans la Silicon Valley. On innove pour généraliser l’économie circulaire et éliminer le gaspillage en créant d’énormes opportunités économiques. On réinvente la distribution du producteur au consommateur. Et de nouvelles formes de croissance. Simplon, Calso, La Ruche qui Dit Oui !, Phenix, …derrière toutes ces initiatives, des 35-45 ans, ceux-là même dont on dit qu’ils vont être submergés. Dans la définition du Larousse, la peur « est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre ». Choisissons le combat, celui de l’optimisme ! Laurence Lamoureux, fondatrice de MySezame |
AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives
Juin 2017
Catégories
Tout
|
|
L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].
Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |





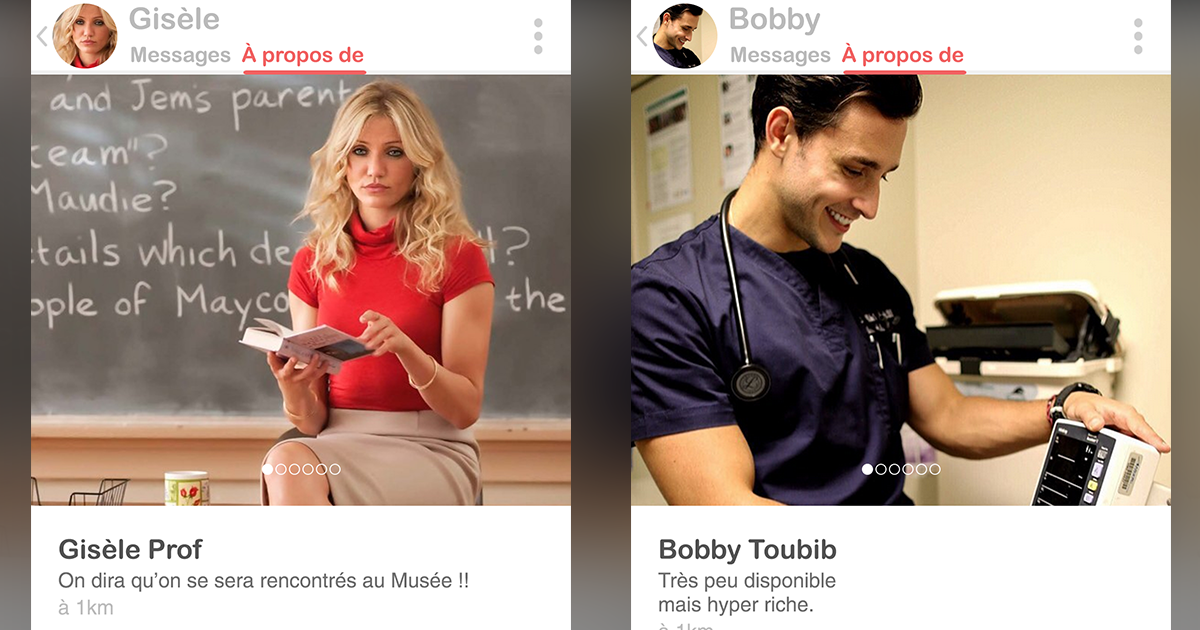












 Flux RSS
Flux RSS