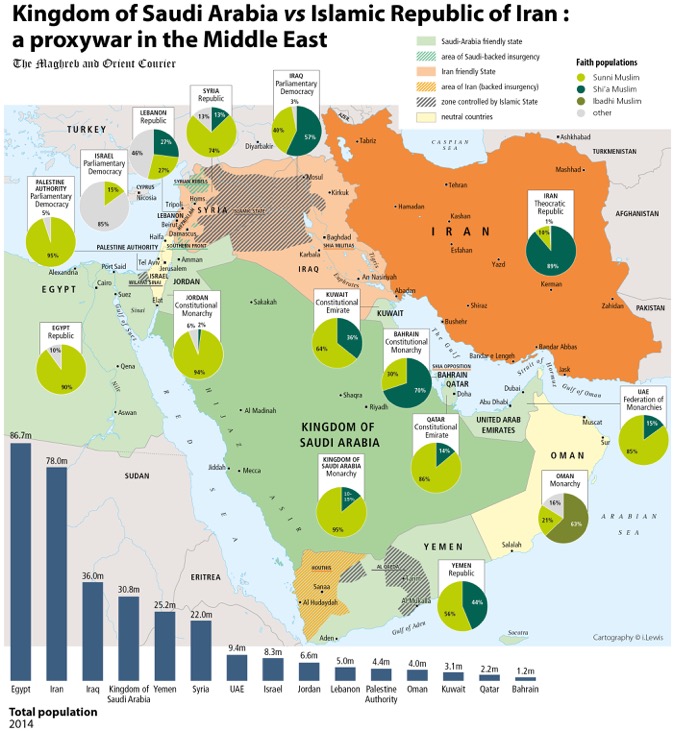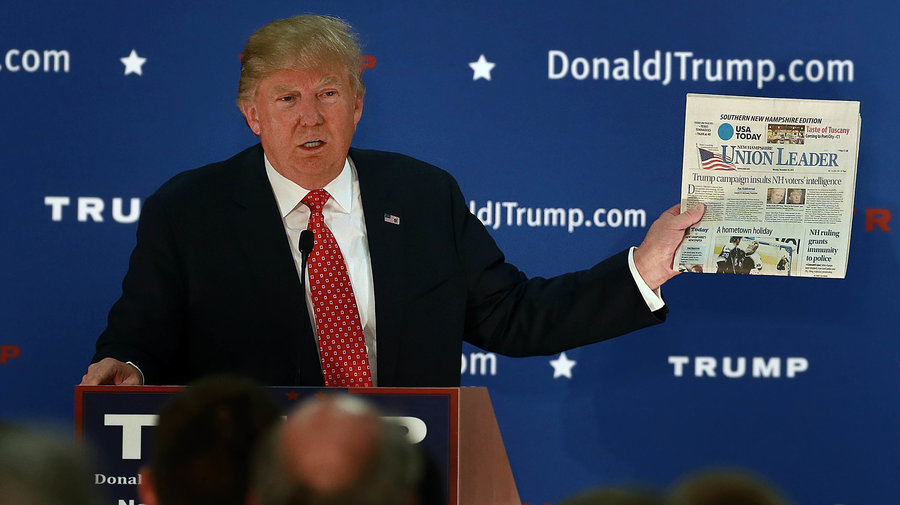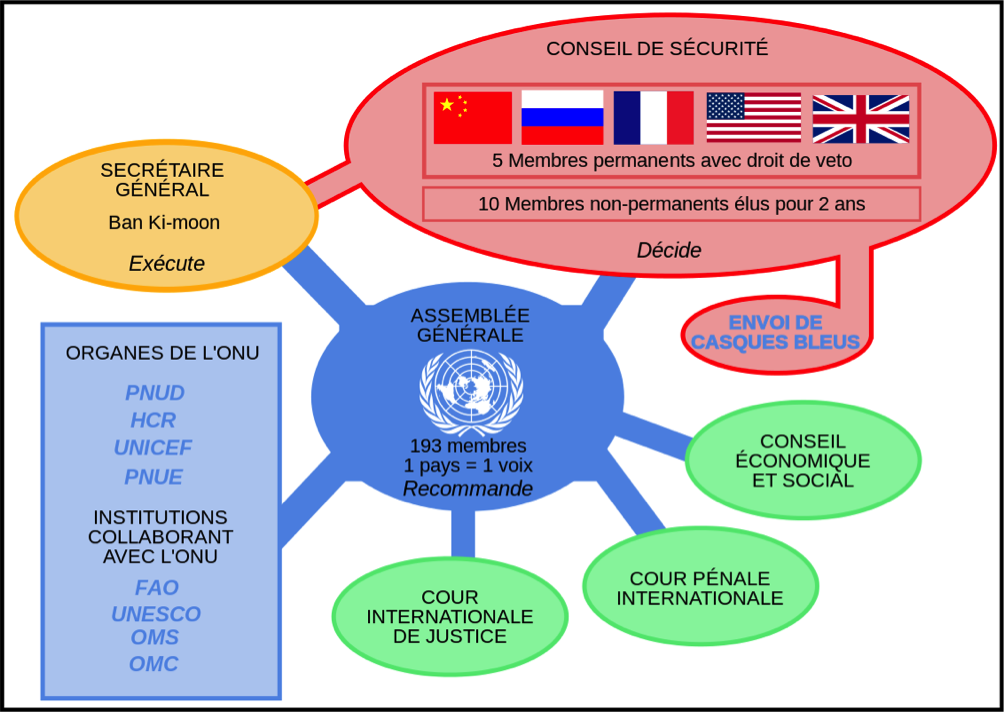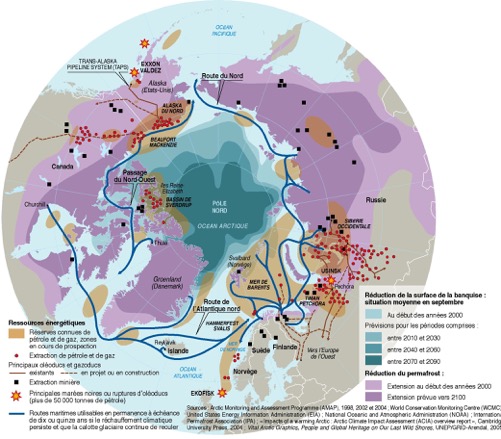LA VIDÉO DU JOUR : John Oliver explose Trump suite à sa décision de sortir de l'accord de Paris6/6/2017 L’humour pince-sans-rire de John Oliver a encore frappé. Son show satirique hebdomadaire diffusé sur la chaîne américaine HBO, Last Week Tonight with John Oliver, s’attaque cette fois au retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat, décidé la semaine dernière par le Président américain Donald Trump. Au-delà des gags brillantissimes, le comédien et ses équipes se sont attelés à un admirable travail de fact-checking et d’explications claires, précises et sans appel. À voir d’urgence : le génie humoristique de John Oliver, allié plus que jamais à un journalisme intransigeant, place encore une fois le présentateur au-dessus de la mêlée.
0 Commentaires
Pour la première fois, Marion a déposé sa candidature auprès d'En Marche ! pour les prochaines élections législatives. Même si les résultats viennent de tomber et qu’elle n’a pas été prise, elle raconte ce qui l’a poussée à franchir le pas. À 31 ans, je viens de déposer ma candidature auprès d’En Marche ! pour les législatives. Je suis responsable export dans l’industrie métallurgique. Je suis née à Bourges, et j’ai grandi à la campagne dans un village à cinquante kilomètres de là. C’était un milieu rural avec toutes les difficultés qu’on lui connaît. Ma vie a été assez mouvementée. D’une part avec mon parcours scolaire et d’autre part avec mon parcours professionnel. J’ai commencé par faire médecine, puis des études d’infirmière, pour enfin faire du commerce et me spécialiser dans l’hôtellerie. Maintenant, je travaille pour l’entreprise familiale. Et j’ai décidé de candidater pour me présenter aux élections législatives. En Marche ! n’est pas le premier parti politique auquel j’adhère En 2007, durant la campagne présidentielle, j’étais militante avec les jeunes UMP. Mais au bout de deux ans, je ne me reconnaissais plus du tout dans la façon dont était géré le parti et dans les idées qu’il soutenait comme la Manif pour tous. Ça ne me correspondait plus, alors je suis partie. Économiquement, je me rapproche d’un programme de droite mais socialement, je suis plutôt sur un programme socialiste modéré. J’ai adhéré à En Marche ! peu de temps après sa création en juin 2016. Je n’ai pas adhéré pour le projet ni pour militer, mais plutôt pour suivre et être informée des avancées du mouvement. De toute façon, j’avais un planning très chargé donc je n’aurai pas pu, même si j’en avais eu l’envie. C’était tout nouveau et j’étais curieuse. Emmanuel Macron était un leader que personne ne connaissaient quelques années plus tôt, et surtout, il avait un charisme certain dans sa politique au gouvernement. Ça me ressemblait et il était important pour moi que je puisse me rapprocher de cette volonté pour la France. Dès le début, j’ai cru au changement. Insuffler un peu de jeunesse dans une société peuplée de politiques vieillissants, ça rassure et ça redonne espoir. Je me suis inscrite en toute simplicité Mercredi, j’ai décidé d’envoyer ma candidature, 24 heures avant la clôture des inscriptions. J’y réfléchissais depuis le mois de janvier, mais je n’ai jamais eu le courage. Retournement de situation, ce week-end, j’en avais vraiment envie. Ça fait des années que j’en parle, que j’aimerais beaucoup être députée et je ne voulais pas regretter. Je me suis donc lancée. Le processus de candidature est en ligne. Il y a plusieurs questions. C’est assez rapide, mais c’est quand même trois heures de travail pour remplir correctement tout le dossier. Il y a des questions à remplir sur nos motivations, et sur notre engagement avec En Marche !. Un peu plus loin, il faut un CV et une lettre de motivation d’une à deux pages. C’était un peu comme si on postulait à un job mais ça ne m’a pas choquée, ça m’a rassurée. Certaines personnes se sont quand même plaintes, paraît-il. Je n’ai pas candidaté aux législatives pour rien Il y a plusieurs raisons à ma candidature. D’abord, je me présente dans la région où je suis née et où je travaille. C’est un lieu qui me tient à cœur, mais c’est aussi une région qui a de grosses difficultés. Au niveau des transports, de la santé, de l’éducation, il y a de grands progrès à faire. La sécurité est aussi à améliorer. Il ne faut pas croire qu’il ne se passe rien à la campagne. Au contraire, les forces de l'ordre sont moins présentes. Certains sujets me tiennent vraiment à cœur. J’ai été très présente dans les milieux culturels puisque ma mère a longtemps travaillé dans une salle de spectacle. On a la chance d’avoir une offre culturelle et sportive dans notre région qui est superbe. S’il y a quelque chose qu’on ne peut ne pas reprocher aux différentes personnes qui sont venues chez nous, c’est bien cela. La culture est importante et il faudra pérenniser et poursuivre les efforts dans ce sens-là. Je pense absolument qu’il faut s’attaquer à trois sujets majeurs : les transports, l’éducation et la lutte contre les déserts médicaux. Ici, il faut un an pour avoir un rendez-vous chez l’ophtalmo par exemple. Ma région et la France doivent se relever à tout prix
Nous sommes dans une région centrale qui devrait être attrayante et un atout majeur pour tous les jeunes cadres dynamiques, pour tous les jeunes couples, les familles… pour tous les gens qui ont envie de quitter Paris tout en étant proche de tout, en fait. Ça devrait être une région d’attractivité et aujourd’hui, ça ne l’est pas. On appelle ça un "trou" et je suis dépitée d’entendre les gens qualifier ma région de la sorte. J’ai envie de faire évoluer les choses, participer au changement et réfléchir au niveau national à ce que l’on pourrait faire et modifier dans ce pays pour que ça aille mieux. Les Français sont tristes. J’en ai marre de voir ça et pourtant, j’adore mon pays. J’ai beaucoup voyagé. Je suis allée voir ailleurs ce qu’il se passait, j’ai habité à l’étranger, en Asie du Sud-Est, en Turquie pour le travail... Mais Je trouve que c’est typiquement français d’être triste. J’ai envie de redonner ce sourire au Français. Ils ont le plus beau pays du monde… Ce n’est pas normal ! Cette situation n’est la faute de personne. On ne va pas jeter la pierre sur quelqu’un en particulier. C’est à cause des différentes classes politiques au fil des époques qui n’ont pas su se renouveler comme il le fallait. On nous dit "Liberté, Égalité, Fraternité", mais l’égalité, on la cherche vraiment. On est un pays qui est nivelé par le bas. Qui est morose aujourd’hui ? Ce sont les classes moyennes car on les empêche de s’élever. Malgré ma déception, je continuerai à mener le combat J’ai reçu une réponse, malheureusement elle était négative. Je suis déçue par le résultat mais je n’hésiterai pas à retenter dans cinq ans. Maintenant, j’attends de Macron qu’il ait le courage de réformer. Mais le Front national me fait de moins en moins peur car Madame Le Pen nous a montré de quoi elle était capable au dernier débat… C’était assez risible. Aujourd'hui, je me méfie surtout du parti de Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau président serait un président minoritaire, en dépit des 66 % de suffrages qui se sont portés sur son nom. C’est un fort mauvais procès. On vit, décidément, une époque formidable. Ou plutôt, quarante ans après Reiser, excitée jusqu’à l’absurde et nerveuse jusqu’à l’aveuglement. L’on en veut pour preuve ce simple constat : à peine élu, voilà Emmanuel Macron récusé par certains.Il n’a pas encore pris ses fonctions et voilà sa légitimité mise en doute. L’on ne sait rien de son gouvernement, pas même s’il aura une majorité à l’Assemblée et voilà, déjà, ses projets condamnés. Notamment par les procureurs de La France insoumise et les sans-culottes autoproclamés qui n’ont pas attendu 24 heures pour descendre dans la rue et décréter la « guerre sociale ».
L’outrance pourrait prêter à sourire si cette intolérance ne témoignait d’un fâcheux déni des règles de la démocratie. C’est, en effet, un étrange procès qui a été engagé, sans perdre une minute, contre le nouveau chef de l’Etat : il serait un président minoritaire, en dépit des 66 % de suffrages qui se sont portés sur son nom. La démonstration se veut implacable. Elle souligne d’abord qu’un quart des Français (12 millions) n’ont pas été voter le 7 mai. C’est effectivement un record d’abstention depuis l’élection présidentielle de 1969. Elle pointe ensuite le nombre des électeurs qui se sont déplacés pour mettre dans l’urne un bulletin blanc ou nul et signifier ainsi leur défiance à l’égard des deux candidats en lice ; ils étaient 4 millions, nouveau record. Le calcul est simple : si l’on tient compte de ces 16 millions d’abstentions et de votes blancs, Emmanuel Macron n’a recueilli le soutien que de 43,6 % des électeurs inscrits. CQFD. C’est oublier une vérité élémentaire : il en est ainsi depuis un demi-siècle ! A l’exception du plébiscite en faveur de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002, aucun président de la Ve République n’a rassemblé sur son nom la majorité des inscrits. Le général de Gaulle en a recueilli 45,3 % en 1965, Valéry Giscard d’Estaing 43,7 % en 1974, François Mitterrand 43,8 % en 1988. Quant à Georges Pompidou en 1969 (37,5 %), François Mitterrand en 1981 (43 %), Jacques Chirac en 1995 (39,4 %) et François Hollande en 2012 (39,1 %), ils ont fait moins bien qu’Emmanuel Macron. L’on n’a pas le souvenir que, pour autant, leur élection ait été contestée. Ce n’est pas tout, ajoutent les sceptiques. Quelque 40 % des électeurs qui ont voté Macron l’ont fait, disent-ils, pour faire barrage à la candidate du Front national. La belle affaire ! Comme si la victoire de François Mitterrand en 1981 ne résultait pas, pour une bonne part, du rejet de Valéry Giscard d’Estaing. Et tout autant celle de François Hollande face à Nicolas Sarkozy en 2012. Bref, il s’agit là d’un fort mauvais procès. Qu’il relève d’un mouvement général de contestation de la légitimité des autorités – politiques, notamment – est une évidence. Qu’il reflète l’état de doute, de défiance, voire de colère d’une partie des Français à l’égard de leurs gouvernants, ne l’est pas moins. Mais l’on ne saurait, sans danger, contester le principe même de l’élection : le président de la République est celui des candidats qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Il sera bien temps pour ses adversaires de combattre Emmanuel Macron sur le terrain parlementaire ou social. Qu’ils lui accordent, dans l’immédiat, non pas un état de grâce, ni même un délai de grâce, mais tout simplement le temps de s’installer, de constituer son équipe et d’engager son action. Ce serait la moindre des corrections démocratiques. Publié dans le Monde Jean-Luc Mélenchon ne s’est hissé qu’à la quatrième place de cette élection présidentielle (19,62 %). Comme Philippe Vallée, 58 ans, nombre de ses soutiens, déçus, ont donc décidé de s’abstenir lors du second tour, refusant de voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national. J’ai 58 ans et suis chauffeur pour enfants handicapés à Marseille. Voilà deux mois, j’ai décidé de rejoindre le mouvement des Insoumis, car c’était l’offre politique citoyenne qui me correspondait le mieux. Ma motivation première était de participer à un mouvement citoyen, qui puisse faire évoluer la représentation politique. J’estime qu’au Palais Bourbon, parmi les 577 députés, une mixité sociale doit s’instaurer. Durant ces deux derniers mois, j’ai donc fait bien plus que voter, j’ai milité et rejoint un groupe d'appui mélenchoniste dans le 10e arrondissement de Marseille. J’ai collé des affiches, tracté... Je me suis vraiment impliqué dans la campagne de la France insoumise. J’ai ressenti une profonde déception Dimanche 23 avril au soir, après avoir fait mon devoir de citoyen en participant au dépouillement de mon bureau de vote, j’ai suivi les résultats à la télévision toute la soirée jusqu’à 1 heure du matin. Je ne peux pas nier que j’ai ressenti une profonde déception de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon accéder au second tour. Au fil des heures, j’ai vu les compteurs remontés doucement, je l’ai vu effleurer Fillon. J’ai réellement cru qu’on pouvait espérer la troisième place. La prudence dont a fait preuve Jean-Luc Mélenchon, en ne reconnaissant pas tout de suite les résultats, était de mise. Pour autant, je n’avais plus vraiment d’espoir de le voir dépasser Marine Le Pen. Cet échec n’a pas vraiment été une surprise car la dernière semaine de campagne a été horrible. On nous a fait passer pour des Bolchéviques, des admirateurs de Hugo Chavez, des extrémistes, ce qui est totalement faux. Toutefois, son score important est une victoire pour le peuple d’en bas, les 19,62% de citoyens qui se sont reconnus dans la France insoumise n’ont pas disparu ce dimanche à minuit, ils sont toujours là. Je continuerai donc à donner de ma personne en vue des législatives. Pourquoi j'ai décidé de m'abstenir Ma décision de m’abstenir au second tour du scrutin n’a pas été facile à prendre. Jusqu’à tard dimanche, je pensais encore voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front national. J’étais même en opposition avec ma compagne qui avait décidé, dès le départ, de ne pas se rendre aux urnes. Trois raisons ont motivé ce revirement de situation : tout d’abord, la nécessité de montrer que je n’adhère ni au fascisme, ni à ce que j'appelle le "cupidalisme", soutenu par Emmanuel Macron. Ce néologisme, que j’ai inventé dans la cadre de la rédaction d’un essai intitulé "Que d’mande le peuple ?", désigne le fils de la cupidité mondialisé et du capitalisme financiarisé. L’ennemi ce n’est pas le capitalisme ou la finance, c’est le "cupidalisme" qui implique l’absorption d’entreprises par des multinationales, qui n’ont que faire de l’intérêt des travailleurs du pays. Si on découvre, un jour, des habitants sur la Lune ou sur Mars, je suis certain que des usines seront délocalisées là-bas. Emmanuel Macron oublie totalement l’importance de la création d’emplois intérieurs. La deuxième raison de mon abstention est la réaction du candidat d’En Marche ! lors de l’annonce des résultats. En tant que citoyen, j’ai été profondément choqué par son discours triomphal, j’ai vu en face de moi à la télévision, un petit enfant qui se voyait déjà vainqueur. Cela m’a rappelé un mélange entre Sarkozy au Fouquet’s et le convoi de voitures de Chirac. Emmanuel Macron devait rester humble. Les Français, le peuple, en ont marre de cette arrogance, qui fait, en outre, le jeu du FN. Quand j’ai vu le candidat d'En Marche ! pavaner, je me suis formellement dit que je ne voterai pas pour lui. Je n'ai pas à culpabiliser
Le dernier facteur ayant influencé mon choix est la culpabilisation inacceptable qu’on a essayé de faire peser sur les épaules des mélenchonistes. En zappant sur les différentes chaînes, j’ai pu assister à un véritable concert de pleureuses, qui, après le discours de Jean-Luc Mélenchon, insinuaient qu’on voulait faire élire Marine Le Pen. Moi, je ne me sens pas coupable. Pour ces différentes raisons, j’ai donc fait le pari de l'abstention, qui me semble raisonnable. Macron sera élu car suffisamment de socialistes et de Républicains se sont rabattus derrière lui. L’enjeu est d’avoir un fort taux d’abstention, afin que les candidats soient conscients qu’une bonne partie de la population n’adhèrent pas à leurs idées. Le vote blanc, comptabilisé dans la participation, n’était ainsi pas une option. Mon espoir : l’absence de majorité pour le FN Je n’ai pas pris cette décision de gaieté de cœur, je l’ai toujours en travers de la tête, mais je vais garder mon abstention jusqu’au bout. Le front républicain a de fortes chances de marcher mais, imaginons le pire scénario, si Marine Le Pen est élue à cause de moi, je mettrais tout mon espoir sur le fait qu’elle n’aura pas de majorité à l’Assemblée nationale. Il est impossible qu’elle ait 288 députés sur 577, donc il y aura une cohabitation. Si je dois voter utile aux législatives, je n’hésiterais pas une seconde. Je donnerais même ma voix à un député des Républicains si je vois que celui de gauche n’a aucune chance de passer. En tout cas, j’apprécie que Jean-Luc Mélenchon laisse à ses militants la liberté de choisir en ne donnant pas de consigne de vote. Je trouve qu’il a fait preuve de courage, de responsabilité et j’adhère complètement à sa démarche de donner la parole aux gens qui l’ont désigné. Philippe Vallée Citoyen Article publié dans l'Obs: http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1667047-melenchoniste-j-ai-choisi-l-abstention-au-second-tour-une-decision-difficile-a-prendre.html Depuis deux mois, Kokopello (pseudonyme) a infiltré incognito les équipes militantes de cinq candidats à l’élection présidentielle : François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il n’a jamais milité ou été encarté. Son objectif : comprendre pourquoi on s’engage dans le militantisme. Environ six fois par semaine, il tracte, colle des affiches, participe à des réunions… Un passe-temps instructif, chronophage, légèrement schizophrène, qu’il croque en dessins. "Comment fonctionne la politique ?", "À quoi ressemble une campagne présidentielle ?", voici les questions que je me suis posées à la veille de cette année d’élections. Nous étions fin septembre 2016, la campagne commençait à se profiler et j’avais envie, à ma manière, d’en connaître les dessous. J’avais toujours été médusé de voir, les soirs de campagne, des centaines de militants pleurer toutes les larmes de leur corps quand leur candidat perdait, ou s’extasier quand il gagnait. Comment pouvait-on être autant touché par le sort d’un homme politique ? Mon aventure a débuté avec Montebourg Mon aventure a débuté dès la fin du mois de septembre avec l’équipe d’Arnaud Montebourg, pour les primaires de la gauche. Si je l’ai fait, c’est aussi parce que mes convictions penchaient plus à gauche et que je soutenais, sans grande conviction, le candidat. J’avais déjà cette idée de noter tout ce qui se passait autour de moi. Le tractage, les cafés-débats, un comité de campagne… Je découvrais l’emploi du temps d’un militant lambda. Je me souviens d’une fois où nous devions tous nous retrouver au QG de campagne d’Arnaud Montebourg sauf que le matin même, nous avions réalisé que personne n’avait les clés. Sans autre possibilité : on a squatté le café du coin. Tout le monde était au téléphone, il y avait un brouhaha incroyable, et à côté, en bruit de fond, un habitué du coin aviné qui n’arrêtait pas de nous dire que notre candidat était "merdique". La scène était totalement improbable. En vivant ce genre d’expériences un peu cocasses, je me suis dit qu’il fallait les partager en mettant à disposition du public des planches que j’ai moi-même dessinées et sur lesquelles je raconte toutes ces petites anecdotes. Fausses identités et look passe-partout Je me suis pris au jeu des primaires. Je commençais à bien connaître les autres militants, j’allais boire des verres avec eux, on sympathisait. Et puis, au bout de quelques semaines, j’ai commencé à y croire. Et si je participais à quelque chose d’important ? À l’annonce de la défaite d’Arnaud Montebourg, j’ai été déçu. Oui, j’étais triste. Triste surtout pour l’ensemble des militants qui avaient joué le jeu à 200%. Les gens pleuraient, et, pour la première fois de ma vie, je les comprenais. Une fois la déception passée, je me suis dit qu’il fallait que j’observe comment cela fonctionnait chez les autres candidats. À ce moment-là, je n’étais convaincu par aucun d’entre eux. Il faut savoir que pour chaque parti, je me suis créé de fausses identités, des comptes Facebook et Twitter inventés de toutes pièces, pour éviter de me faire griller. Je ne suis pas le seul à vouloir conserver mon anonymat. Ça peut paraître idiot, mais mon physique a aussi été un avantage. Je ne suis ni trop jeune, ni trop vieux. Je n’ai pas d’accent, j’ai un look passe-partout. Il m’est arrivé d’avoir peur qu’on me reconnaisse. C’est notamment le cas lors de grande mobilisation. J’essaye de cacher les tracts que je tiens au cas où et je ne porte aucun t-shirt à l’effigie des candidats pour toujours rester discret. Je n’ai été grillé qu’une seule fois, j’ai expliqué ma démarche et la personne a été compréhensive. Pas facile d’infiltrer les équipes de Fillon et Le Pen L’important pour intégrer une équipe de militants, c’est d’avoir les bons contacts, de montrer patte blanche. À partir du moment où vous êtes dans la "boucle mails", c’est bon. C’est un milieu essentiellement masculin. J’ai croisé peu de femmes. Infiltrer les équipes militantes du Front de Gauche et de En Marche a été relativement simple. Il m’a suffi de me connecter sur leurs sites internet, d’aller sur la carte de France affichant tous les comités, d’en sélectionner un, puis de cliquer "je rejoins". J’ai eu des réponses positives quasi-immédiates. Chez Benoît Hamon, ça a été un jeu d’enfant, car j’avais conservé quelques contacts de ma campagne pour Arnaud Montebourg et certains avaient changé leur fusil d’épaule. Pour François Fillon, la démarche a été quelque peu différente dans la mesure où j’ai essayé aussi de passer par leur site, mais je n’avais aucune réponse. Je suis donc passé par l’intermédiaire d’une collègue éloignée, contactée par le biais d’un réseau social. Mais le plus compliqué a certainement été d’intégrer l’équipe FN. J’ai envoyé des emails en passant par tous les sites possibles, mais, là aussi, je n’ai pas eu de réponse. Et finalement, j’ai réussi via Facebook. Il faut être totalement schizophrène pour faire ça Être militant, ça consiste à faire plusieurs actions. Elles se déroulent soit très tôt le matin entre 8 et 10 heures, soit le soir à partir de 18 heures. J’en fais cinq à six par semaine. En règle générale, je suis informé par le biais d’e-mails, voire de discussions Whatsapp ou Telegram. Dans ce fil de discussion, les militants partagent aussi des sondages – toujours favorables à leur candidat – et ne se gênent pas pour critiquer les interventions des uns et des autres. Je suis dans la vie active, et je peux vous dire que c’est très chronophage, mais pas impossible. J’arrive donc à jongler sans trop de soucis entre deux actions. Il m’est arrivé de tracter pour Mélenchon le matin, et Fillon le soir. Mes planches, je les dessine essentiellement la nuit, car c’est le seul créneau libre de mes journées. C’est certain qu’il faut être totalement schizophrène pour faire ça. "Je vous invite à aller consulter son site" Pour éviter tout risque, j’ai choisi d’intégrer des secteurs plutôt éloignés et je participe à des actions seulement quand je sais que je ne ferai pas de faire de malencontreuses rencontres. Parmi les actions, il y a le tractage dans la rue. On se donne un rendez-vous dans des lieux stratégiques (à la sortie des métros, sur les marchés), en tenant compte aussi des arrondissements. Chaque équipe marque son territoire. Les militants ont bien conscience que ce n’est pas toujours très prolifique, mais c’est un moyen de montrer qu’ils sont présents. Il y a aussi la participation aux comités de campagne. On discute de la situation politique, on parle de nos craintes, on planifie les actions à venir et on pose pas mal de questions sur le programme, notamment chez Macron. Certains militants s’interrogent aussi sur les réponses qu’ils doivent fournir lors de certaines situations. Par exemple, des passants lui reprochent de ne pas avoir un programme clair. On doit leur répondre : "Si, je vous invite à aller consulter son site". Passer d’un comité à un autre demande une certaine gymnastique, mais j’ai trouvé la parade : reprendre les grandes idées véhiculées dans les médias et ne jamais aller en profondeur. Et puis, il y a aussi les cafés-débats où l’idée est aussi de faire venir de nouvelles personnes. Ce qui est génial, c’est que dans tous les comités, tous partis confondus, on me dit : "Si tu as une idée, n’hésites pas à la faire partager, elle remontera et pourra peut-être être réutilisée. Tu sais, on est le seul parti à fonctionner ainsi." C’est faux ! Ils disent la même chose. An revanche, voici quelques spécificités de chaque équipe militante. 1. Jean-Luc Mélenchon : un joyeux bordel participatif C’est le seul parti où il y a une vraie application du participatif. Vous pouvez être nouveau et avoir des tâches importantes à réaliser. Chacun apporte sa pièce à l’édifice. Par exemple, pour le meeting avec un hologramme, j’ai pu sans la moindre difficulté être intégré comme "bénévole organisateur". Par contre, le mode de fonctionnement manque de coordination. Il m’est arrivé de participer à un collage d’affiches dans un coin de Paris – ce sont les plus actifs au niveau du collage –, de retrouver des militants et de réaliser une fois sur place qu’une autre équipe était passée la veille sans que personne ne soit informé. Ambiance pré-élection : revigorés par les sondages, les militants croient aussi aux « votes cachés » liés à la popularité sur les réseaux sociaux du candidat. 2. Benoît Hamon : victoire des primaires, puis déception Au début, les militants étaient mobilisés. Grâce à la primaire de la gauche, Benoît Hamon avait été élu comme le représentant de son parti : il était celui vers lequel tous les socialistes devaient se tourner. Le souci, c’est qu’aujourd’hui − entre les sondages et les trahisons −, certains militants n’y croient plus et quelques-uns envisagent de rejoindre les rangs de Mélenchon. La semaine dernière, lors d’un tractage, une passante a accepté de prendre mon papier, elle m’a regardé dans les yeux, puis m’a dit : "Vous savez, je vote à droite mais je vous le prends quand même. Courage !". Beaucoup me disent : "C’est le seul que je voyais président, mais là, c’est foutu". 3. Emmanuel Macron : un melting-pot, mais un programme flou Là-bas, j’ai croisé quelques anciens de l’UDI, du Modem et beaucoup de déçus du Parti socialiste. L’avantage, c’est qu’ils connaissent un peu les rouages de la politique. À chaque email, il y en a toujours un pour dire : "Ah, c’est bien plus joli que ce qu’on faisait." C’est un vrai melting-pot et beaucoup d’idées fusent. Là où ça pêche, c’est le programme. J’avoue qu’il a été très compliqué pour les militants de commencer le tractage alors que nous ne savions rien du programme. À chaque fois, il fallait faire une pirouette et c’est toujours le cas. Si un passant nous dit qu’Emmanuel Macron est de droite, on lui répond qu’il est aussi de gauche, et vice-versa. On joue systématiquement sur cette ambiguïté. Ambiance pré-élection : les militants croient que leur candidat passera au second tour. 4. François Fillon : envers et contre tous La loyauté et l’honneur jusqu’au bout, voici ce qui pousse les militants à soutenir François Fillon. Ce n’est pas qu’une question de parti. Malgré ses nombreuses affaires, le candidat pourrait dire une énormité ou faire un nouveau faux-pas, ses militants lui resteront fidèles jusqu’au bout. Le défaitisme n’existe pas. D’ailleurs, ce n’est pas un sujet qu’on aborde lors des réunions. Après, je peux vous dire que certains politiques du parti Les Républicains ont souhaité mettre Fillon hors course. Le problème, c’est que les militants ne l’envisageaient absolument pas. Beaucoup de personnes du parti regrettent amèrement la primaire et ont le sentiment de s’être faits piéger.
Ambiance pré-élection : malgré les casseroles, les militants sont loyaux et iront jusqu’au bout. 5. Marine Le Pen : se préparer à la riposte sans assumer C’est certainement la mission d’infiltration qui a été la plus difficile. Le Front national a cette particularité d’avoir un seul comité départemental à Paris, et il est extrêmement cloisonné. Quand j’ai franchi le local avec des vitres peintes en blanc, j’ai eu vraiment peur. Au final, les militants ont été plutôt accueillants. Lors des réunions, on parle très peu de l’actualité, mais on nous forme beaucoup ! Cours de media-training, connaître les faiblesses de chaque candidat… nous sommes préparés à la riposte. Il y a souvent des équipes de journalistes qui viennent filmer ces rencontres. À chaque fois, l’assemblée se scinde en deux car certaines personnes souhaitent conserver leur anonymat. Contrairement à ce que le FN laisse croire, les militants n’assument pas toujours leur position politique. Ambiance pré-élection : les militants croient qu’elle peut être présidente. J’ai appris la bienveillance En deux mois d’immersion, j’ai développé une certaine bienveillance à l’égard de tous ces militants et acquis une vraie ouverture d’esprit. Aujourd’hui, quand je me retrouve face à des personnes qui ont des convictions politiques diamétralement différentes des miennes, je suis ouvert à la discussion. Mon but, ce n’est absolument pas de critiquer les militants, car je respecte le fait qu’ils croient en leurs idées. Non, la politique n’est pas l’univers pourri de l’intérieur que l’on pourrait s’imaginer. Pour le moment, je suis comme une grande partie des Français, je suis toujours dans le doute, mais il faut dire que j’essaye de ne pas me poser la question pour éviter de perdre de vue ma mission. J’ai envisagé d’aller voir un peu ce qui se passait auprès des petits candidats, mais je n’ai malheureusement pas le temps. Ma démarche se terminera au second tour des élections présidentielles et j’espère sincèrement que je pourrais arriver au bout. Je sais qu’un jour ma couverture sera révélée, mais je ne crains pas les représailles. Tout ce qui m’inquiète, c’est de décevoir tous ces militants avec qui j’ai sympathisé et qui m’ont fait confiance. J’espère qu’ils comprendront. Témoignage D'un Militant LR "Avec Fillon j'ai trop avalé de couleuvres, les élus doivent le lâcher"3/2/2017 Chères élues, chers élus,
Pourquoi encore se faire interpeller par un militant ? Peut-être parce que les militants côtoient le terrain à travers les distributions de tracts sur les marchés, les portes-à-portes, les phoning etc. Peut-être parce que les militants qui tractent pour les Républicains en ont assez d'entendre "Escrocs ! Rendez moi mes 4 euros !" à chaque fois qu'ils tendent un tract du parti. Laissez-moi juste avant propos, me (re)présenter. Je suis adhérent à l'UMP, puis chez les Républicains depuis 2012. Je suis actuellement membre du comité départemental les Républicains en Seine-Maritime, conseiller national et ancien délégué de circonscription. Comme beaucoup de Français, je me suis engagé lors de la primaire ouverte de la droite et du centre auprès d'une équipe de campagne, puis à présider un bureau de vote. J'ai donc rejoint l'équipe de Nathalie Kosciusko-Morizet au premier tour, convaincu par ses idées nouvelles et rafraîchissantes pour la droite, convaincu que le libéralisme devait avoir une place non plus seulement sur les questions économiques, mais aussi sur les questions de société. Après NKM, j'ai rallié Juppé au second tour de la primaire Je peux assurer que l'ambiance de cette équipe était remarquable, et encore aujourd'hui, merci à tous les militants, jeunes et moins jeunes, avec qui j'ai passé une campagne fabuleuse. Le soir du premier tour, j'avoue avoir été satisfait de voir NKM se hisser à la quatrième place du podium : nos idées ont porté leur fruit, et le courant que nous portons à droite ne peut désormais plus être ignoré. J'ai décidé, tout comme NKM et bon nombre de militants de l'équipe, de soutenir Alain Juppé au second tour de la primaire. Convergence dans les idées, programme réaliste et mesuré : je n'ai eu aucun de mal à faire campagne pour Alain Juppé sur les réseaux sociaux, ni même aucun mal à rencontrer une partie de son équipe lors du débat du second tour qui l'opposait à Juppé. La déception fut immense, mais le risque de la primaire était également celui-là : perdre. François Fillon a gagné. Un choix s'offrait alors à moi : quitter le parti, ne me reconnaissant pas dans le projet société de François Fillon, soit rester et respecter ce que j'avais alors sermonné aux militants de ma circonscription : se ranger derrière le vainqueur. J'ai choisi la deuxième voie. La droite la plus bête du monde Je l'avoue, cela m'a obligé à avaler pas mal de couleuvres. Pourquoi ? Parce que François Fillon n'incarnait pas "ma" droite : la droite libérale, progressiste, moderne (oui, qu'on le veuille où non, Alain Juppé par son progressisme est plus moderne que François Fillon). Quelques mois après, alors que la droite disposait d'un boulevard devant elle, éclate l'affaire Fillon. L'homme qu'on disait irréprochable, avait fauté. La mise en examen lui pendait au bout du nez. "Qui imagine un seul instant le Général De Gaulle mis en examen ?", (Sablé sur Sarthe, août 2016) ; "Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen !" (TF1 26 janvier). Apparemment, Fillon imagine bien le Général mis en examen. François Fillon l'a encore confirmé hier : il ne se retirera pas, malgré une convocation par les juges d'instruction "aux fins de mise en examen". Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans crainte que nous avons la droite la plus bête du monde. Une droite qui avait un boulevard devant elle, qui avait l'Elysée servi sur un plateau, une majorité absolue quasiment assurée, et qui se retrouve aujourd'hui en troisième position dans les sondages parce qu'au lieu d'avancer dans l'intérêt de la France, mais aussi dans l'intérêt du parti, un homme préfère avancer dans son intérêt personnel, quitte à tuer de nouveau le parti comme il l'a fait en 2012 lors de la "guerre des chefs" avec Jean-François Copé. Alors aujourd'hui, chères élus et chers élus, si vous voulez regagner la confiance des Françaises et des Français, et même, encore plus facilement dirais-je, la confiance du peuple de droite, il n'y a qu'une seule chose à faire : quittez le navire ! Quittez François Fillon et que le parti investisse un autre candidat pour la droite. Nous ne gagnerons pas la présidence avec François Fillon. Nous ne gagnerons pas après tant de renoncements dès le départ. Suivez l'exemple de Bruno Le Maire, Pierre Lellouche, Franck Riester, Laure de la Raudière et quittez l'équipe. Parce que François Fillon se contredit déjà avant même d'être élu, parce que nos valeurs valent plus qu'un poste, parce que l'intérêt de la France vaut plus qu'un homme. Et si tel est le cas, si rien n'est fait, alors les valeurs portées par la droite pendant cette élection présidentielle ne sont plus les miennes. Par Kévin Duvivier Militant LR, juriste Affaire Mehdi Meklat : « Des propos orduriers qui peuvent provoquer des dégâts politiques »2/23/2017 Chouchou médiatique:
Du Bondy Blog à France Inter, plusieurs médias qui ont encouragé et promu l'auteur de tweets haineux se sont désolidarisés, tout en trouvant parfois des excuses au jeune journaliste. L'affaire Mehdi Meklat est d'abord une affaire médiatique. Le jeune homme, qui posait en une des Inrockuptibles avec Christiane Taubira était un tweetos compulsif, enchaînant des messages de haines injustifiables sur le célèbre réseau social. Il avait fait ses classes au Bondy Blog, le site créé après les émeutes de 2005 pour donner la parole aux banlieues, puis avait sévi avec son ami Badrou chez Pascale Clark sur France Inter, avant de travailler occasionnellement pour Arte et Libération. «Mehdi n'est pas un petit énervé isolé. Le Bondy Blog, Inter, Arte, Le Seuil… il a dégainé tour à tour de prestigieuses cartes de visite au sein desquelles la virulence de ses délires sème l'effroi et sur lesquelles elle jette le doute, et ce dans une période où on s'empresse de discréditer systématiquement la presse. (…) Les médias qui l'ont employé auraient dû se montrer bien plus vigilants» estimait mercredi matin, Sonia Devillers sur France Inter. Les médias qui l'ont promu et employé se sont retrouvés assez gênés par ces révélations. A commencer par le Bondy Blog, où Meklat a signé plus de 200 articles, qui a été l'un des premiers à réagir dimanche dans un communiqué se désolidarisant de «tweets qui n'engagent en aucun cas la responsabilité de la rédaction». «Puisqu'il y a des évidences qu'il faut affirmer, le Bondy Blog ne peut cautionner des propos antisémites, sexistes, homophobes, racistes ou tout autres propos discriminatoires et stigmatisant, même sur le ton de l'humour.» Pascale Clark, qui avait mis le pied à l'étrier de Mehdi sur France Inter, a elle, continué à le défendre sur Twitter: «A l'antenne, Medhi Meklat ne fut que poésie, intelligence et humanité», dit-elle. Les Inrocks, qui ont mis deux fois Meklat en Une, la dernière il y a trois semaines avec Christiane Taubira, s'en sortent avec un éditorial embarrassé de Pierre Siankowski, directeur de la rédaction. Il explique avoir connu Mehdi et Badrou à Cannes en 2012, sans avoir eu connaissance des messages haineux sur Twitter. «Ces tweets sont abominables, abjects, et certains pris comme tels sont tout simplement antisémites, racistes et homophobes. Rien à dire là-dessus. C'est extrêmement grave et choquant et on ne peut que condamner ces «S'il s'agissait d'un identitaire, d'un militant Front national, aurais-je tant de scrupule? L'argument porte.» Claude Askolovitch propos.» Mais, ajoute-t-il: «Les Inrockuptibles ont encore moins à s'excuser, a posteriori, d'avoir publié des textes ou des propos de Mehdi Meklat antérieurs à la polémique qui entoure ses tweets. Relisez attentivement ces textes, ils sont tout simplement l'inverse de ce qui a été retrouvé sur son Twitter. Ce sont des textes beaux et puissants». Le journaliste Claude Askolovitch, qui prend très régulièrement la défense des musulmans, s'est lancé dans une longue explication embrouillée dans Slate: «S'il s'agissait d'un identitaire, d'un militant Front national, aurais-je tant de scrupules? L'argument porte.», admet le journaliste. L'inexcusable Il y a quelques mois, j'ai décidé d'être définitivement “Mehdi Meklat” sur Twitter. D'être moi. J'ai tué Marcelin Deschamps, ce personnage que j'exècre. " Autrement dit, Mehdi Meklat se transforma en une créature maléfique qu'il a baptisée Marcelin Deschamps mais qu'il a fini par ne plus supporter. Etrange ressemblance avec le héros du célèbre roman de Robert Louis Stevenson, L'Etrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde. Hyde tue Jekyll (est-ce peut-être l'inverse ?). Mais cela reste un roman. Une œuvre esthétique donnant prise à l'interprétation psychanalytique. Nous ne sommes plus du tout dans la même configuration avec Mehdi Meklat, qui a déversé sur Twitter, sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps, pendant des années, des propos violemment racistes, antisémites, sexistes et homophobes. Il est dans le monde social (et les réseaux sociaux en font partie). Il nous dit : " Ces outrances n'ont rien à voir avec moi. " C'est trop facile. Bien entendu, et cela ne doit faire l'ombre d'aucun doute, ces propos ont à voir avec leur producteur, même lorsque celui-ci se cache sous un pseudonyme. Ce qui a été publié sur les réseaux sociaux par " Marcelin Deschamps " n'exonère en rien Mehdi Meklat des responsabilités qu'il a prises en toute connaissance de cause. Ne se dit-il pas " journaliste " ? Sa responsabilité morale est indéniable et absolue. Il a agi librement et il a été lui-même la cause de ses actions, en particulier en proférant ses très nombreuses insultes sordides visant explicitement des populations définies par leurs caractères physiques et biographiques supposés immuables (confession, orientation sexuelle, genre, etc.).attentat sans victime Après tout, nous aurions parfaitement pu concevoir une irresponsabilité de l'action de ce " journaliste " si ses actions envers la société n'avaient affecté personne d'autre que lui-même. Mais ce n'est pas le cas puisqu'ils ont été très nombreux à avoir fait part de leur indignation, horrifiés que de tels propos puissent avoir cours pendant si longtemps sans réaction de journalistes, des pouvoirs publics et de la justice. Comme s'il suffisait de dire que, " à travers Marcelin Deschamps, je questionnais la notion d'excès et de provocation " pour se faire excuser de mener une telle expérimentation. L'" excès " et la " provocation " n'ont nullement besoin d'être " questionnés " à l'aide de cette procédure. D'ailleurs, ces deux manières d'être, qui en réalité n'en font qu'une, ont, sur la Toile et quelques médias papier, un espace illimité pour se déployer quasiment sans frein d'aucune sorte. Quels sont les impératifs pédagogiques qui nécessiteraient d'y apporter ce type de contribution nauséabonde ? Ce à quoi n'a pas réfléchi l'auteur (réel et fictif), c'est que son acte inlassablement répété pendant trop longtemps n'a pas seulement offensé nominativement des personnes et des groupes (" Faites entrer Hitler pour tuer les juifs ", " Vive les PD vive le sida avec Hollande ", " Je crache des glaires sur la seule gueule de Charb et tous ceux de Charlie Hebdo ", etc.), il a aussi porté préjudice à des individus particuliers. L'offense est un attentat sans victime car on ne peut identifier celle-ci sous la forme concrète d'un corps et d'un nom (on peut offenser Dieu mais en aucun cas celui-ci ne peut être une victime). En revanche, nous sommes bien, dans le cas de Mehdi Meklat, alias Marcelin Deschamps, dans l'ordre du préjudicequand les discours de haine sont indissociablement des appels à la persécution, à la mort et à l'exclusion violente de la communauté nationale, voire tout simplement le refus explicite pour certains d'appartenir à une commune humanité.adeptes de la " théorie du complot " Il faut le rappeler, encore et toujours, la liberté d'expression n'empêche nullement la commission de préjudices qui peuvent être sanctionnés par le droit. Et cela est si vrai qu'il existe des lois nationales et internationales (que l'on soit favorable ou non à la loi en ce domaine) qui précisent que " la liberté d'expression ne peut être utilisée pour promouvoir le non-respect des droits de l'homme ". Les médias électroniques ne doivent pas échapper à cette contrainte à la fois morale et juridique. Mehdi Meklat n'est pas sans savoir, en tant que " journaliste " familier des réseaux sociaux, que son propos n'a rien de confidentiel. Bien plus, la répétition a banalisé l'injure, le discrédit et la haine des uns pour les autres ; elle a, c'est la nature même d'Internet, multiplié à l'infini, en un clic, le message, c'est-à-dire, au sens strict, le geste consistant à livrer le " contenu d'une communication faite à quelqu'un ". Il n'est pas difficile d'imaginer qui est ce " quelqu'un " : ce sont ces centaines de milliers de personnes plus ou moins intellectuellement fragiles, peu assurées dans leur discrimination entre la rumeur, la fausse information et la vérité empiriquement fondée et vérifiée. C'est aussi sans compter sur cette armée de croyants adeptes de la " théorie du complot " qui, obsessionnellement, sont à la recherche des " vérités partagées ", quand ces essentialismes anthropologiques ne sont pas, pour eux, les " preuves " qui restaient enfouies dans leur inconscient ; celui-ci étant infiniment plus puissant et plus résistant que des préjugés. Aucune preuve rationnelle n'est à même de les convaincre de quoi que ce soit. Parmi ces publics " captifs " se trouvent de nombreux collégiens, lycéens et étudiants. Il n'y a donc aucune difficulté à imaginer les dégâts politiques que peuvent produire ces propos orduriers vidés à longueur de journée sur des réseaux sociaux faisant office d'espace de production de la vérité ultime. Avec cette extraordinaire garantie : voir sans être vu ; être manifeste en restant secret. Le risque, qui n'est plus théorique aujourd'hui, est le suivant : celui de prendre les mots pour les choses ; à considérer comme réelles des choses qui n'existent pas. Et quand cette folie s'installe, les mots, au lieu de nouer des liens entre les personnes et les groupes, marquent une déchirure profonde et pour longtemps du lien social. Qu'on ne s'y trompe pas. Les discours sur les réseaux sociaux ne sont pas des phénomènes extérieurs au monde social. Les discours racistes, antisémites, sexistes, islamophobes et homophobes ne portent pas sur la réalité. Ils en font partie. Smaïn Laacher Le fondateur d'En Marche pourrait subir le même sort que Jean-Pierre Chevènement, candidat à la présidentielle de 2002.
Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, crée un réel engouement autour de sa candidature. Près de 15.000 personnes seraient venus l'applaudir en décembre au Parc des Expositions de Paris pour son premier grand meeting. Selon plusieurs sondages d'opinion, il se rapproche d'une qualification au second tour. Pourtant, le fondateur d'En Marche, ancien ministre de l'Economie de Manuel Valls, semble suivre, 15 ans plus tard, une trajectoire qui rappelle celle de... Jean-Pierre Chevènement. L'actuel président de la Fondation pour l'islam de France était, en 2002, candidat à l'élection présidentielle. Un corpus idéologique ambigu À force de ralliements de personnalités de gauche et de centre droit, le mouvement En Marche se positionne de fait comme n’étant ni à droite ni à gauche. Même si son socle idéologique est encore en construction, on peut percevoir une tentative d’emprunter certaines postures, tantôt à la droite, tantôt à la gauche. Ce faisant, le mouvement fondé par Emmanuel Macron suit la même voie que celui créé par Jean-Pierre Chevènement : le Mouvement des Citoyens, devenu au fil des ralliements Pôle républicain pour l’élection présidentielle de 2002. Alors que la posture de Jean-Pierre Chevènement, résolument ancrée dans l’héritage de la IIIe République, et fondée sur la souveraineté nationale et l’autorité de l’État, attirait des souverainistes de droite comme de gauche, celle d’Emmanuel Macron semble encore ne porter que sur une personnalité et une espérance liées à son caractère juvénile. Jean-Pierre Chevènement était parvenu à attirer à lui aussi bien Lucie Aubrac, symbole de la Résistance, que de la famille de Pierre Poujade. L’équipe de campagne du fondateur du Mouvement des Citoyens s’est alors trouvée embarrassée de ce dernier ralliement encombrant. En surfant sur cette vague du ni gauche ni droite, Emmanuel Macron s’expose, dans les mois qui précèdent l’élection présidentielle, au risque de devoir assumer et concilier des ralliements aussi contre nature qu’inattendus. On peut imaginer que certains anciens du groupe Occident, en quête de renouvellement, rejoignent ses rangs, se trouvant à cohabiter avec les gaullistes de gauche et de droite qui auraient décidé de le soutenir également. Le premier danger encouru par la candidature d’Emmanuel Macron est que son positionnement, au lieu d’apparaître comme un signe d’unité nationale et de rassemblement, ne donne une impression d’ambiguïté et de manque de clarté. Les institutions de la Ve République poussant au bipartisme, nonobstant la place croissante occupée par le Front National, permet difficilement l’émergence d’une force transpartisane. Faiblesse du réseau d’élus La deuxième faiblesse de la candidature d’Emmanuel Macron, tout comme celle de Jean-Pierre Chevènement en 2002, tient à la minceur du réseau d’élus le soutenant. Alors que le fondateur du Mouvement des Citoyens pouvait déjà compter sur un groupe d’élus de son parti, tant au Parlement que dans les collectivités locales, tenant notamment la mairie du XIe arrondissement de Paris, le mouvement d’Emmanuel Macron est encore trop jeune pour pouvoir compter sur son propre réseau. Il ne peut donc qu’espérer que certains élus en place migrent d’un parti pour rejoindre le sien, à l’instar de Gérard Collomb, maire de Lyon. Ceci présente donc deux obstacles majeurs susceptibles de freiner l’élan du candidat Macron à la présidentielle. Tout d’abord, faute d’élus en place, il peut difficilement compter sur des relais suffisants en régions pour porter son message. Des élus locaux, à l’occasion de leurs voeux, dans les publications qu’ils animent, ou encore dans la presse régionale, lorsqu’ils prennent la parole, portent la parole de leur champion. Alors même que le MDC de Jean-Pierre Chevènement comptait des élus locaux, ceux-ci n’étaient pas en nombre suffisant pour que la parole de leur candidat se diffuse partout. Pour Emmanuel Macron, dont le mouvement En Marche a fondé en avril 2016, c’est encore plus criant. Le deuxième frein à l’élan d’Emmanuel Macron tient dans le caractère complètement imprévisible des ralliements explicites et migrations d’élus vers son mouvement. Certains, suffisamment bien établis sous leur propre nom, peuvent le soutenir sans aucune réserve, comme Gérard Collomb, tandis que d’autres se montrent hésitants ou bien le soutiennent encore du bout des lèvres. Bien que l’étiquette du PS ne soit pas un gage de succès aux législatives, nombre de parlementaires socialistes auront besoin du financement de leur parti pour leur campagne en circonscription. Faute de compter sur des élus, En Marche ! ne peut même pas garantir à ceux qui l’auront rallié de pouvoir les aider à remporter les législatives. Ceci peut donc suffire à ce que les soutiens ne soient en fin de compte plus velléitaires que réels. Un parti de CSP+ et d'intellectuels Enfin, tout comme la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002, celle d’Emmanuel Macron souffre d’un cruel paradoxe. Les sondages révèlent un réel engouement pour son approche intellectuelle des enjeux et sa capacité à les resituer dans un contexte plus général et identifier toutes leurs ramifications. Alors que les autres candidats de droite comme de gauche mettent en avant en guise de programme des mesures d’ordre technique et souvent déconnectées les unes des autres, il propose une vision de la société. Dans le même temps, il lui est reproché de ne pas entrer dans le coeur des problèmes et le vif du sujet en ne fournissant pas de détail quant à la manière de faire. Il ressort de ce paradoxe qu’Emmanuel Macron, tout comme son mentor en politique, attire tout particulièrement les catégories socioculturelles et socioprofessionnelles les plus élevées. Un bref examen de la composition de quelques fédérations rurales du mouvement En Marche met en lumière que les membres qui le rejoignent ont un niveau d’éducation élevé, un emploi stable de cadres du public ou du privé ou exercent une profession libérale. En revanche, les classes populaires sont très peu représentées, alors même qu’elles sont plus nombreuses dans la société que les classes moyennes supérieures. Après l’obtention de 5,33% à la présidentielle de 2002, l’équipe de campagne de Jean-Pierre Chevènement, en faisant son aggiornamento, déplorait que le Pôle républicain ait été un mouvement d’intellectuels sans réelles troupes issues du corps social. Emmanuel Macron peut-il conjurer le sort ? Compte tenu de la structure du mouvement qu’il a créé et nonobstant l’enthousiasme qu’il suscite aujourd’hui, Emmanuel Macron est électoralement très fragile, même s’il est crédité de sondages aussi encourageants que Jean-Pierre Chevènement en 2002. Le danger est donc que ces sondages, comme pour le candidat du Pôle républicain, ne se transforment pas dans les urnes. Pour l’élection présidentielle de cette année, Emmanuel Macron ne peut espérer remporter les suffrages annoncés par les instituts de sondage qu’à trois conditions. Tout d’abord, pour parvenir à susciter des ralliements d’élus de droite comme de gauche, il lui faut être en mesure de leur garantir un financement suffisant pour les législatives. Celles-ci coûtant de 3.000 euros à 50.000 euros selon les candidats et en moyenne constatée 15.000 euros, il faudrait que le candidat à la présidentielle parvienne à lever environ 9 millions d’euros pour les législatives. En second lieu, il convient que le candidat parvienne à attirer à lui ces fameuses classes populaires qui, soit ont déserté la politique, soit se sont jetées dans les bras de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Cela implique un travail d’investissement du terrain que ses troupes actuelles ne sont pas encore capables de généraliser. Il sera impératif qu’il parvienne à attirer à lui une ou deux égéries des classes populaires dans lesquelles celles-ci pourraient se reconnaître. Enfin, le sort pourra véritablement être conjuré à condition que l a primaire de la Belle Alliance Populaire se solde par un échec, laissant un Parti socialiste en miettes. Cela implique alors que le nombre de participants à cette primaire soit très en deçà des attentes (moins d’un million et demi de votants). Il faudrait également que le résultat de cette primaire soit suffisamment serré pour être remis en question par le candidat de second tour qui l’aura perdue. Voire, si un perdant de cette primaire ne se plie pas à son issue et décide de se présenter malgré tout à la présidentielle, le Parti Socialiste se verra encore plus divisé et fracturé. Vassili Joannides de Lautour est professeur à Grenoble École de Management et Queensland University of Technology, publié initialement dans le cercle des Echos « Renaissance », « renouveau », « retour en force ». Qu’importe le qualificatif donné à cette année 2016 pour l’Iran marquée par de grandes avancées. Sur le plan régional, le pays a conclu un accord avec les pays de l’OPEP, le 1er décembre dernier, lui permettant d’augmenter sa production de pétrole au détriment de l’Arabie Saoudite. Sur le plan international, la plupart des sanctions qui pesaient sur ce pays ont été levées à l’issue de l’accord de Vienne du 14 juillet 2015. L’Iran d’Hassan Rohani est ambitieuse et se veut être non seulement la puissance dominante du Moyen Orient mais aussi incontournable au sein des relations économiques et géopolitiques internationales. Cependant, les années d’isolement ont lancé des traces dans la société iranienne et certains événements politiques extérieurs pourraient chambouler la donne: analysons la situation passée et présente pour tenter de déterminer le futur de l’Iran. Le gouvernement iranien a conclu un accord sur le nucléaire civil mettant fin à un embargo économique et diplomatique contraignant pour la société iranienne. L’élection d’Hassan Rohani a marqué une rupture nette avec la présidence d’Ahmadinejad par une volonté de ce dernier de réformer le pays en profondeur pour qu’il rayonne de nouveau sur le plan régional et international. DES TENSIONS POLITIQUES RESPONSABLES DE SON ISOLEMENT SUR LE PLAN INTERNATIONAL La révolution islamique de 1979 a marqué un véritable retour en arrière et un coup d’arrêt au souhait du Shah d’Iran de moderniser le pays en lui dotant des principes démocratiques proche des valeurs occidentales. L’ayatollah Khomeini, à l’issue de son coup d’Etat, instaure une république islamiste autoritaire, antiaméricain car ce sont les Etats-Unis qui avaient placé au pouvoir le Shah mais également anti-sioniste, donc en tension avec Israel. Cette révolution a par conséquent conduit à la rupture des relations diplomatiques de 1980 à 2009 avec les Etats-Unis suite à l’épisode de la prise d’otage de l’ambassade de Téhéran. Face à cette isolement diplomatique et régional dont l’Arabie Saoudite, l’autre puissance du Moyen-Orient, sort incontestablement gagnante en s’alliant avec les Etats-Unis, l’Iran développe l’idée de se doter de l’arme nucléaire même si elle affirme que son programme a des finalités seulement civiles. Le TNP — Traité de non prolifération des armes nucléaires — pourrait alors faire l’objet d’une violation de la part de l’Iran qui a signé le traité en 1970 ; ce qui provoque l’inquiétude, au début des années 2000, de la communauté internationale et notamment des Etats-Unis et d’Israël. Cette inquiétude a abouti à l’adoption de sanctions économiques à l’égard de l’Iran pour bloquer les possibles investissements dans ce domaine, ce qui a considérablement ralenti l’économie iranienne et son influence, estimant le coût des sanctions à plusieurs centaines de millards de dollars de manque à gagner. Une décennie passée, les accords de Vienne reflètent cette volonté de l’Iran de tenir ses engagements et de coopérer. En contrepartie de ces promesses de transparence dans le cadre des contrôles de l’AIEA — l’Agence Internationale de l’Energie Atomique —, l’embargo américain et européen dans les domaines de la finance, de l’énergie et du transport devrait s’interrompre progressivement. Cet accord historique était fortement sollicité par la société civile iranienne, fortement touchée par les embargos. Le potentiel de l’Iran est énorme et ce pays a la voie libre pour pouvoir s’imposer dans le concert des nations. L’IRAN DISPOSE DE TOUS LES CRITERES D’UNE GRANDE PUISSANCE FUTURE La normalisation des relations diplomatiques marque le retour de l’Iran sur la scène internationale et régionale en tant que carrefour géostratégique et culturel. Faisons le point sur les atouts dont dispose l’Iran pour s’imposer en tant que grande puissance : · Une situation géographique déterminante avec : o Un territoire qui se situe entre les mondes caucasien, turc, indien et arabe ; o Une situation maritime favorable en vertu des mers qui le borde. · Un territoire de 1,6 million de km2. · Une population de 82 millions d’habitant - soit trois fois celle de l’Arabie Saoudite. · Un sous sol très riche avec des ressources considérables : o en gaz puisqu’il tient le premier rang avec presque 20% des reserves mondiales ; o en pétrole : quatrième en terme de gisement avec presque 10% des réserves ; o en ressources minérales : 7% des reserves mondiales. · Le régime politique est relativement stable même si la culture et la liberté de la presse reste encore soumises à la censure ; · Une culture riche et l’épicentre du mouvement chiites dans le monde en concentrant 90% des fidèles ; · Une population avec un niveau d’éducation très élevée notamment sur le plan scientifique et une classe moyenne importante ; · Une force militaire puissante ayant une influence déterminante dans la région notamment dans le conflit syrien. Il paraît alors évident que le potentiel de l’Iran fait de lui une possible et incontournable puissance future. Cependant, il est impératif pour elle de régler les blocages auxquels elle est confrontée sur le plan interne, propre au fonctionnement de la société iranienne, et externe dans ses relations régionales et internationales. DES REFORMES STRUCTURELLES URGENTES SUR LE PLAN INTERNE POUR ASSURER UN RETOUR DURABLE La réintégration progressive de l’Iran sur la scène internationale implique nécessairement que des réformes ambitieuses non seulement juridiques mais également économiques, monétaires et bancaires soient entreprises : les défis d’Hassan Rohani sont donc primordiaux et multiples. En effet, la levée des sanctions bilatérales et multilatérales n’a pas pour le moment suscité le boom économique espéré. En dépit du fait que l’Iran soit courtisé pour ses réserves en hydrocarbures et que sa production ait retrouvé son niveau d’avant les sanctions, l’absence d’infrastructures modernes constitue un lourd handicap pour le pays, notamment dans l’exploitation du gaz, bien qu’elle dispose des plus grosses réserves mondiales. Des réformes structurelles de grande ampleur doivent être entreprises pour favoriser son entrée sur le marché mondial et attirer les investisseurs afin de diversifier l’économie pour l’instant très dépendante des exportations d’hydrocarbures, diminuer le chômage massif et l’économie informelle. Pour cela, il s’agit de créer un environnement économique et juridique stable car une grande partie de l’économie est sous le contrôle de l’Etat, il s’agit là de privatiser et libéraliser l’économie en baissant les taxes, en développant le secteur privé encore entre les mains de grandes familles et encourager l’innovation. De plus, il est impératif d’améliorer la compétitivité des taux de change et renforcer le sytème bancaire des taux d’emprunt nationaux qui ne sont, pour le moment, pas du tout avantageux et enfin maitriser l’inflation. Autre sujet important, le pays doit également repenser sa politique environnementale. Actuellement, l’Iran connaît une crise écologique importante marquée en raison d’une mauvaise gestion du secteur agricole causant un épuisement des nappes phréatiques et une pollution massive du fleuve Karoun qui est le seul fleuve navigable du pays. A l’image de la politique des grands travaux de Roosevelt dans les années 30 pour relancer l’économie américaine en crise, Rohani est convaincu que l’Iran peut se redresser et devenir un pôle d’influence majeur dans les décennies à venir indépendamment de l’avantage énergétique dont elle dispose. Rohani souhaite, comme les Emirats Arabes Unis l’ont fait avant lui avec les villes de Dubaï et d’Abu-Dhabi, investir massivement dans le tourisme en espérant devenir la nouvelle destination touristique des prochaines années : le gouvernement souhaite multiplier par cinq le nombre de touristes d’ici 2025, soit 20 millions avec gain de 30 millards de dollars à la clef. DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES SUR LE PLAN EXTERNE MALGRE LES DIVERS BLOCAGES REGIONAUX En redevenant progressivement un acteur la communauté internationale, l’Iran apparait comme un eldorado pour les investisseurs étrangers au vu de ses ressources mais également au regard des possibles débouchés d’une classe moyenne iranienne désireuse de développement et de progrès. Dans cette dynamique de retour, cette dernière doit faire face à des rivalités multiples et des barrières qui pourraient empêcher ce développement. On peut d’ailleurs le voir à travers les difficultés rencontrées pour la construction d’un corridor énergique pour acheminer les hydrocarbures vers l’Europe. En effet, elle se trouve encerclés soit par des alliances notamment celle de l’Arabie Saoudite et de ses allies soit par des régimes instables tel que l’Afghanistan ou le Pakistan qui sont sous à des tensions sociales et politiques, l’Irak qui est menacé de désintégration, la Turquie d’Erdogan et son régime autoritaire et enfin la Syrie actuellement en état de guerre : un acheminement rentable des ressources parait alors difficile pour le moment à concrétiser. L’Iran ne cache pas ses ambitions et souhaite doubler l’Arabie Saoudite dont la volonté de dominer est non seulement économique mais également culturelle et religieuse. Avec un conflit pluri séculaire entre la communauté chiite représentée en grande majorité par l’Iran et les sunnites rassemblés autour de l’Arabie Saoudite, les deux puissances instrumentalisent dans des pays instables comme au Liban où l’Iran soutient le Hezbollah, responsable de la paralysie actuelle du pays ou encore en Syrie où l’Iran joue un rôle déterminant dans le conflit syrien en tant que soutien au régime de Bachar Al Assad. En effet, l’Iran aurait versé environ 30 milliards de dollars entre 2011 et 2014 au clan Assad, la Syrie, alliée de toujours de l’Iran lui offre une voie maritime sur la Méditerranée. A l’avenir, elle pourrait jouer un grand rôle dans la résolution de ce conflit autour d’une alliance avec la Russie et les pays de l’OTAN.
Malgré tout, l’espoir d’une « paix froide », comme le propose Barack Obama, bénéficierait aux deux puissances et à l’apaisement voire au règlement de certains conflits régionaux. L’ouverture à l’Iran pourrait favoriser un apaisement des tensions au Moyen Orient. UN NECESSAIRE OPTIMISME DANS UN CLIMAT INTERNATIONAL PROPICE A L’ISOLEMENT L’année 2016 aura été pleine de surprises entre la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et l’élection de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, montrant le retour en force du populisme, du protectionisme et du souverainisme plutôt que l’ouverture et la coopération. 2017 pourrait être une année terrible pour le retour de l’Iran sur la scène internationale. En effet, hors du territoire iranien, la méfiance demeure après la levée des sanctions où une partie des nations mettent en cause le respect de l’accord sur le nucléaire notamment de la part d’Israël et des Etats-Unis où l’administration Trump pourrait vouloir démanteler l’accord sur le nucléaire. L’Iran devra alors redoubler d’effort pour convaincre la communauté internationale de l’honnêteté de ses démarches entreprises. Deuxièmement, au sein même de la société l’intérieur : les conservateurs iraniens sont très influents et ne veulent pas d’afflux de touristes et de capitalisme au sein de leur société, l’élection présidentielle de 2017 pourrait les amener au pouvoir et déconstruire des années de négociations. Clément HAOUISEE 59,11% de "non" : dimanche, les Italiens se sont opposés sans détour au référendum de Matteo Renzi. Le président du Conseil, qui a soutenu corps et âme la réforme constitutionnelle sur laquelle portait cette consultation, a annoncé dans la foulée sa démission, que le président Sergio Mattarella lui a demandé de reporter de quelques jours, en attendant le vote du budget 2017. Il reviendra ensuite à ce dernier de nommer un nouveau chef du gouvernement ou de dissoudre le Parlement. Le triomphe du "non" représente une défaite personnelle pour Matteo Renzi, après des mois d'une campagne qui a largement dépassé les enjeux de cette réforme. Matteo Renzi Matteo Renzi a démissionné après avoir passé trois ans à la tête du gouvernement italien, une durée égalée par seulement deux présidents du Conseil avant lui. En déclarant, il y a quelques mois, "Si le 'non' l’emporte, je démissionne et me retire de la vie politique", c'est lui qui a personnalisé ce scrutin, devenu un plébiscite sur sa personne plutôt que sur sa réforme constitutionnelle. Il a ensuite reconnu son erreur et affirmé qu'il n'aurait "pas dû personnaliser autant la campagne", mais le mal était déjà fait. Visiblement pressé d'en finir, Matteo Renzi a très vite reconnu sa défaite et annoncé son départ dimanche soir à la télévision, évoquant une défaite "extraordinairement claire". Mais le désormais ex-président du Conseil reste le secrétaire du Parti démocrate (centre gauche), toujours majoritaire à la Chambre des députés. S'il a démissionné, comme il l'avait promis, va-t-il pour autant quitter l'arène politique ? Le sujet n'a pas été abordé lors de son allocution de dimanche. Cette chute est aussi brutale que l'ascension au sommet de l'Etat de ce dirigeant de 41 ans seulement, devenu le plus jeune président du Conseil italien de l'histoire. Elle est aussi à la mesure de la déception de bon nombre d'Italiens, qu'il n'a pas réussi à convaincre de la pertinence, ni l'efficacité des réformes qu'il a mises en place pendant son mandat, ainsi que de celle qui était soumise à référendum. Le Parti démocrate Le référendum laisse un Parti démocrate (PD) fracturé, mais toujours majoritaire à la Chambre des députés. La formation de Matteo Renzi s'est publiquement -et violemment- divisée pendant la campagne sur le référendum à propos de la réforme constitutionnelle portée par son chef. Les critiques des membres de l'aile gauche du parti ne portaient pas sur la réforme constitutionnelle à proprement parler, mais sur la loi électorale que le Toscan avait fait passer en mai 2015, et qui a elle aussi renforcé le poids de la Chambre des députés. L'Italicum a -entre autres- fait de l'élection des députés un scrutin majoritaire à deux tours, qui donne automatiquement la majorité à la Chambre à la formation ayant obtenu au moins 40% des voix au premier tour. En cas de deuxième tour, c'est la liste ayant obtenu le plus de suffrages qui empochera cette fameuse prime à la majorité. Pour ses opposants, cette nouvelle loi offre trop de pouvoir au parti gagnant les élections. La réforme constitutionnelle rejetée dimanche par les Italiens, qui réduit fortement les prérogatives du Sénat, jusqu'ici sur un pied d'égalité avec la Chambre des députés, s'inscrivait également dans cette voie. Inquiets des conséquences de ces deux réformes, les frondeurs du PD ont tenté de conditionner leur "oui" au référendum à une réécriture de la loi électorale, sans succès. Mais au-delà de la réforme elle-même, la frange gauche du parti rejette Matteo Renzi lui-même, dont le franc-parler et la manière de gouverner est jugée trop personnelle, voire trop autoritaire. L’Europe et l’économie italienne Le lien entre ce référendum et l'Union européenne est, à première vue, peu évident : le scrutin portait sur une réforme de politique interne. Mais ses conséquences sont fortement scrutées en Europe, de Bruxelles à Berlin en passant par Paris. Car la victoire du "non" ouvre une nouvelle période d'instabilité politique en Italie et provoque, de surcroît, le départ d'un président du Conseil clairement pro-européen qui, voulait s'affirmer, ces derniers mois, comme un pays leader de l'UE aux côtés du couple franco-allemand. Qui va succéder à Matteo Renzi à la tête du gouvernement et, surtout, quelles peuvent être les conséquences politiques à long terme de son départ ? De nombreuses personnalités eurosceptiques comme pro-européennes ont vu dans sa défaite un camouflet infligé à Bruxelles. En France, Marine Le Pen a qualifié ce résultat de "non à la politique d’ultra austérité absurde mise en place par Matteo Renzi, politique voulue par l’Union européenne et imposée à l’Italie". En Allemagne, le ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a noté que l'issue du scrutin "n'est pas un message positif pour l'Europe, en des temps difficiles". D'autant que le très populiste Mouvement 5 étoiles, qui prône un référendum sur l'appartenance à la zone euro, apparaît en position de force pour les prochaines élections (voir plus bas). La démission du président du Conseil intervient alors que la fragile économie italienne, la troisième de la zone euro, a timidement renoué avec la croissance. Mais l'Italie doit encore composer avec une forte dette publique -133% de son PIB- et Matteo Renzi a d'ores et déjà annoncé qu'il ne pourrait pas tenir l'objectif des 1,8% de déficit public demandé par la Commission européenne pour 2017. Pour certains économistes, le pays représente d'ailleurs un plus grand risque pour la zone euro que la Grèce. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord
La personnalisation du scrutin était une occasion en or pour les adversaires de Matteo Renzi et le Mouvement 5 étoiles (M5S) a sauté pieds joints dedans. Son fondateur Beppe Grillo a jeté toutes ses forces dans la bataille, appelant au rejet du président du Conseil et de sa politique. Preuve de la violence de leurs échanges, l'ancien comique a qualifié le chef du gouvernement de"truie blessée". Le parti populiste continue à jouer à plein régime sur le rejet de la politique traditionnelle et des grands partis comme le PD, même s'il a aussi avancé quelques arguments contre la réforme constitutionnelle. Le M5S, qui dirige déjà les villes de Rome et de Turin, espère à présent passer à l'étape supérieure. Il apparaît comme la deuxième formation politique du pays dans beaucoup de sondages. Impatient et désireux de mettre la pression sur le président italien Sergio Mattarella, soit -hypothèse la plus probable- qui nommera un gouvernement de technocrates, soit qui dissoudra le Parlement, Beppe Grillo a déclaré sur son blog que "les Italiens doivent être appelés à voter le plus rapidement possible". Une autre figure du parti, Luigi Di Maio, a annoncé que sa formation allait commencer à préparer un "programme de gouvernement" et une "équipe". Le M5S milite pour des élections anticipées -elles sont pour l'instant prévues en 2018. Mais d'ici là, le gouvernement de transition que devrait nommer le président, pourrait bien modifier la loi électorale de mai 2015 qui lui est si favorable (voir plus haut),appuyé par la plupart des forces politiques italiennes. Encore plus à droite sur l'échiquier politique, la Ligue du Nord a elle aussi demandé la dissolution immédiate du Parlement. Le mouvement anti-européen et opposé à l'accueil des réfugiés a lui aussi profité de la tribune offerte par le référendum pour diffuser son message contre les élites et l'establishment. Il s'insurge également contre un autre aspect de la réforme constitutionnelle, moins mis en avant que la disparition du bicamérisme : la limitation des compétences des régions en faveur de l'Etat. La démocratie ?C'était l'un des principaux arguments des opposants à la réforme constitutionnelle : en mettant fin au bicamérisme et en bridant le Sénat, Matteo Renzi mettait en danger la démocratie et les pouvoirs risquaient d'être concentrés dans les mains d'une seule personne. Ce système était en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie, où il était vu comme un rempart contre le fascisme. Mais pour le jeune dirigeant, cette situation où le Sénat et la Chambre des députés disposent des mêmes pouvoirs est source d'incertitude et de lenteur. En réduisant les prérogatives du premier et en réduisant le nombre de sénateurs, Matteo Renzi espérait tout à la fois accélérer le processus législatif, stabiliser le pays et tenir sa promesse de mettre au placard la "vieille" classe politique italienne. Marianne Skorpis, Thierry Millotte “The worst thing that can happen in a democracy — as well as in an individual’s life — is to become cynical about the future and lose hope.” Hillary Clinton.
Erring in errors Two month ago I wrote a piece on President-elect Trump. At this time I was full of hope and still unable to think a populist could become the master of the free world. I have been a Hillary supporter since the beginning of her campaign because I thought she was the only one to embody measure and the only one to have such experience of the institutions. Now, I can only be full of despair as it is the second time in a year when populistic, irrational speeches won the heart of the People. I say heart and not brain because politics is now, more than ever before, a matter of feeling. Of course, we could discuss for long of what mistakes Secretary Clinton did to loose this promised run. Even if we doubt her sincerity, even if we doubt her ability to manage an email account, she was still the most reasonable candidate for the post. Some would have said the less worst fitted to the Oval Office. So, what does this failure of Hillary’s bid mean for the US and for all of us? The American people decided on November 9th for the future of the whole world in only one shot. They decided to which direction the world will move in the following years. With interconnectivity in economy, culture and politics, such a powerful country’s decision has an impact all over the world. Brexit will have an impact on all of Europe, if not in America too. Mr Trump’s election as the 45th President of the United States of America will have an impact everywhere as America has a major influence on our public policies from climate change, security policies or economic governance. For instance, it is now legitimate to be worried about our partnership through NATO as the President-elect Trump has stated that he may reconsider article 5 of the North Atlantic Treaty—which provides mutual assistance between its parties—if needed. But this elections remained in the hands of the American People. And what is striking here, in the same way as it was for Brexit, is the lack of discernment in voter’s minds. Personally, I am getting lost through the fact that public policy experts were not listened to, and might not ever be in the future. Living in a vacuum I might be in the wrong but I am strongly addicted to press vision of politics. And here, The New York Times’ forecasts went wrong. By a huge margin. I remember Anderson Cooper in the middle of the night asking his counterpart of CNN why have the polls going so wrong while imagining the lurking results. But this does not mean the New York Times or CNN are biased liberal media, it only means that, from now on, accuracy of polls are questioned by a new phenomenon: a social shift which decided an America of the margins to vote, a social fracture that means the media and the politicians have not been able to listen to the poorest and the disadvantage Whites. Media needs to be more aware of who the voters are, and messages as those sent by Sulzberger to Times’ readers show the shock in which Mr Trump elections has lead the media sphere. It is too early to analyse precisely who voted for whom—and if we consider the total of votes, it is clear that Mr Trump won the support of educated and middle-class Americans too—, but still, the fracture of the American society emerged on public eyes. We should all be afraid of this shift as of today there is no more middle ground between right wing closure and left wind progressive vision. There is no more common ground, no more shared values, even those we considered as the most consensual. There is no more room to heal the wounds between both sides, and wounds will stay open for long. Even on social media, interaction between Clinton and Trump supporters is almost non-existent as algorithms proposed only the things you are interested in or agree with. This has to be a brand new concern for democracy as we live unaware of the thinking of our adversaries. Dialogue, the inner principle of democracy, has disappeared. But more than media and social media, what is striking in this scission of the society, is the rejection of the experts. For long, the candidate who can use facts, grounded analysis and bring a good working knowledge of the institutions and international relations was the most supported in the polls. Today, we live in an era where people have little confidence in the ‘expert cast’. This fear of experts biased the democratic debate (as did the lies of Mr Farage during Brexit campaign) and means that knowledge and reason are no more synonymous with power. This will be damaging. The political system and institutions are becoming more and more complex and the world more and more difficult to understand. Experts voices are today more necessary but also, paradoxically, more rejected than ever. Strikingly, fact-checking and deep analysis pieces were disregarded by half of the voters. All of this can lead to non-sense politics and increase the ratio of manipulation in populistic speeches. Some would have say that President-elect Trump is not a resurgence of much more dramatic situations (here we are, Godwin). And even if President-elect Trump is a player more than an ideologist, his ideas might be theorised by others or give bad example to foreign rightist leaders. Incoming nightmares This election is a milestone at the beginning of a new era. I was shocked and affected when some European leaders sent their ‘congratulations’ to Mr Trump whitout issuing some warnings. European leaders of today are the guarantors of freedom, peace and progressive values and they should protect us from the expansion of President-elect Trump’s ideas. But Mr Trump’s victory has set the grounds of a more profound breakdown of politics. Our future is at stake through numerous elections this year, from Austrian presidential election to France’s one. Marine Le Pen (leader of the National Front) as a President should no more be considered as a single eventuality, but as our almost certain future. And I am saying this as a convinced European. I used to consider myself as optimistic. But today, I did not find any other way to figure out the outcome of the French presidential elections: our society is so shifted that we are not even able to see the suffering of the other half neither to consider seriously the eventuality of such a result, nor to propose any viable solution. I am not saying that our current politicians have no ideas that could bring us better lives, I just think that they will not be able to convince the other half facing populistic and irrational speeches. The only way we can decide to move on for the next few years—or perhaps for the rest of our lives—is to consider a far right future as almost certain. We need to think of how we could resist and protect our values in what became a ‘new world’ of politics built by far-right and regressive ideas, when our ‘rigged system’ will fail to put extremists out of supreme positions. We should wish to our fellow progressive Americans and to us Europeans good luck for the following decades. L'arrivée à la tête des Etats-Unis de Donald Trump est cruelle pour les médias traditionnels, incapables d'arrêter un « monstre » qu'ils ont eux-mêmes pour partie engendré, et dépourvus de toute emprise sur l'électorat. Cette perte d'influence est désormais la meilleure alliée du populisme. S'acharner sur les médias, comme sur les sondeurs et les experts, va redevenir très à la mode dans les prochains jours. Cela peut paraître en grande partie injuste : le don de divination n'est pas enseigné dans les écoles de journalisme et la profession est à l'évidence démunie face aux pulsions identitaires qui poussent de plus en plus au populisme dans le monde. Il n'en reste pas moins que l'arrivée à la tête des Etats-Unis de Donald Trump est cruelle pour les médias sur au moins deux aspects. Le premier est la perte évidente d'influence d'un quatrième pouvoir aujourd'hui à genoux. Il n'y aura à coup sûr pas de film consacré à cette élection qui ressemblera au célèbre « Les Hommes du président » d'Alan J. Pakula, qui raconte la façon dont les journalistes du « Washington Post » Carl Bernstein et Bob Woodward firent chuter l'administration Nixon. Bien qu'ils aient quasi unanimement appelé à voter Clinton, les journaux n'ont eu aucune influence sur le résultat final. Le deuxième aspect met en question la couverture de la politique et des affaires par les médias depuis bien avant la campagne de Donald Trump. Avant cette élection, le « Donald », s'il était connu, n'était pas encore la star politique qu'il est devenu. Il a fallu qu'il soit porté aux nues comme un de ces « personnages » dont New York et l'Amérique raffolent. Bien que ses défauts fussent tous déjà visibles, il était « une bonne histoire », et ce en particulier dans les médias de gauche. Comme l'expliquait Dominique Moïsi, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, dans nos colonnes : « Aboutissement de décennies de dérapages, produit de la rencontre entre l'afflux de l'argent et la révolution des techniques de l'information, la politique spectacle se retourne contre ses protagonistes, entraînant dans une même crise de légitimité politiques et médias. » Des médias aujourd'hui en pleine contrition, qui ne peuvent que déplorer le succès du « monstre » qu'ils ont eux-mêmes pour partie engendré en donnant à Donald Trump une couverture surdimensionnée simplement parce qu'il faisait de l'audience. De ce point de vue, la crise des médias traditionnels - presque tous les nouveaux budgets publicitaires en ligne vont à Google et à Facebook, et la pub papier s'effondre - peut être considérée comme la meilleure alliée du populisme. Il est frappant de constater que CNN, dont les présentateurs étaient effondrés mercredi matin, va enregistrer sa meilleure année en 2016 tant en termes d'audience que de chiffre d'affaires et de bénéfice. Ironie suprême de la situation, Donald Trump a pu, lui, priver ces médias qui l'aidaient malgré eux d'une grande partie des budgets publicitaires qu'une campagne présidentielle leur assure normalement. Etre une « bonne histoire » suffisait. On ne peut pas dire pour autant que la presse et les télés américaines dans leur ensemble n'aient pas cherché à comprendre les électeurs de Donald Trump. Dans leur grande tradition de qualité, elles ont multiplié les reportages et les analyses avec le plus grand sérieux et des moyens. On ne peut pas dire non plus qu'elles se soient cantonnées à un discours feutré élitiste ne parlant pas au coeur. Toutes, à un moment ou à un autre, ont questionné avec vigueur la « décence » de Donald Trump en tant que personne. Mais ces médias « mainstream » se sont heurtés à un mur, celui des nouveaux canaux de l'information. Les citoyens se renseignent aujourd'hui par l'intermédiaire de réseaux sociaux et de sites d'opinion qui sont des chambres d'écho renforçant leurs convictions. Fini l'info équilibrée et la vérité ennuyeuse, aucun fait prouvé ne peut plus entraver une conviction souvent nourrie au ressentiment. Le site de droite Breitbart News en est un exemple parmi d'autres. Pour ne rien dire de Twitter, où règnent les « haters » sans que le propriétaire du site ne se sente obligé d'intervenir.
Comme l'ont dit les médias anglais pendant la campagne sur le Brexit, l'ère de la « post-vérité » a commencé. Les médias traditionnels sont des cibles à abattre. Bizarrement, quand ils disent, enquêtes à l'appui, que Trump ne paie pas ses impôts, qu'il se moque des handicapés, qu'il est sexiste, qu'il ne connaît rien à la géopolitique, l'opinion est indifférente. Elle semble au contraire mettre ces critiques au compte de l'éternelle « conspiration des élites ». Il n'en reste pas moins que jamais avant ce 9 novembre l'impuissance des médias traditionnels n'est apparue avec autant de clarté. Ce qu'il leur reste de poids n'existe encore que lorsqu'ils répercutent ce que disent leurs lecteurs sans le moindre filtre. Au Royaume-Uni, le « Daily Mail » et le « Sun », avec leur rhétorique sur les migrants et les courbures de banane prétendument imposées par les bureaucrates de Bruxelles, ont aidé à faire passer le Brexit. On imagine le dépit dans le New York intello des rédactions du « New York Times », du « New Yorker » mais aussi du « Wall Street Journal » ce matin. Leurs éditos toujours aussi critiques de Trump - « le triomphe des forces du nativisme, de l'autoritarisme, de la misogynie et du racisme », déplore le « New Yorker » - n'ont rien changé. Peut-être même qu'ils paraîtront trop alarmistes, si, plaise à Dieu, Donald Trump gouvernait plus au centre qu'il ne l'a laissé entendre et essayait désormais de refermer les plaies ouvertes pendant la campagne. Mais il est indéniable que le « back to reporting », c'est-à-dire le fait de retourner sur le terrain pour comprendre et raconter ce qui s'y passe, est devenu un impératif plus catégorique que jamais. Nicolas Madelaine publié sur sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211479803704-la-victoire-de-trump-est-aussi-la-defaite-des-medias-2041838.php?J7f4OZwC75bBYACt.99#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20161113-%5BProv_%5D-2029863%402 Billet d'Humeur d'un Jeune Citoyen:
Les Français ne comprennent-ils rien ? L’Ifop nous révèle que deux tiers d’entre eux ne s’intéressent pas à la très médiatique primaire des « Républicains ». Cette révolution démocratique qui nous vient d’outre atlantique -comme le nouveau nom du parti de droite, ce qui ne présage rien de bon- semble s’installer durablement dans le paysage politique français, après les prémices de la primaire socialiste de 2011. Primaire ô combien couronnée de succès, puisqu’elle a offert à la Cinquième République son président le plus impopulaire (4% d’opinions favorables pour rappel). Comme quoi, on peut remporter quatre scrutins nationaux consécutifs (premiers et seconds tours de la primaire socialiste et de la présidentielle) et être moins apprécié qu’un vieillard borgne et révisionniste. Cela montre bien que voter plus ne signifie pas forcément voter mieux. Les Français, enfants pourris gâtés de démocratie, il faut le dire, ne semblent donc pas convaincus par cette trouvaille déconcertante de simplicité, qui consiste à les laisser choisir qui ils choisiront pour choisir à leur place. Etonnant. Quoi de plus logique pourtant : déçus des candidats qu’on leur proposait à la fonction suprême, ils les sélectionnent maintenant par eux-mêmes. Et s’ils restent insatisfaits du choix qui leur est offert, la solution est déjà toute trouvée : à l’avenir, on organisera des pré-primaires. D’une logique implacable, c’est une solution sans fond. Ainsi la démocratie en sort renforcée, car il est bien connu que plus on vote, plus on est démocratique. Il n’y a qu’à voir le Gabon : la démocratie y est si vive que dans certaines circonscriptions, le nombre de votes dépasse même le nombre d’inscrits. Quel exemple d’une démocratie vigoureuse ! Essayons donc de comprendre pourquoi cette solution miracle ne prend pas. C’est avant tout parce qu’elle ne résout rien, et ne fait qu’amplifier les maux dont souffre déjà la démocratie, à savoir : la surmédiatisation et les ambitions personnelles démesurées. En multipliant les élections (sans que rien ne semble changer, n’en déplaise à l’apôtre du « changement, c’est maintenant ») on lasse plus que l’on ne passionne. Déjà que l’on ne supportait plus de voir les politiques en boucle sur toutes les chaînes d’information, les primaires en rajoutent une couche est saturent complétement notre seuil de tolérance. Si l’on n’aime pas les voir, ce n’est pas qu’ils soient vilains -même si, quoi qu’en dise Paul Bizmuth, non, les ministres ne sont pas tous des top modèles qui, comme « Rama et Rachida [nous] en mettent plein la vue ». Non, si l’on n’aime plus les voir, c’est plus à cause de leurs mensonges. Mensonges au premier rang desquels on trouve cette idée saugrenue que les politiques agiraient « pour la France et les Français » plus que pour leur propre ambition. On a connu plus convaincant. L’ambition justement, me ramène à mon propos initial : Les primaires aggravent les maux dont souffre la démocratie, la surmédiatisation donc, mais aussi l’ambition personnelle. Car en effet, les exemples de Montebourg et Valls ont établi un précédent. Inconnu au bataillon jusqu’alors, Valls s’est vu propulsé ministre puis premier ministre grâce au formidable score de 5,63%. Soit 149 103 votants, à peine plus que la population de Mulhouse, c’est dire qu’il ne mobilise pas les foules. En sur-médiatisant les candidats, la primaire opère un effet loupe et leur donne une importance bien supérieure à celle qui est vraiment -je dirais même démocratiquement- la leur. Ainsi, ce précédent donne à tous l’espoir de finir ministre grâce à un peu glorieux 5%. Au risque d’en surprendre certains, je me lance dans un pronostic aventureux : ni Poisson, ni Copé, ni NKM, ni Le Maire ne gagneront la primaire ! Mais ils ont déjà gagné en visibilité. Ce qui, traduit dans le paradigme actuel, signifie le droit à un portefeuille ministériel. Evidemment, tout un chacun sait que ce n’est certainement pas leur motivation première, qu’ils sont d’abord candidats pour faire valoir leurs idées -plus novatrices les unes que les autres- mais le résultat et là : la primaire ne change rien. Elle ne fait que confirmer les vilains penchants de la démocratie. Pour pimenter le tout, le système des primaires porte en son sein un grave problème ontologique : si elle est ouverte et que tout le monde y participe, la primaire n’est qu’un doublon du premier tour de la présidentielle qui devient alors redondant. Si elle se veut fermée c’est pire, elle brise l’universalité du suffrage en introduisant une discrimination par l’orientation politique et favorise la surenchère pour satisfaire des militants qui, par définition n’ont pas les idées les plus nuancées qui soient (allez à un meeting politique, vous verrez !). Dans une démocratie suffocante, comme une réaction de panique, le choix a été fait de multiplier les scrutins. Mais la démocratie ne se limite pas au seul vote, et le fait de voter plus de garantit en rien une meilleure démocratie. Il ne s’agit donc que d’un écran de fumée qui veut nous faire croire que la démocratie change et se modernise, mais en utilisant les mêmes recettes, avec les mêmes hommes et avec les mêmes travers. C’est un changement de fond qui est attendu, et pas des ajustements cosmétiques. Néanmoins, petit rayon d’optimisme dans ce billet bien sombre : rassurez-vous, ce n’est pas qu’un problème franco-français. Les primaires ça ne marche pas très fort aux Etats-Unis non plus : la victoire d’un certain Donald Trump aurait d’ailleurs peut-être dû nous mettre la puce à l’oreille. Baptiste Morche, étudiant à HEC. Le séisme Trump a prouvé une nouvelle fois, après le choc du Brexit, que la fracture se creuse entre le peuple et ses institutions, et que rien n’est plus difficile à comprendre (ou à admettre ?) que ce qui se passe sous nos yeux. À rebours de tous les pronostics, tous les sondages, tous les big data déployés pour scruter les intentions de l’électorat, et qui prédisaient quasiment tous la victoire de Hillary Clinton, c’est Donald Trump qui incarnera le nouveau visage de l’Amérique. On avait pensé que l’Amérique voterait sans passion pour le « moins pire » des deux candidats (la question se posait exactement sous cette forme pour une majorité d’Américains), mais non ! Les Américains ont privilégié un changement radical au risque du pire. Certes le chômage a baissé durant la présidence d’Obama passant de 10 à 4,5 % et 20 millions d’Américains possèdent désormais une couverture sociale. Mais ces chiffres positifs cachent mal l’appauvrissement global des classes moyennes. « La fracture est profonde chez les démocrates, qui ont perdu leur proximité avec les classes moyennes, mais elle est de taille également chez les Républicains, totalement pris de court par ce candidat milliardaire. » Bien plus que l’adhésion à un quelconque programme politique ou économique (Trump n’en a pas vraiment), ce vote signifie le rejet de l’Amérique des élites incarnée par Hillary Clinton et souligne avec cruauté l’incapacité des médias à avoir compris, entendu, mesuré ce qui se passait dans les profondeurs du pays. L’enthousiasme qu’avait suscité la candidature de Bernie Sanders, notamment chez les plus jeunes et les femmes, lors de la primaire démocrate avait été une première alerte à l’intérieur du camp démocrate mais le parti s’est vite rassuré : comment peut-on perdre devant un fou furieux qui fait peur même aux Républicains ? C’est l’autre leçon importante de ce scrutin : la fracture est profonde chez les démocrates, qui ont perdu leur proximité avec les classes moyennes, mais elle est de taille également chez les Républicains, totalement pris de court par ce candidat milliardaire promoteur immobilier, qui ne partage en aucune manière le style et les références traditionnelles des conservateurs. C’est la droite populaire qui a pris le pouvoir dans les urnes. Et le 45 ème président des États-Unis a eu la stratégie gagnante en fondant toute sa campagne sur le ressentiment, le déclassement de cette Amérique fragilisée, sans reculer devant aucune démagogie pour arriver à ses fins. L’Amérique de Trump n’est pas uniquement l’incarnation d’un vote blanc, âgé et masculin. La victoire du candidat républicain est la marque d’une exaspération qui touche bien au-delà du « panier des déplorables, racistes, sexistes, homophobes, islamophobes » qu’avait désigné avec mépris Hillary Clinton en septembre dernier, parlant des électeurs de son adversaire. L’électorat hispanique qui était supposé voter comme un seul homme pour la candidate démocrate était en réalité bien plus divisé. Les Afro-américains qui avaient voté massivement pour Obama, tant sa victoire était un symbole fondamental pour la démocratie américaine, ne se sont pas mobilisés pour une candidature Clinton qui n’évoque rien que du « déjà vu » et la prolongation du « système ». Des États acquis aux démocrates sont passés du côté républicain.
L’ère du couple Clinton est révolue et le parti démocrate a fort à faire dans les mois qui viennent pour se remettre au diapason des classes populaires et faire émerger de nouveaux leaders. Il est encore tôt pour appréhender un éventuel changement de cap de la politique internationale de l’Amérique. Dans son discours à l’hôtel Hilton le soir de sa victoire, le Président Trump souhaitait « bien s’entendre avec ceux qui veulent bien s’entendre avec nous ». Mais la conséquence indéniable de cette victoire pour nous Français, est le signal extraordinairement positif envoyé à Marine Le Pen, dont la campagne s’inscrit de plus en plus dans un courant populiste européen et mondial : ses électeurs vont se sentir pousser des ailes et elle peut séduire de nouveaux publics. Face au Front National, le pire serait de miser sur une campagne « tous unis contre le danger Marine Le Pen », l’équivalent du « tous unis contre le danger Trump » sur lequel a misé le camp démocrate et qui a totalement échoué. Les élites, les médias et les candidats à l’élection vont-ils tirer les leçons de cette défaite de la « raison » et de l’irruption violente du mécontentement et de la frustration, balayant tous les pronostics sur son passage ? À l’instar des Américains, les Français vont-ils envisager le changement radical quitte à risquer le pire ? C’est la question qui hante aujourd’hui les états-majors des candidats à l’élection présidentielle. Les réponses ont intérêt à être à la hauteur des enjeux. Nous vivons des temps déraisonnables. Valérie Toranian Directrice de la Revue des Deux Mondes. Lire l'article original: http://www.revuedesdeuxmondes.fr/peuple-cet-inconnu-lecons-de-victoire-de-trump/ La Wallonie a longtemps refusé le Ceta. Cela illustre à quel point l'UE peine à négocier des accords commerciaux correspondant aux attentes de ses populations. C'est presque fait, et ce fut difficile. Une position commune de la Belgique sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (Ceta) a été arrêtée, ce qui pourrait permettre sa signature prochaine , a affirmé ce jeudi 27 octobre le Premier ministre belge, Charles Michel. La Wallonie, une région belge, avait opposé son veto à un accord sur le Ceta. Ces péripéties illustrent à quel point la politique commerciale de l’Union européenne peut être contestée, même par une région de 3,5 millions d'habitants. Compétente pour négocier le libre-échange de ses États membres, l’UE est dorénavant discréditée dans sa capacité à mener un tel accord jusqu’au bout. Contestable à plusieurs titres, sa politique commerciale ne pourra plus éviter une remise en cause. Devant le fait accompli Exemples d’opacité, les négociations du traité de libre-échange enter l'UE et les Etats-Unis (le TTIP) n’offrent que des fuites d’informations invérifiables. Seule une poignée de parlementaires européens disposeraient d’un accès aux documents, sans pouvoir les communiquer. Secret du mandat des négociateurs, secret des négociations… voilà donc les entreprises, les consommateurs et les autorités publiques devant le fait accompli d’un accord qui se discute dans leur dos. Une fois arrangé au fil des années de négociation, il devient presque impossible de renégocier. D’ailleurs, la ratification politique semble envisagée comme une formalité, d’autant que des clauses d’application provisoire peuvent jouer, à l’instar du Ceta. Comment ferait-on plus illégitime et suspicieux ? Les élus de Wallonie n’ont pas apprécié et rappellent à l’UE que le Ceta ne fait pas consensus. À négocier en trop haute altitude politique, l’UE s’est coupée de sa base. L’arbitrage en question
Présent dans les accords Ceta et TTIP, le règlement des litiges par arbitrage suscite la controverse. Pourtant, investir dans un pays revient à s’exposer à un risque juridique. En effet, bien qu’engagé dans un contrat avec l’investisseur, un État peut ensuite modifier son droit. En cas de préjudice, le recours à la justice de cet État deviendrait donc trop incertain. Ainsi, les mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États organisent un contre-pouvoir juridique neutre pour gérer ce risque. Pratiqué pour les litiges entre entreprises, l’arbitrage pose une question politique quand il s’exerce contre des États ou des collectivités issues du suffrage universel. Parce qu’ils encourront le risque d’une sanction des arbitres, les États ne pourront plus modifier leur droit sans respecter d’abord les intérêts des investisseurs. Les conflits d’intérêts entre ces investisseurs et les citoyens placeront les États dans une situation politique et financière incertaine. Au final, ces mécanismes d’arbitrage font émerger un conflit de légitimité sur la norme dominante. Entre commerce et démocratie, il faudra choisir. L’échec idéologique Délocalisations, désindustrialisation et chômage de masse : ces constats sont bien connus. Ceux qui font le procès de la mondialisation ont beaucoup d’arguments. La politique commerciale de l’UE a aussi produit un échec social. Souvent sacrifiée sur l’autel d’une concurrence dérégulée, une partie de notre population a été perdante dans l’intensification du commerce international. Les institutions européennes ont laissé l’ultra libéralisme guider le commerce de l’UE, sans produire en parallèle les politiques de protection de nos intérêts économiques et sociaux. Plus commerçante que démocratique, l’UE a perdu l’adhésion de ses citoyens. Ainsi usées, les institutions européennes ne sont plus suffisamment légitimes pour être représentatives. Critiqués pour leurs contenus et leurs mécanismes, les accords commerciaux négociés par l’UE ne répondent pas aux attentes de la population européenne. Le refus de transparence lamine l’adhésion de citoyens et accentue leur rejet de la gestion politique européenne. Pierre Theobald, consultant Vertuo Conseil Démocratie molle ou dictature efficace?
Que préfère-t-on? Un président démocrate, normal, mais impopulaire, méprisé voire haï, ou un autocrate aux velléités impériales, que l’on adore? La réponse semble être dans la question. Voilà le choix proposé - ou, justement, pas, car “élection, piège à con” - aux Turcs et aux Russes. Pour ce qui est de la Turquie, une phrase résume bien l’alternative encore plus particulière des Turcs suite au coup d’Etat de juillet : “Do you support a nondemocratic coup," or an "increasingly nondemocratic leader?” (Richard N. Haass). Le jeu des 7 ressemblances, le Czar et le Sultan Les ressemblances sont frappantes entre Poutine et mini-Poutine: montée en puissance dans l’autoritarisme (« Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. » disait Lord Acton), usage de la force - face aux Kurdes pour les Turcs, et pour les Russes - au choix - aux Tchétchènes, Géorgiens, Ukrainiens ou plus récemment des groupes rebelles en Syrie -, recours aux manifestations et contre-manifestations populaires de soutien (le rêve de tout homme politique en France), abus de pouvoir & népotisme & oligarchie (les deux hommes se sont bien enrichis), jeu dangereux en Syrie (Bilal Erdogan, fils de, faisant commerce avec l’EI), recours à la légitimité religieuse, retour aux racines tsaristes et sultanistes, véhémence anti-occidentale, attentats islamistes sur le territoire (Beslan en Russie en 2004, puis Volgograd en 2013, Istanbul et Ankara cette année en Turquie, c’est très utile pour se renforcer et se poser en gardien de l’ordre), et, last but not least, une opposition avec le rival régional, au hasard russe ou turc… Comme en témoigne le crash d’un pilote russe abattu par les Turcs à l’automne dernier - suivi, fort heureusement pour l’équilibre des relations internationales, par un retour à la normale après ce coup de chaud. Ce sont des rivaux-amis, car presque-voisins, mais aussi et surtout parce qu’ils sont très ressemblants sur la manière de faire, et d’être, d’être leur Etat. Ce sont tous deux des « dictateurs élus » (E. Copeaux) et adulés par la majorité. Soutenus par leurs régions, la terre, parfois par les métropoles, ils jouissent d’une image de rénovateur de la nation, tant au niveau intérieur qu’international, sur fond de paternalisme, de nationalisme et de résurgence du religieux, pour combattre des idéologies décadentes (kémalisme laïc en Turquie, libéralisme économique de Boris Elstine en Russie, et valeurs libérales de l'Occident chez les deux). Chez ces deux hommes-Etats, la démocratie recule, la nation triomphe (même si la Russie est encore un peu imprégnée de cette idée de mosaïque des peuples inhérente aux empires, et à feu l’URSS). Puissance géopolitique et diplomatique Alors que leurs pays respectifs sont un peu dans la mouise, surtout la Russie, avec le prix des matières premières et le rouble qui dégringolent, ils n’ont jamais paru aussi puissants depuis des décennies aux niveaux militaire et géopolitique. Preuve s’il en faut, l’action européenne en Ukraine (ou plutôt l’inaction, euh… excusez-moi M. Poutine) ainsi qu’en Géorgie en 2008, l’accord selon les termes d’Erdogan avec l’UE lors de la crise des réfugiés, l’immobilisme voulu face à la frontière poreuse aux transferts de djihadistes alors qu’il fait partie de l’OTAN, et enfin, le gel des relations avec l’historique allié israélien en 2009 (qui s’est réchauffé tout récemment, en juin) suite à l’abordage du Mavi Marmara. Les deux hommes, les deux pays, regardent vers l’Est, vers l’Eurasie, l’Asie centrale et même l’Extrême-Orient, comme zones de développement et d’échanges, comme en témoigne l’adhésion de Moscou, et le partenariat d’Ankara, à l’Organisation de Coopération de Shanghaï. Une (géo-)politique de l’émotion ? Pas que Poutine est aussi et surtout un génie de la realpolitik, qui a su faire revenir au concert des nations ses amis iraniens et syriens, ceux-là mêmes qu’Erdogan déteste, et qu’on a détesté (à corriger: avec qui nous allons faire un commerce florissant, sur la ligne Paris-Téhéran avec escale à Damas ré-ouverte dès 2017-2018). Poutine, c’est le seul qui réussisse à parler avec la Syrie, la Turquie, l’Iran, Israël. Poutine est bien loin d’être le patron d’une nation qui a juste des ressources naturelles, une “gas station masquerading as a country” selon John McCain, et qu’il conviendrait de mépriser. Poutine sait aussi s’appuyer sur un patriotisme, un nationalisme très fort. Erdogan, quant à lui, a été qualifié de “prince machiavélien” suite à la tentative de putsch raté, “un cadeau divin”, dont certains disent qu’il l’a lui-même orchestrée, ce afin de mieux purger l’Etat. Erdogan joue merveilleusement de l’Islam pour appuyer sa légitimité, après des années où la Turquie fut le principal pays musulman modéré, sinon laïc. Préfère-t-on un démocrate qui veut juste être (ré-)élu et récite des idées auxquelles il croit à peine, ou un dictateur qui croit dur comme fer à ce qu'il dit? Préfère-t-on la démagogie à l'idéologie? Poutine et Erdogan offrent à leurs électeurs une idéologie. Tous deux mêlent magnifiquement idéologies et intérêts – personnels et / ou nationaux, c’est parfois la même chose. Les idéologies qu’ils défendent et sur lesquelles ils s’appuient, servent leurs intérêts, excusent leurs frasques, justifient leurs excès. L'homme fort, un modèle? Là, Poutine est le maître, le modèle du FN notamment, mais pas que. Sarkozy, qui avait traité Sergueï Lavrov, son ministre des affaires étrangères, de “menteur” (olala) a été aperçu récemment au Kremlin… Recherche d’idées, de soutien, de fonds? Poutine a même beaucoup plus à droite que lui. Tapez sur Google “30 avril en Russie”… Mots-clé: skinheads, anniversaire de la mort d’Hitler, basanés. En Russie, les skinheads constituent une milice qui supplée la police, et la déborde parfois. Poutine ne fake pas, ne niaise pas, ne fait pas dans les droits de l’homme, dans la compassion à géométrie variable. C’est un connard et il le sait, ce qui le rendrait de ce point-de-vue là plus agréable et authentique que pas mal de nos dirigeants qui ne s’assument pas. De l’avantage d’être dictateur… Mais c’est aussi le défenseur de la Grande Russie, la Russie éternelle, le petit père des peuples, ethnies et religions qui habitent son pays-continent. Il n’a pas fait que s’enrichir, il a redonné son lustre à l’empire russe et confiance aux Russes. Mépris pour les homos et les droits de l’homme, notion approximative de ce qu’est la justice et la liberté de la presse, assassinats bizarres d’opposants… Le tableau est, comme la mer, noir, et ce, sur les deux rives ! (la Crimée russe est un état de fait). "Le style, c’est l’homme” (Bossuet), surtout s'il est fort Il revient à Poutine la palme de la punchline, et de l’efficacité qui va avec (il fait ce qu’il dit): “Pardonner aux terroristes est le rôle de Dieu. Les envoyer auprès de Lui, c’est le mien” ou encore “nous vous {les terroristes} buterons jusque dans les chiottes”. Amen. Ca a de quoi plaire en ce moment en France. Ce qui va avec, moins sûr. Car purger les terroristes permet de purger d’autres trouble-fêtes (juges, journalistes, opposants…). Mutadis mutandis, en Turquie, Erdogan a purgé des milliers de “traîtres” suite au coup d’Etat raté, en fait des opposants, des démocrates, des lanceurs d’alerte – journalistes, juges, politiques, militaires qui lui déplaisent. Pour le #SWAG, avantage Poutine : la moustache turque ne vaut pas le chasseur d’ours torse poil, le palais d'Ankara ne vaut pas le Kremlin… L’homme fort est séduisant pour le peuple, notamment par sa virilité, son action, sa force, son autorité, et surtout auprès des mâles conservateurs. La force exhorte, elle ferait se sacrifier des milliers d’hommes prêts à mourir pour des idées (enfin, des idées sans réflexion), dans l’enthousiasme chauffé à blanc des conflits, un peu comme en 1914 en France quand on allait buter du chleuh et rentrer à Noël. Poutine, un leader inspirationnel? Bruno Roger-Petit analyse ainsi l’interview de Depardieu : “Une sphère non négligeable de l’élite politique, médiatique et artistique de l’époque se refuse à comprendre que Depardieu se donne à Poutine parce que la France le désespère. Poutine n’est pas un président normal. Poutine se distingue parce qu’il a de l’ambition pour son pays et son peuple. Depardieu choisit Poutine comme on lance un ultime appel au secours.” Poutine plaît aussi parce qu’on peut avoir l’impression qu’il fait les choses, qu’il bouge les choses, là où une démocratie peut être lente et passive, un lieu propice à une pussified politics (D. Bilzerian). De Gorbatchev à Poutine, d’Atatürk à Erdogan Gorbatchev, l’homme de la glasnost et de la perestroïka, est détesté dans son pays, alors même qu’il s’appliquait à rendre les Russes et citoyens des autres RSS libres ! Pourquoi tant d’ingratitude? Gorbi a fait perdre la face d’une Russie humiliée par les US de Reagan et Bush Senior, alors que Poutine se pose en sauveur de l’”âme russe”. Elstine, successeur de Gorbi, a fait rentrer le pays dans une phase de thérapie de choc libérale qui a fait plonger le PIB russe, le rouble et les emplois dans les années 1990. C’était peut-être mieux sous l’URSS… Ou sous Poutine, qui réunit le capitalisme oligarchique des années 1990 et le lustre de la Russie éternelle, d’Ivan le Terrible à Staline. Dans nos yeux d’Occidentaux, il est difficile de comprendre que que Gorbatchev le démocrate soit si détesté, tandis que le dictateur Poutine soit adulé. De même pour nos dirigeants actuels: pourquoi sont-ils si détestés? Est-ce qu’ils tuent, des hommes, des libertés? Il manque un chaînon à l’analyse : nous avons appris, avons été éduqué à la démocratie, pas les Russes. Et de fait, embourgeoisés par 60 ans de paix (et plus encore pour ce qui est des acquis politiques et sociaux) nous sommes exigeants, ne réalisons pas la chance que nous avons, nous nous battons pour des vétilles archaïques - même si les chantiers sont encore grands et nombreux concernant nos élus et ce en quoi ils pourraient s’améliorer. Les démocrates russes, et dorénavant turcs, sont de véritables combattants, a l’instar de Sakharov et Soljenitsyne dans les années 70. Qu’ils me craignent, pourvu qu’ils me respectent, me vénèrent, m’idolâtrent Il semblerait que l’on puisse véritablement dire que “qui aime bien, se laisse bien châtier” tant les cotes de popularité de ces hommes forts que sont Erdogan et Poutine crèvent le plafond. Les Russes et les Turcs ont l’autoritarisme / dictature ET les attentats, malgré leur Homme Fort. Maudits soient les Russes et Turcs moyens… Ils se font mettre, et ils sourient. C’est aussi et sans doutes une question d’éducation, de société, de valeurs, n’ayons pas peur de le dire, au risque de passer pour ethnocentristes. Certes, un peu - beaucoup même – de décentrement, un relatif relativisme, ne font pas de mal, mais y a-t-il un mal quelconque à parler de la logique, ou l’illogique, de la majorité de la population de ces peuples ? C’est un peu rapide, un peu simple, mais c’est vrai. L’Homme Fort est un fantôme ressurgi du passé, qu’il serait dommage de réincarner chez nous, sous couvert de recette miracle. En France, l’homme fort fut le Roi, l’Empereur, Robespierre, Pétain… De Gaulle selon OSS 117! Nos politiciens, "tous pourris", tous mauvais, mais au moins à peu près démocrates, pas trop corrompus et pas tout puissants grâce à la Constitution et ses règles – bien que le président soit une sorte de monarque républicain dans la Ve République -, à la puissance de la société civile - nous autres, éternels râleurs - et des contre-pouvoirs de la démocratie libérale dans laquelle nous vivons. On a de ce point de vue-là un peu de chance. Moralité pour la France, et pourquoi & comment les Hommes Forts ? Bravo aux Hommes Forts, et attention à eux. Aussi bien à l’étranger que chez nous - pas encore trop de risque, me direz-vous. Je vous dirais que l’histoire repasse des plats, sous une autre forme, et qu’il faut raison garder, rester vigilants, ne pas être séduits, si on ne veut pas, par exemple, d’une France Bleu Marine / Brune Marion pour contrer une France Verte CCIF - UOIF (qui ne serait pas très jolie non plus). Un des mécanismes qui mène à l’Homme Fort consiste à glisser sur une pente dangereuse, et jouer la carte, si facile, si efficace, si séduisante en ce moment du « moi ou le chaos », « à la guerre comme à la guerre » (encore que), « révisons la Constitution », etc. ce qui fait penser à ce que disait Benjamin Franklin sur l’arbitrage entre sécurité et liberté : « Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety », arbitrage auquel on n’a pas encore touché pour l’instant, ni pour ceux qui mettent en danger l’intérêt général, ni pour la population dans son entièreté (en général, cela va comme ça : dans l’intérêt de tous et pour lutter contre les méchants – ils peuvent vraiment être méchants ou juste être les ennemis du chef en place, qui est / sera un Homme Fort – on va réduire les libertés de tout le monde). Ca va vite, plus vite qu’on ne le pense. Les libertés se perdent facilement, la paix aussi. Heureusement, on a encore un peu de temps, de volonté et de hasard avant que l’alternative ne soit l’homme fort ou les méchants. Cet article finira par poser une question apparemment absurde, celle d’une dictature, ou ne serait-ce qu’un régime autoritaire, en France. Question pas si absurde que cela si l’on écoute les analyses sur l’état de notre société, de notre démocratie – usées – ainsi que les voix qui s’élèvent contre l’Europe. Hollande est-il si terrible, donc ? Ou, justement, pas si terrible... ? Qui pourrait être un / une Homme Fort ? Aguel La Kro « Big Data ». Un maître mot, un savant mot. Partout il est sur la bouche et le bout des doigts d’un nombre de plus en plus important d’individus. Il regroupe tout et à peu près n’importe quoi, tant sa définition est vaste. Mais il est une réalité à étudier car de plus en plus présente dans nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Sur un nombre croissant de sites de crédit en ligne, aux Etats-Unis, chacun peut souscrire à un prêt après avoir rempli en bonne et due forme un formulaire très rapide. Des formalités, comme l’adresse mail, le nom et le prénom, le lieu de résidence, etc. Mais ce que les individus qui remplissent le formulaire ignorent, c’est qu’à l’instant même où ils saisissent ses informations et les valident, une vraie machine de recherche se met en place. Si vous avez copié/collé votre mail, la vitesse à laquelle vous écrivez, le nombre de personnes financièrement solvables dans vos amis Facebook, sont autant d’informations collectées puis traitées par l’entité. Pour en déduire de votre propre solvabilité financière. Voilà une définition illustrée du Big Data, et en particulier de son traitement. Car le Big Data ne tire pas seulement de conclusions à partir d’un grand nombre d’éléments, il s’agit également d’un terme utilisé pour caractériser le nombre impressionnant de données disponibles sur des individus ou d’autres entités. Ce qui est propre à notre époque. Et par conséquent, devant cet abysse de matière, des nouvelles techniques sont mises en place afin d’en exploiter dument l’étendu des possibles. Pourquoi ce nombre impressionnant de données aujourd’hui ? 1.4 Milliards de Smartphones ont été vendu dans le monde en 2015. Les applications et les activités que nous effectuons sur nos téléphones nous demandent bien souvent de saisir certaines données personnelles, allant du clic le plus banal aux informations les plus intimes. Un like sur une publication, c’est une petite pierre de donnée supplémentaire qui peut être exploitée par une grosse entreprise de la Silicon Valley au Nord de la Suède. Un « ailleurs » existe donc bien, lieu où nos données se retrouvent, sont analysées afin de mettre au point de nouvelles méthodes de traitement. D’ailleurs, ces applications et sites que nous utilisons nous demandent une « autorisation » afin d’avoir accès à des listes amis, préférences, etc. Dans une majorité de cas, nous ne faisons pas attention à ce genre de choses, choses qui nous semble entrées dans le lieu commun, qu’est-ce qu’un simple like après tout ? Mais le Big Data commence bien là. Deux écoles existent alors face à la collection massive des données, et surtout leur utilisation. Une première école affirme que ce recours à l’analyse de nos données est un bien fondé car il permet de guider nos choix en fonction de nos désirs et de ce que nous apprécions. Ainsi plus besoin de faire nous même le tri, puisque il est déjà fait, on nous offre des bons choix au bon moment. Mais cette vision est réductrice, car orienter nos choix, c’est une chose, mais nous fermer inconsciemment à d’autres choix, ce qui est une privation de liberté en soi, n’est pas acceptable. L’autre école considère qu’un grand nombre de données sont acquises de manière étrange, qu’elles sont volées et utilisées à de mauvaises fins, ou à des fins qui nous échappent. L’Apple watch par exemple a été pointée du doigt un moment, en cause la peur de certains qu’on se serve de leurs données cardiaques et de santé en général, afin de les vendre par la suite à des compagnies d’assurance ou des banques, pour prévenir le risque lié à leurs clients. Avec cette omniscience du débat, Il n’est alors pas étonnant lorsque l’on arrive en première année d’école de commerce ou d’ingénieur en ayant des cours d’introduction et d’approfondissement de Big Data. Ce cours va bien souvent de pair avec un cours d’application de statistiques, qui permet d’illustrer les méthodes de traitement d’un grand nombre de données grâce à des modèle statistiques. Formation utile quand on sait que ces qualifications sont parmi les plus recherchées aujourd’hui par certaines grosses entreprises. Le Big Data est donc bien devenu Roi. Mais concentrons-nous un instant sur une partie du débat , la plus riche selon moi, qui caractérise un bon nombre de personnes inquiètent à propos de l’utilisation de leurs données, et la façon dont les entreprises intéressées procèdent J’ai eu l’occasion de lire un travail très intéressant de Dallas Walker Smythe, qui est un économiste Canadien, mais également un militant politique se rapportant au monde des médias. Audience Commodity and its work. Le point de vue de Smythe est plus qu’intéressant car il compare avec le lexique de l’idéologie marxiste notre rapport avec les média et notre rôle en tant qu’auditeur dans ce vaste monde. L’idée, simplifiée est que nous, peuple, travaillons sagement sans nous en apercevoir, en autorisant l’utilisation de données, en apposant des likes à tout va, pendant que nos données sont utilisées à des fins commerciales, sans que l’on aperçoive réellement le fruit de notre « travail ». Car oui, chers amis, nous travaillons pour d’autres quand nous utilisons toutes les heures nos téléphones portables. Il considère que nous sommes des « commodities ». Smythe va assez loin dans son raisonnement, en mettant en place tout un système, en définissant comment les publicitaires achètent l’audience que nous sommes, et quel prix nos actions peuvent rapporter. Ce que nous prenons pour un loisir en nous rendant régulièrement sur nos Smartphones, est en réalité un travail comme les autres. Et si l’on continue le débat en considérant cette activité comme un travail, tout peut alors être remis en question, à d’autres niveaux, politiques notamment. Qu’en est-il de la politisation de ce débat, de ce questionnement sans cesse renouvelé par certains ? Le 6 octobre 2015, la cour de justice de l’Union Européenne a suspendu le « Safe Harbor », qui était un accord qui encadrait l’utilisation des données des internautes d’Europe par certaines entreprises américaines (dont les multinationales de la Silicon Valley…). Pour quelle raison ? Un étudiant autrichien, Max Schrems, a déposé une plainte contre Facebook (au moment ou Snowden révélait l’existence du programme clandestin Prism). Ce programme permettait à certaines agences américaines de renseignement d’avoir accès aux données d’un grand nombre d’utilisateurs, les Européens en particulier. Et Max, à juste titre, pensait que cette action était une violation du droit de protection de ses données personnelles, protégées par des textes européens. La conséquence de ce débat aurait du tendre vers plus de conservation des données en Europe, et non plus à leur transfert vers les entreprises américaines. Au lieu de cela, début 2016, un nouvel accord de transfert automatique a été signé, de la même manière qu’avant la plainte, contre l’assurance par le directeur du renseignement américain de ne pas toucher aux données de masse. Les réactions à ce genou au sol se font encore attendre. Comment alors trouver un terrain d’entente ? Plusieurs idées ont été apportées, notamment en faveur de la monétisation de nos données en fonction du degré de leur importance pour ceux qui les exploitent (idée de Jaron Lanier, essayiste, compositeur, et ingénieur informatique américain, ayant notamment travaillé pour Columbia, dans son essai Who owns the future ?), ou encore de taxer en Europe, par exemple, les grosses entreprises américaines pour l’exploitation de nos données, en échange que les États taxant ces données nous reversent une partie de ces recettes supplémentaires, et ainsi puissent contribuer à de plus belles causes, dans les milieux de la santé ou encore de l’éducation.
Cessons donc de voir le Big Data et son utilisation comme ayant peu de conséquences directe sur nous, et acceptons l’idée que c’est un service rendu à certaines entreprises, qui mérite donc une contrepartie si il est exploité. Il faut donc pousser dans le sens de la politisation de ce débat, à l’échelle Européenne comme à l’échelle nationale. Nicolas Amsellem  La France se ridiculise, voulant rompre les négociations de libre-échange UE - Etats-Unis.Et ce au nom d’arguments mensongers qui travestissent la réalité économique .N'y a-t-il plus personne pour défendre le libre-échange ? Le TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) est l'objet de tous les fantasmes et la cible de critiques quasi unanimes. Dans un sondage de juin dernier, deux tiers des Français souhaitaient mettre un terme à cette tentative folle de rendre le monde plus ouvert. Le gouvernement français, toujours soucieux de flatter l'opinion plutôt que de l'éclairer, a récemment annoncé la rupture des négociations, par le biais élégant d'un tweet (celui du secrétaire d'Etat au Commerce extérieur) ou d'une déclaration inopinée (celle de François Hollande à la conférence des ambassadeurs). L'opposition, fidèle à sa longue tradition protectionniste, s'est empressée de renchérir, en demandant de « nouvelles bases de discussions ». On ne trouve aujourd'hui, chez les politiques ou les éditorialistes, à peu près personne qui soutienne le TTIP, triste reflet d'une classe dirigeante intellectuellement lâche et économiquement analphabète. Inutile de mentionner les projections de croissance et d'emplois, immédiatement démenties par une myriade de blogueurs ; ni de rappeler la théorie des avantages comparatifs, puisque la mode est au made in France, auquel chaque candidat vient faire des génuflexions ; ni de préciser qu'il s'agit d'une négociation sans but préétabli où les partis peuvent s'entendre sur certains points et en laisser d'autres de côté ; ni de suggérer, face à l'objection récurrente de l'arbitrage, qu'il n'est pas anormal que les Etats doivent respecter les traités qu'ils ont signés ; ni d'invoquer la réputation de la France, risée de la diplomatie internationale avec ses airs de coq outragé et son incapacité à tenir parole (le fin du fin étant que la Commission semble décidée à passer outre le veto français) ; ni de décrire le mouvement mondial de régionalisation des accords de libre-échange, qui nécessite la formation d'une sorte de bloc occidental face aux grands émergents. Tout cela est totalement hors sujet face au spectre qui épouvante nos foyers : le boeuf aux hormones et autres poulets chlorés, conjointement invoqués par Attac et le Front national. Rarement opération de propagande fut aussi brillamment menée. De boeuf aux hormones, il n'a jamais été question, puisque le négociateur européen a répété qu'il n'en voulait pas et qu'il a amplement prouvé sa capacité à obtenir gain de cause sur ce sujet dans le cadre de l'OMC. Mais l'image a pris. Les experts de « l'art du simulacre », comme Platon décrit les sophistes, ont gagné la partie. En ces temps de circulation de l'information, il est fascinant de constater à quel point un mensonge bien tourné peut supplanter une vérité mal présentée : ce que les commentateurs américains appellent la politique post-vérité (« post-truth politics »). Tous les efforts de rectification de la Commission européenne sont et seront vains. Faut-il, comme l'intrépide avocat Hervé Guyader, s'épuiser en réfutations rationnelles ? Utilisons plutôt les armes de l'adversaire. Image pour image, j'en appelle à l'huître d'eau salée contre le boeuf aux hormones. Aujourd'hui, nos fiers ostréiculteurs, hérauts de la gastronomie française, peinent à exporter leurs produits. En effet, pour s'assurer de la bonne santé de l'huître, l'Union européenne exige de tester l'intérieur du coquillage, tandis que les Etats-Unis préfèrent analyser l'eau dans laquelle elles trempent. Deux méthodes que la communauté scientifique considère rigoureusement équivalentes du point de vue de la sécurité sanitaire. Du fait de ces traditions divergentes, nos fines de claire no 3 sont interdites de traversée de l'Atlantique. Ce que proposent les négociateurs du TTIP est de choisir l'une des méthodes ou de reconnaître les deux. Voilà tout ce que signifie l'expression maléfique d'« harmonisation des normes ». Nul doute que les restaurants new-yorkais se précipiteront sur les huîtres françaises, tandis que la réciproque reste à démontrer. C'est donc cela, la trahison du peuple ? Et l'on pourrait multiplier les exemples : caractéristiques des machines à crème pour les pâtisseries, mesure de consommation des appareils électriques, etc. On pleure à l'évocation par Saint-Simon du malheureux Vatel, maître d'hôtel du Grand Condé, qui mit fin à ses jours parce que, lors d'un grand festin donné en l'honneur de Louis XIV, les charrettes de poissons et d'huîtres n'étaient pas arrivées à temps. Espérons que ses successeurs, soutenus par le TTIP, auront plus de chance. Gaspard Koenig Dans les Echos « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » : cet article 24 de la Charte des Nations Unis énonce de façon très claire les missions qui sont confiées à l’Organisation des Nations Unies sur la scène internationale. Or, on observe qu’en 2016, les conflits sont encore très nombreux à travers le monde à l’instar du conflit syrien qui sévit depuis maintenant plusieurs années. Ce conflit guerrier, qui nécessitait l’intervention « rapide et efficace » de l’ONU, est responsable non seulement du déplacement de millions de réfugiés qui fuient la guerre mais favorise également le développement du terrorisme islamiste. Cette inaction montre que l’organisation internationale est incapable de gérer cette crise majeure qui est en train de déstabiliser l’ordre mondial. Lors de sa création en juin 1945 à la conférence de San Francisco, celle-ci avait pourtant pour but de ne pas reproduire les échecs de la SDN qui n’avaient pas pu empêcher le massacre de la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation ambitieuse qui se veut universaliste a vocation à entretenir une solidarité entre les peuples avec un partage de valeurs communes comme les droits de l'homme, le progrès social ou encore la démocratie. Or, il existe un fossé entre les ambitions affichées par le texte constitutif, qui n'est autre que la Charte des Nations Unies signée par 193 Etats, et l'état de la société internationale qui apparaît aujourd’hui divisée, disparate et inégale : en attestent la période de la guerre froide, les divisions Nord-Sud ou encore l'opposition entre l'Occident et les anti-Occidentaux. Dans un monde toujours plus globalisé, toujours plus interdépendant, des solutions globales doivent être apportées. Cependant, nombre d'Etats membres poursuivent des intérêts autres que cet objectif premier. Tous ces éléments sont sources de blocages dans la poursuite des objectifs poursuivis par l'ONU et empêchent une réforme en profondeur de l’organisation. Ainsi, entre protection des intérêts étatiques et recherche de l’universalisme, l’ONU est-elle réformable ? L’ apparente impossibilité de réformer causé par des blocages multiples (1) Des blocages politiques et institutionnels importants L’ONU est devenue dans la seconde moitié du XXème siècle une institution incontournable dans les relations interétatiques. Si elle a été rêvée comme le modèle d’un universalisme efficace, force est de constater aujourd’hui que son bilan est plus que mitigé. D’une part, la paix et la sécurité, qui sont la raison d’être de cette organisation, n’ont pas toujours pu être rétablis ou maintenus. Les différents massacres perpétrés pendant la guerre de Yougoslavie ou encore le génocide rwandais sont autant d’illustrations tragiques de cette incapacité de l’ONU à réagir adéquatement. Cette impuissance alarmante amène certains à militer pour une réduction des engagements de l’ONU qui se sont multipliés depuis sa création et qui ont eu pour effet de disperser son action, au grand dam de ses objectifs premiers. Cet élargissement des pouvoirs institutionnels impliquent des mutations dans la gestion et le financement des différentes actions menées par celle-ci. Si le budget de l’ONU repose essentiellement sur la contribution de tous ses états membres, certains pays développent une forme de chantage au sujet de leur participation personnelle en échange de concessions politiques à leur avantage. Or, les Etats sont les premiers à critiquer les dysfonctionnements de l’ONU sur le terrain incapable de faire face à des crises complexes alors qu’ils y participent directement notamment en restreignant leur cotisation onusienne lorsqu’ils instaurent des missions plus larges. D’autre part, la difficulté de réformer l’ONU vient avant tout de la complexité de la procédure instituée par les articles 108 et 109. Au regard des majorités à adopter, cette procédure parait difficile voire impossible à mener dans une institution qui compte aujourd'hui 195 pays membres qui n’ont ni les mêmes idées de l’universalisme ni du rôle à conférer à l’ONU. Preuve de la difficulté de changer le système onusien, la dernière réforme d’ampleur date de 1963. Depuis ce temps, plusieurs problèmes majeurs - notamment trois principaux - se posent au sein de l’institution : L’utilisation du droit de veto au sein de Conseil est la source principale des dysfonctionnements de l’ONU. Contraire au principe d’égalité souveraine des Etats, il est à l’origine de la plupart des critiques qui le considèrent aujourd'hui comme l’instrument de blocage privilégié des membres du conseil de sécurité pour contrer des revendications souvent largement partagées mais contraires à leurs intérêts. Ainsi, l’URSS l’a utilisé 84 fois entre 1946 et 1971, alors que les Etats-Unis l’utilisent systématiquement pour empêcher les décisions liées au conflit israélo-palestinien, on observe ainsi des cycles de blocage conséquents au cours de l’histoire de l’ONU. L’élection du Secrétaire Général des Nations Unis supposée démocratique dépend en grande partie des membres permanents du Conseil de Sécurité qui peuvent blacklister n’importe quel candidat pour n’importe quelle raison, ce que dénonce Ian Bremmer dans le Time. Cependant, des réformes ont été entreprises pour améliorer la transparence dans la désignation du successeur de Ban Ki-Moon. En effet, les candidats doivent maintenant passer un grand oral devant l’Assemblée Générale et répondre aux questions des délégués : un processus de recrutement considéré comme une petite révolution pour beaucoup. La composition du Conseil de sécurité est régulièrement remise en cause. En effet, les sièges attribués aux vainqueurs de la seconde guerre mondiale ne correspondent plus à aucune réalité démographique et géographique. L’Europe est sur-représentée, l’Afrique oubliée, et une majorité des grandes puissances du XXIème n’en font pas partie. En dépit d’une modification du nombre de membres non permanents augmenté de 6 à 10 Etats en 1963, l’absence d’une puissance africaine en tant que membre permanent, qui représente aujourd'hui 16% de la population mondiale, est une preuve criante de l’obsolescence de la composition de ce Conseil qui ne reflète plus l’équilibre des puissances existantes du XXIe siècle. Ainsi, ces différents blocages montrent combien il est important de réformer l’ONU afin de rétablir un système universaliste efficace. (2) Une divergence des intérêts étatiques responsable de cette impossibilité de réformer Les Etats ont pour habitude d’appliquer comme bon leur semble les règles du droit international public et donc insidieusement, des règles édictées par l’ONU en privilégiant leur droit national. Cette distorsion de point de vue entre ces deux droits fait que les règles de droit international, pour être appliquées en droit interne, doivent le plus souvent faire l’objet d’une ratification. Ainsi, la procédure de révision de la Charte des Nations Unies développée dans ses articles 108 et 109 n’échappe pas à cette règle. Une révision n’est possible que si les deux tiers des états membres la ratifie : ce qui en fait une procédure relativement contraignante qui empêche une réforme rapide et profonde du fonctionnement onusien. Les blocages successifs frappent de plein fouet la crédibilité ainsi que la légitimité de l’ONU à bien des égards. L’usage qui est fait du droit de veto participe à cette perte de crédibilité de l’ONU alors que les intérêts des Etats ressortent au travers du blocage de la prise de décision au Conseil de sécurité. C’est ce que l’on observe aujourd’hui avec la « resoviétisation de la diplomatie russe » et la cristallisation du blocage du conseil par le droit de véto autour du conflit syrien. Le veto est détourné de sa fonction initiale afin de préserver les intérêts des plus puissants, fonctionnement contraire à celui d’un système universaliste où tous les pays sont égaux. On en revient à un système où des pays alliés se protègent mutuellement dans un système d’affrontement des puissances. De plus, il est troublant - voire paradoxal - que les Etats-Unis, qui ont été le moteur principal de Nations Unis au moment de sa création, agissent postérieurement comme un véritable frein à l’universalisme. Comme l’illustre Lakhdar Brahim, ancien ministre des affaires étrangères algérien, qui s’interroge dans la revue Politique Etrangère sur la survie de l’ONU dans les prochaines décennies, les Etats-Unis se sont toujours servi de l’organisation pour servir plus ou moins ouvertement leurs intérêts ; En 1945 pour redéfinir un nouvel ordre juridique international ; pendant la Guerre froide, elle agira de concert avec ses alliés en se confrontant au bloc de l’Est ; superpuissance affirmée après l’éclatement de l’URSS, elle se révèle de plus en plus en retrait et fait même preuve d’un certain laxisme en transgressant les règles du droit international ou en le rendant inefficace notamment après les attentats du 11 septembre 2001. En effet, celle-ci envoya des troupes sans aval de l’ONU, en agissant unilatéralement sous le prétexte de l’usage de « la force préemptive ». Certains dénoncent une instrumentalisation de l’ONU incapable d’empêcher l’action des américains qui agissent en toute impunité. En ce sens, on a donc une véritable atteinte à l’universalisme et à une indifférence au respect des normes imposées par l’ONU. En attestent la loi Helms-Burton où l’Amérique entendait imposer sa vision de l’ennemi ou encore son désengagement vis à vis de la Cour Pénale Internationale. Pour pallier à cette absence de consensus global, émerge une tendance au régionalisme avec la constitution de groupe de sensibilité homogène dans des domaines uniques qui sont de plus en plus privilégiés au détriment des organisations représentatives et multilatérales telle que l’ONU. Les exemples ne manquent pas avec l’OTAN crée en 1949 visant à assurer une sécurité collective, le G7 - ou G8 - qui agit comme un forum de prises de décisions réunissant les sept plus grandes puissances et complété par le G20 en 2008. Ces organisations alternatives peuvent être amenées à déstabiliser le système complexe des règles et concurrencer le système de l’ONU. Des blocages détournés par une adaptation concrète et des révisions partielles (1) Une révision parcellaire du fonctionnement onusien Certains Etats membres de l’ONU manifestent leur volonté d’obtenir une réforme du système onusien pour plus de représentativité et d’équité entre les Etats. Une première réforme avait été réalisée en 1963 en ce sens. Cependant, même si les Etats n’ont pas pu réviser le droit de veto ni le système de représentativité au Conseil, le Sommet de 2005 a permis de réaliser quelques innovations. C’est ainsi que deux nouveaux conseils ont été mis en place : le Conseil des droits de l’homme et la Commission de la consolidation de la paix. Il a également permis le renforcement des organes de l’ONU déjà existants afin de les adapter aux problèmes actuels. Comme le montre Vincent Chetail, professeur à l’Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI), dans la revue Relations Internationales, il y a eu une « revitalisation » de l’Assemblée générale qui a notamment été à l’origine de ces deux conseils. Cette revitalisation lui a aussi permis de développer les suites à donner au Document final du Sommet mondial de 2005 en termes de développement. Le Conseil des droits de l’homme ayant consacré une de ses premières résolutions au droit au développement, il y a aurait là une revitalisation du rôle même de l’ONU. Enfin, à l’occasion de ce Sommet a également été crée le Bureau de la déontologie qui a pu être un pas vers plus de crédibilité en permettant le contrôle de l’intégrité des fonctionnaires de l’ONU. Cependant, malgré toutes ces avancées, cette Déclaration finale de 2005 se révèle dans l’ensemble décevante et réaffirme la plupart du temps des obligations consacrées antérieurement. Aucune décision de fond n’a été prise dans des domaines qui nécessitaient des changements majeurs afin d’adapter l’organisation à l’heure d’une mondialisation approfondie. C’est le cas du Conseil de Sécurité et sa démocratisation. Plusieurs projets de réforme avaient été proposés mais aucun n’a abouti, reflétant encore une fois de plus les rivalités, les méfiances réciproques entre les Etats, empêchant toute avancée majeure, ce qui ne déplaira pas aux membres permanents. Mais selon Victor-Yves Ghebali, professeur à l’IUHEI, le problème de démocratisation se pose surtout au niveau du droit de veto et de son utilisation. Des projets ambitieux ont été proposés afin d’empêcher à l’avenir qu’un pays bloque le processus de décision collective. De plus, en matière militaire, un projet de renforcement des capacités de l’ONU pour la gestion des conflits avait été proposé pour une intervention rapide, cohérente et efficace avec la création d’une armée permanente. Cependant, ce projet n’a pas abouti car critiqué par les Etats invoquant le droit d’ingérence. Plus grave, la Déclaration Finale n’évoque pas la question du désarmement et de la non prolifération, ce que Kofi Annan, Secrétaire Général de l’ONU de 1997 à 2006, considérera comme un échec majeur du Sommet. Enfin, le Sommet n’est pas parvenu à dépolitiser les droits de l’homme avec la création d’un organe totalement indépendant bien que ce soit un domaine qui mériterait d’être en dehors de toute considération politique et où les Etats ne seraient plus les juges ultimes des infractions qu’ils ont commis. (2) Un fonctionnement informel restreignant les blocages En dépit des divisions et des blocages touchant cette institution, il est unanimement reconnu que l’ONU est un forum de dialogue permanent entre les Etats, une organisation incontournable dans la gestion occasionnelle de conflits globaux. A ce titre, son bilan est plus positif qu’il n’en a l’air notamment dans le processus d’adoption des actes onusien qui se fait à la majorité afin de créer un consensus de tous les membres du Conseil de Sécurité même non permanents notamment dans les domaine de respect des droit fondamentaux, le lutte contre les violences de tout genre mais également le droit d’intervention. On observe donc une continuité dans les objectifs poursuivis par l’ONU qui reste une formidable plateforme dans la promotion de valeurs communes. Toujours dans le fonctionnement institutionnel, la pratique du droit de veto est vue comme un blocage majeur des missions de l’ONU. En réalité, ce droit fait l’objet d’une utilisation limité et sa validité ne s’exprime qu’au moment du vote. Il a été ainsi interprété que l’« absence d’un Etat votant n’a pas de valeur de vote contraire » depuis la politique de la chaise vide menée par l’URSS. Il est aujourd’hui plutôt utilisé comme instrument de dissuasion. En dépit d’une réforme profonde de la composition du Conseil de Sécurité de l’ONU, il y a une représentation géographique relativement bien équilibrée des plus grands Etats puisque ceux-ci sont intégrés régulièrement au Conseil de sécurité. Les Etats cherchent ainsi de manière pragmatique et symbolique à limiter les déséquilibres institutionnels : c’est ainsi que Laurent Fabius, ancien ministre des affaires étrangères français, propose que les membres permanents du Conseil de Sécurité limitent volontairement leur droit de veto en s’engageant à renoncer à son usage lors des situations de crimes de masse. Cette notion de crime de masse échapperait à l’appréciation unilatérale de ces membres par la saisine du secrétaire général de l’ONU chargé de se prononcer sur la nature du crime. Cela dénote particulièrement la volonté de maintenir « la crédibilité de ce pilier de la paix et de la stabilité que doit être le Conseil de sécurité. » Enfin, il existe un certain nombre de domaines d’affaires étrangères dont la gestion relève en grande partie de l’ONU et qui nécessite de surcroit une réponse globale et universelle : on peut citer l’environnement, les produits stupéfiants, la criminalité internationale, le désarmement et le soutien important des Etats aux opérations militaires. Ainsi, des spécialistes remarquent, non sans ironie, que lorsque les Etats-Unis ne sont pas directement intéressés ou ne veulent pas agir unilatéralement, les missions de l’ONU de maintien de la paix ou de préservation de la sécurité sont effectivement assurées. L’ONU apparaît ainsi comme une organisation symbolique et nécessaire. A l’avenir, il est inévitable que les Etats-Unis ne soient plus la seule puissance superpuissance. Dès lors il faudra recomposer avec la rapport de force au sein de l’institution. L’ONU restera alors le meilleur espace de rencontre pour encadrer ces nouveaux rapports et trouver des solutions consensuelles aux problèmes internationaux. Les blocages structurels et politiques de l’ONU empêchent théoriquement toute réforme profonde de l’ONU mais elle a été palliée par la nécessité concrète de contourner les blocages de l’ONU. Les Etats ont su rééquilibrer les rapports entretenus entre les diverses puissances, notamment en permettant aux pays les plus légitimes à demander un siège au Conseil de Sécurité et d’en être les membres de manière régulière. Les Etats font ainsi preuve de pragmatisme pour poursuivre les différents objectifs, ceux-ci finissant par devenir des standards internationaux. Malgré les déséquilibres en termes de puissance, les Etats savent trouver des consensus quand l’intérêt de tous est en jeu, revigorant ainsi l’espoir d’un universalisme fonctionnel qui passe par le maintien des institutions de l’ONU. La COP21 en est le parfait exemple, dans le cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 195 Etats ont su, en décembre dernier, trouver un accord afin de limiter les effets du changement climatique. « L'année prochaine ou celle d'après, l'Arctique sera libéré des glaces comme jamais depuis 100 000 ans » Peter Wadhams, professeur de physique des Océans à l’université de Cambridge Cette prévision, faite par le scientifique Peter Wadhams le 21 août dernier dans les médias anglais, peut apparaître anodine et un peu trop alarmiste au vu de certains. Or cette information, si elle se concrétise - et elle est bien partie pour l’être - aurait un impact considérable sur le plan planétaire en provoquant notamment une accélération irréversible du réchauffement climatique et des tensions régionales multiples quant à l’exploitation des ressources situées aux alentours de l’Arctique. Cependant, et c’est là tout le problème, cette exploration par les Etats voisins pourraient avoir des conséquences néfastes à une époque où l’on tente de mener une transition écologique ambitieuse après la conclusion de l’accord sur le climat à la COP21 en décembre dernier. Une coopération uniforme est donc primordiale pour assurer la préservation de ce continent et plus largement de l’intégralité de l’écosystème planétaire. Ainsi, comment la conjugaison de tous les enjeux divergents tenant à l’avenir de cette région attestent de la nécessité d’une coopération à l’échelle mondiale ? L’Arctique : un engouement expliqué par son potentiel économique considérable. L’Arctique est une région très riche en ressources naturelles, qu’elles soient pétrolières, minérales, gazières ou halieutiques : ce qui attire la convoitise de beaucoup d’acteurs internationaux, qu’ils soient publics ou privés. Selon le United States Geological Survey, 13% des réserves mondiales pétrolières et 30% des réserves mondiales de gaz se situent dans les sous sols de cette région, ce qui suscite la convoitise des compagnies pétrolières dans une époque où les réserves des ressources fossiles s’amenuisent et sont de plus en plus difficiles à exploiter. Une « course à l’appropriation » de ces ressources non renouvelables est d’ores et déjà lancée avec des projets d’exploitation et de forages qui se sont multipliés ces dernières années en Arctique. L’ouverture d’une nouvelle voie maritime dans l’Océan Glacial Arctique apparaît de plus en plus crédible au vu de la fonte rapide de la calotte glaciaire. Une voie qui pourrait, dans un futur proche, être navigable une bonne partie de l’année et susciterait par conséquent un intérêt économique certain pour le commerce international car elle permettrait de raccourcir les trajets maritimes de 4000 kilomètres selon Oleg Kobzeff, spécialiste de l’Arctique et de la Russie. Mais cette nouvelle voie maritime commence déjà à être empruntée par des compagnies maritimes à l’instar du Crystal Serenity, un paquebot de luxe qui est censé rallier l’Alaska à New York par cette nouvelle voie : virée qui est loin de faire l’unanimité dans une région aussi préservée et inhospitalière que l’Arctique. Un nécessaire renforcement de la coopération dans la gestion future de l’Arctique Face à ces changements profonds en cours dans cette région, une coopération intergouvernementale a commencé à voir le jour il y a un demi-siècle avec la création successive de deux conseils régionaux, une première étape qui devra faire l’objet d’un approfondissement pour produire des résultats significatifs. Premièrement, le Conseil Nordique, apparu en 1952, a été crée pour assurer un dialogue intergouvernementale entre les pays nordiques. Cependant, il se heurtait à de nombreuses difficultés en raison des différences culturelles, économiques et sociales des Etats et peuples qui le composaient. Deuxièmement, pour enrayer les défauts du premier, a été créé en 1996 le Conseil de l’Arctique. Ce Conseil est considéré comme une véritable construction institutionnelle : il est composé des 8 états arctiques dont la Russie, les Etats-Unis, le Canada, la Norvège mais également de représentants de peuples autochtones et enfin des Etats observateurs, des Organisations Internationales et des ONG. Cette composition élargie à l’ensemble des acteurs principaux de la scène internationale contribue au renforcement de la cohésion et de la coopération pour une gestion plus effective et réfléchie de cette région. Cependant, ces deux Conseils sont seulement des instances de discussion. - Même s’ils permettent de diminuer les querelles de souveraineté, ils ne prennent pas véritablement de décision qui contraignent les Etats : les problèmes politiques, militaires et sécuritaires ne sont que très peu abordés. Les sujets évoqués sont davantage la protection de l’environnement, les revendications territoriales, les différends frontaliers et le droit géologique. - De plus, des engagements internationaux ont été promulgués pour encadrer strictement les revendications et les modalités des négociations. Cette volonté s’est concrétisée avec la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 institué comme mécanisme de règlements de certains litiges pour définir les frontières communes et l’étendue des plateaux continentaux : convention qui s’applique alors dans cette région de l’Arctique. Des tensions sous-jacentes entre les grandes puissances qui rendent la coopération fragile. Malgré une volonté louable des Etats de se réunir et de discuter du futur de cette région fragile, l’Arctique n’est pas épargné par les tensions géopolitiques actuelles, au contraire. Il est un des lieux de tension entre les deux grandes puissances que sont la Russie et les Etats-Unis, faisant émerger l’idée d’une nouvelle Guerre froide sur cette partie du globe. L’Arctique est source de richesse, et ces puissances le savent. Ainsi, pour éviter tout blocage dans son exploitation, la plupart d’entre elles ont exprimé leur hostilité à la signature de tout traité international sur l’Arctique lors de la déclaration d’Ilulissat de 2008 contrairement à son homologue du Sud - l’Antarctique - qui bénéficie d’une protection importante. L’Arctique est vu alors comme le nouveau Far West avec des opportunités de conquête où « tout le monde veut sa part du gâteau » illustré par l’ouverture de bases militaires russes dans cette région, ce qui est source de tension. Pour ce qui est des voies maritimes, des divergences de vision sur la circulation maritime se font sentir où chacun tente de préserver son intérêt : là où le Canada développe une vision nationale, la Russie adopte une vision régionale où elle s’arroge un plateau continental tandis que les Etats-Unis sont enclins à considérer ces nouvelles voies avec une vision globale où la liberté de navigation serait reine ; l’intérêt pour les USA étant de garder une supériorité maritime. Enfin, ces tensions entre les puissances relèguent au second plan l’opinion des populations inuits qui sont les victimes de cette course et dénoncées par les responsables locaux qui misent sur l’opinion publique et l’union de ces peuples pour enrayer ces tensions. L’Arctique : une attractivité incompatible avec les problématiques environnementales actuelles. L’Arctique est l’un des épicentres où les changements climatiques sont et seront les plus visibles : sans réactions rapides et concrètes, l’impasse sera proche. (sur le plan régional) La fonte inexorable de la banquise et de la calotte glacière ont des répercussions sur tout l’environnement de l’Arctique qui dispose par ailleurs d’une biodiversité unique et fragile. C’est pour cette raison que Greenpeace considère que cette partie du globe doit être déclarée réserve naturelle mondiale au même titre que l’Antarctique. En plus d’affecter la biodiversité locale, ces mutations pourraient affecter les populations locales vivant dans cette région. Ce phénomène ne pourra être endigué sans lutter contre l’exploitation des ressources notamment pétrolières de la région. Extractions considérées pour beaucoup comme fortement risquées pour l’environnement ; on peut en avoir un aperçu avec la catastrophe de l’Exxon Valdez sur les côtes de l’Alaska en 1989 mais encore avec les déversements importants des entreprises pétrolières russes dénoncés par la population autochtone et les écologistes du monde entier. Le problème majeur étant que les pays voisins de l’Arctique bénéficient d’une zone économique exclusive de 360 kilomètres qui fait que la majorité des ressources relèvent en général du contrôle des Etats. (Sur le plan planétaire) L’Arctique est une véritable bombe climatique à retardement puisque les conséquences de la disparition des surfaces glacières aurait des conséquences colossales et irréversibles sur l’ensemble de la planète. Si les efforts de la part de la communauté internationale ne se font pas sentir dans ces prochains décennies - ou même années au vu de l’urgence de la situation - la fonte complète de la banquise accélérera le réchauffement climatique pour plusieurs raisons … On a tendance à croire qu’en réduisant seulement nos émissions de dioxyde de carbone (CO2), les risques d’une future catastrophe climatique et d’une augmentation trop importante de la surface des océans seraient limités. Or, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque : - la disparition de la banquise diminue la surface de réflexion du soleil sur la glace, la chaleur pénètre alors dans les mers et réchauffe de ce fait plus rapidement la planète. - la disparition de la banquise perturberait les courants océaniques et dérèglerait encore davantage le climat de l’ensemble de la planète : les phénomènes météorologiques extrêmes seraient alors démultipliés. - enfin, et c’est en cela que la lutte est urgente : le METHANE. Il est aussi un gaz à effet de serre, à la seule différence que ses effets sont 23 fois plus importants que le CO2. Or, ce gaz est présent en quantité astronomique en dessous du permafrost. Si la fonte atteint ces réserves , il sera alors rejeté dans l’atmosphère, ajouté au fait qu’il ne pourra pas être absorbé par les espèces végétales au même titre que le CO2. Ainsi, les changements profonds qui affectent l’Arctique ne sont pas synonymes d’opportunité d’exploitation et de nouvelles voies maritimes facilitant les échanges internationaux mais plutôt une preuve qu’il est grand temps de s’orienter vers une transition écologique basée sur les énergies renouvelables car le devenir de cette région pourrait déterminer le futur de l’humanité toute entière. Clément HAOUISEE
Le 10 juin 2014, quand Daech plante ses drapeaux noirs sur la ville de Mossoul, désertée par une armée irakienne qui a fui sans combattre, le monde médusé tente de comprendre d'où ont surgi ces djihadistes qui affirment ressusciter dans un bain de sang le califat de Mahomet. Mais comme le rappelle ce documentaire dense et passionnant, le projet politique d'Al-Baghdadi, dont la férocité aveugle se propage dans le monde entier, est né dès 2002, avant même que l'administration Bush ne déclenche l'invasion de l'Irak. Ce sont les erreurs, mais aussi les mensonges de cette dernière, prolongés en Syrie par les tergiversations d'Obama, qui ont permis à Daech de prospérer.
Le maître du chaos Tué à 40 ans, en 2006, lors d'un raid aérien, le terroriste d'origine jordanienne Abou Moussab al-Zarqaoui, alors représentant d'Al-Qaïda en Irak, est ainsi le précurseur du projet sanguinaire dont Abou Bakr al-Baghdadi a repris le flambeau. Comme Ben Laden, qui a commencé par le mépriser, son arme est la terreur médiatisée et spectaculaire. Mais il dépasse son maître en orchestrant l'horreur et le chaos comme armes du djihad. C'est Al-Zarqaoui qui a opéré la première décapitation devant une caméra, signé des attentats spectaculaires à la voiture piégée, dont celui contre le siège de l'ONU, conçu et mis en oeuvre des massacres de masse parmi les foules chiite, dans le but de ranimer la guerre entre communautés musulmanes. Pourquoi les États-Unis, dont les renseignements ont vite repéré le terroriste, vont-ils non seulement le laisser agir, mais même l'instrumentaliser ? Dans ce film convaincant, d'anciens membres du renseignement, dont Nada Bakos, qui a travaillé sur le dossier pour la CIA, des représentants des forces américaines en Irak, l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell - victime d'un étonnant trou de mémoire - et des experts du terrorisme retracent, archives à l'appui, les treize ans de cette guerre perdue contre la terreur. (arte) Ce qu'il ne fallait pas rater hier - l'événement de la journée - c’était évidemment mon premier jour de boulot. C’est aussi la démission de notre cher ministre de l’Economie, de l'Industrie et du numérique. Macron, ce savant mélange qui serait presque un nom de cocktail : Necker-Trudeau-Conway-Underwood-Giscard-Blair-Weber-Pericles.
Necker c’est la « superstar » des finances royales renvoyée par Louis XVI pour ses spéculations et son absence aux États généraux. Justin Trudeau c'est le génie de la communication politique, cette communication politique qui, avec sa touche de cosmétique, de marketing nous fait voter pour des hommes bien plus que pour des idées, où l'homme est le programme, voire le "produit". L'homme politique se vend, il est en représentation permanente, et ça, Macron l'a bien compris. La parole devient l'acte, la forme, le fond. Cela me rappelle la phrase de Laurent Solly, le directeur de l'image de Sarko2007 : "la réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte". Peter Conway, dans House or Cards, est l’excellent candidat républicain qui fait face à un président Frank Underwood plus proche de Sarkozy que d'Hollande dans le style, qui dit de Conway qu'il est excellent dans son rôle de candidat favori des sondages, mais qu'il est une fraud, et ferait un extrêmement mauvais président des USA. L'intelligence politique du Macron tient aussi un peu d'Underwood. Giscard, ce n’est ni la droite, ni la gauche, mais au-delà, au-delà des partis, au-delà des hommes, bref Giscardieu. Dans la même veine, Tony Blair, c'est la rengaine de la troisième voie entre droite et gauche, d'une gauche moderne, le modèle d'un Valls qui doit pas être très content là tout de suite. Max Weber parle quant à lui de "l'entrepreneur politique" thème cher à Macron, le politique qui aimait les entrepreneurs. Ainsi, au bal des Guignols, au pays des bouffons, Macron sait tirer son épingle du jeu. A vaincre sans péril... Il ne faut pas se leurrer, Macron est le meilleur lorsqu’il s’agit de relations et de réseau (d'abord l'ENA, après Rothschild, puis l'Elysee, puis Bercy, bientôt l'Elysée?) et surtout domine sans concession la communication politique - non au clivage droite-gauche, oui je suis un réformiste, un progressiste face aux conservateurs, non je ne répondrai pas à la question fatidique de ma candidature tel un équilibriste, mais je ne parlerai que de la France car je suis différent de ceux qui y pensent tous les matins en se rasant, d'ailleurs je suis super bien rasé. Quid des sujets importants, des sujets qui fâchent ? Je suis aussi habile pour éviter de me mouiller, dire que les 35h, c'est mal, c'est peu. Dire que l'honnêteté me force à vous dire que je ne suis pas socialiste - la foudre frappe le blasphémateur, c'est l'abolition de l'esclavage et la chute du Mur de Berlin, c'est ce qu'il faut retenir de 2016. Le plus triste dans tout ça, c'est que Macron, l'acteur en représentation, est le meilleur comédien, et qu'ils ne sont tous que des comédiens, si ce n’est des bouffons. Macron est le pire présidentiable, à l'exception de tous les autres. Macron a beau être l'ambigu Monsieur Macron, il a beau être descendu de son piédestal de non-politicien - en faisant habilement croire qu'avec lui ce serait différent, considérant les autres comme des politiciens et en en devenant un par là-même - peut-être sera-t-il moins pire que les Sarko, Le Pen, Mélenchon, Montebourg, Hollande, voire Juppé ? Surtout il n'a que deux ans de vie publique, et propose une offre politique neuve nous rappelant ainsi que notre démocratie si elle est inerte est toujours en vie. Macron a le don de créer un sentiment de nostalgie chez les déçus de toujours qui un jour ont cru en Sarkozy ou en DSK mais qui ont vu leurs illusions brisées dans le tumulte du pouvoir temporel. Alors enfin peut-être Macron sera-t-il Périclès, l'aristocrate réformateur? Macron vient d'une bonne famille et il est issu de l’aristocratie énarchique. Mais auras-tu le courage de mener des réformes si tu gagnes? Car quitter le Titanic hollandiste et tuer le père, c'était le passage d'un Rubicon politique, mais cela ne demande pas le courage des réformes. Seras-tu Périclès? Auras-tu les tripes, pour ne pas dire autre chose? P.S.: à chaque fois qu'on nous parle de nouveauté, de progrès, de changement, se dire qu'il y a anguille sous roche. P.S.2: pas besoin de détruire Sarkollandepenenchon, ou si, mais y aurait tellement à écrire. P.S.3: après les platitudes débitées à la Mutualité en juillet - ce qui atteste de la "politicianisation" de Macron - j'aimerais savoir ce que lui et ses conseillers pensent des questions sociales et sociétales actuelles, qui ne sont pas que de vaines "polémiques stériles", et ne doivent pas être confondues avec le débat-polémique qui les entoure. Ex: islamisme (question), Burkini (détail polémique) P.S.4: back2business pour les politiques. Comme pour les régionales de 2015. Chassez le naturel, il revient au galop. Élément perturbateur : un attentat. Et là, l'ego des politiques paraît bien vain. Problème : les terroristes respirent toujours, et nous avons deux primaires et une présidentielle. P.S.5: Macron n'est pas socialiste, mais il aurait gagné à être candidat à la primaire pour avoir un bloc, un parti. Mais il ne le pouvait pas. Triangle d'incompatibilité. P.S.5': Il ne le pouvait pas d'emblée car les vrais socialos-gauchos le détestent et qu'il se positionne comme un non-socialiste de centre-gauche. Difficile positionnement. PS6: s'il gagne, c'est à la faveur d'un contexte inédit, d'une élection totalement imprévisible, et aussi grâce au soutien populaire, car il n'a pas de parti derrière lui, or on ne gagne pas sans parti, sauf VGE. P.S.7: j'arrête. P.S.8: sauf VGE. Grâce au peuple, ce qui fait très démocratie athénienne. J'arrête vraiment. PS9: le PS ne mérite pas d'articles. PS10: mes P.S., si. Bref, ne soyons pas dupes de Monsieur Macron - et des politiques en général, pour n'être pas déçus, n'en attendez pas trop d'eux et ne soyez jamais dupes, surtout les hommes providentiels, car dans hommes providentiels, il y a hommes - reconnaissons-lui des qualités, qui aime bien châtie bien, les autres sont bien pires. A contempler l’état de la droite française, on finit par se dire que l’identité n’est ni heureuse, ni malheureuse, mais dangereuse. Il n’est pas un jour qui s’écoule sans que, parmi Les Républicains, des voix s’élèvent, tenant des propos où la légèreté le dispute à la dangerosité, l’incompétence à l’ignorance, le cynisme à l’arrivisme.
Ces derniers jours, ces dernières heures, se sont ainsi succédées des déclarations qui disent une droite française malade du virus identitaire comme jamais elle ne l’a été depuis les années 40. La folie médiatique burkini a lancé les uns et les autres dans une course à la surenchère médiatique. Sarkozy, Fillon, Wauquiez, mais aussi Nathalie Kosciusko-Morizet… C’est à celui qui osera la plus grosse des énormités, prononcera la plus absolue stupidité, le tout dans le but de complaire à un électorat de droite qui serait saisi par le vertige identitaire, vautré dans le populisme chrétien, et qui ne demanderait qu’à être inquiété, affolé, apeuré par le spectre du musulman qui le menacerait de le remplacer… Commençons avec François Fillon. Voici l’ancien Premier ministre, candidat à la Primaire qui, lors de son discours de dimanche dans la Sarthe, déclare : « J’ai réclamé le contrôle administratif du culte musulman tant que son intégration dans la République ne sera pas achevée ». Le présupposé est intéressant. « Le culte musulman » ne serait pas encore intégré dans la République. Et le propos vise tous les musulmans, sans distinction. Tous présumés coupables de ne pas avoir achevé leur intégration républicaine. Tous suspects. Tous encore un peu étrangers, finalement, du fait de leur religion… Et tant pis pour l’imam de Bordeaux, entre mille exemples, plus républicain que bien de ceux qui se baptisent «Les Républicains » et menacé de mort par l’Etat islamique. Le musulman français est comme l’homme africain face à l’histoire, il n’est pas encore assez entré en République. Pauvre Philippe Séguin… Que de bêtises proférées en son nom… Quand NKM se fait clouer le bec par Yann MoixContinuons le tour d’horizon des déclarations du weekend. Voici Nathalie Kosciusko-Morizet sur France 2, dans l’émission On n’est pas couché. Elle proclame qu’elle a déposé un projet de loi destiné à mettre hors la loi le Salafisme. Face à elle, Yann Moix a eu beau jeu de lui dire que mettre hors la loi des idées, c’est vouloir « interdire le vent ». Mais NKM persiste. Le burkini, c’est le salafisme, alors interdisons le salafisme. Yann Moix, d’un coup, démasque l’imposture. Il demande à la candidate à la présidence de la République ce qu’elle pense de l’article 2 de la loi de 1905. Et là, c’est le naufrage. NKM l’ignore. NKM parle laïcité, identité et fait religieux, mais elle méconnait, en toute incompétence, la base républicaine en la matière. Alors Yann Moix lui cite l’article, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». L’œil de NKM s’éteint. Prise la main dans le sac de l’ignorance. Et Yann Moix l’achève, en lui lisant les propos d’Aristide Briand, l’un des pères de la loi de 1905, qui jugeait stupide d’interdire dans l’espace public la soutane, le burkini de l’époque, au motif qu’un vêtement proscrit serait remplacé par un autre, que cela générerait des tensions et que pour combattre des idées, rien ne vaut des idées. Surtout l’idée de liberté. Poursuivons encore avec Laurent Wauquiez. Toujours muni de ses éléments de langage énoncés en deux cents mots, le nouveau président de Les Républicains est l’invité de BFM TV ce dimanche. Identité, identité, identité… Et la laïcité, encore et toujours triangulée, détournée, dévoyée pour les besoins de la cause identitaire. Au détour d’un échange, il est objecté à Laurent Wauquiez qu’interdire un vêtement parce qu’il refléterait une pensée contre l’idée qu’il se fait de la France serait anticonstitutionnel. Et Wauquiez de répondre : « J'en ai assez que l'on s'abrite derrière la Constitution. » La constitution, insupportable rempart qui empêche de transformer l’insécurité culturelle en printemps français des réactionnaires. Le propos de Wauquiez est hallucinant. Placé dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, en 1990, 2000 ou 2010, il aurait déclenché une tempête médiatique majeure, soient des jours et des semaines à disserter sur la tentation putschiste du président du FN. Mais en 2016, rien. Lorsqu’il s’agit du président en titre du grand parti de la droite dite classique et républicaine. Personne ne bouge. Tout passe, tout lasse. Même Caroline Fourest, face à Laurent Wauquiez, ne relève pas le sens et la portée du propos. Pour Sarkozy le burkini vaut bien un changement constitutionnelPoint d’orgue de la représentation identitaire, terminons avec Nicolas Sarkozy qui, ce lundi matin, vient tirer sur RTL les conclusions pour tous, par-delà les ambitions personnelles. Pour interdire le burkini, il faut « changer la Constitution s'il le faut ». Et l’ancien président de s’interroger : « Qu'est-ce-que la liberté face à la tyrannie des minorités ? » Et nous aussi de s’interroger : quelle est donc cette minorité dite Les Républicains qui entend imposer l’idée qu’elle se fait de l’identité à tous, y compris aux minorités ? Fillon, NKM, Wauquiez, Sarkozy... Ainsi prospère l'identité dangereuse. Face à ce déluge d’absurdités dictées par la maladie identitaire, sur fond de remise en cause de l’héritage de 1789, avec la lutte contre le burkini (ultime objet des passions identitaires) le salafisme et l’islamisme en guise d’alibi, Alain Juppé persiste à se poser en candidat de la raison et du compromis. « Pas de loi de circonstance » sur le burkini a-t-il répété tout au long de ses interventions du week end consacrant sa rentrée politique. Soit. Dont acte. Mais Alain Juppé apparait désormais de plus en plus décalé au sein de la droite et du centre. Isolé. Encerclé. Ainsi va se jouer la Primaire. Entre l’héritier de Renan et Tocqueville, confronté à ceux de Maurras et Déroulède. Entre un conservatisme bourgeois traditionnel, qui se refuse à abdiquer la possibilité d’une identité heureuse, et une tentation réactionnaire identitaire, qui entend saisir la chance historique qui lui offerte d’effacer, en tout ou partie, le legs des Lumières et de 1789. Certains à gauche, pensent que la Primaire de la droite va provoquer une forme d’implosion. Sarkozy serait le candidat de l’identité telle que la rêverait la droite profonde, et non Juppé. Mais la droite profonde serait dans le même temps rétive à Sarkozy, lui préférant le rassurant Juppé, au motif que lui seul peut battre la gauche sans coup férir. La Primaire porterait une contradiction. Sarkozy, ce serait l’identité, mais pas la victoire. Juppé, ce serait la victoire, mais pas l’identité. Ici se mesure la difficulté Juppé. La Primaire est avant tout une élection de mobilisation de clientèle, par nature fédératrice des énergies militantes et sympathisantes les plus débridées. Question : comment Alain Juppé peut-il triompher au sein d’une droite ravagée par l’identitaire au point d’en devenir dangereuse, tout en étant soi-même le candidat de la droite la plus modérée et tempérée ? Voilà bien l’enjeu historique, qui dépasse même la personne du maire de Bordeaux. Tradition gaulliste contre tentation pétainiste. Saison 2. Bruno Roget-Petit pour Challenge http://www.challenges.fr/politique/20160829.CHA2729/sarkozy-nkm-fillon-juppe-face-a-la-droite-de-l-identite-dangereuse.html Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie lors du rassemblement populaire du 7 août 2016. Crédit: page Facebook officielle de Recep Tayyip Erdoğan.
« L’Union européenne a besoin de la Turquie plus que la Turquie a besoin de l’Union européenne » Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie Rétropédalage sur le chemin de la démocratie Les médias sont souvent sensibles à ce qui les concerne en premier lieu. La prise de pouvoir de M. Erdoğan sur Zamman, l’un des principaux quotidiens d’opposition turc, a donc fait les gros titres en Europe au printemps 2016. Mais cela n’est pas un mal : nous avons pris conscience du fait que la Turquie, si proche de nous, se distancie de plus en plus du modèle démocratique proposée par l’Europe. À l’été 2002, l’abolition de la peine de mort a été décidée par le parlement turc dans une optique de rapprochement des principes de l’Union européenne (l’article 2 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union interdit toute peine capitale et est juridiquement contraignant pour les États membres). Un retour de la peine de mort enfreindrait également les protocoles 6 et 13 du Conseil de l’Europe et la Turquie pourrait par conséquent en être exclu. De l'annonce de M. Erdoğan sur la nécessité de poser de nouveau la question de la peine capitale au parlement et du fait qu’il revient au peuple de juger de l’application d’une telle peine, il est possible d’y voir deux choses. D’abord qu’il y a une prise de distance par rapport à la société occidentale, que les médias critiquent de plus en plus pour ses méfaits sur les mœurs et pour son incompréhension de la Turquie (notamment Yeni Akit). Ensuite que cette volonté de remise au peuple du pouvoir n’est rien d’autre que démagogie. Cette démagogie s’exprime aussi dans la vision unitaire du peuple turc que propose le Parti de la Justice et du Développement (AKP) et qui se cristallise autour du problème kurde. Cette minorité subit de nombreuses restrictions et un certain nombre d’infractions aux droits de l’Homme ont été relevées par les observateurs internationaux. Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a mené plusieurs attaques terroristes contre les Turcs, est d’ailleurs l’ennemi public numéro 1 pour M. Erdoğan. Les purges au sein du gouvernement (notamment marquées par le limogeage d’Ahmet Davutoğlu, Premier ministre de 2014 à 2016), ainsi qu'au sein de l’AKP, dont est issu le Président Erdoğan, ont fait du chef d’État une figure incontestée et apparemment intouchable du pouvoir. Ces limogeages — qui n’ont pas épargné non plus la sphère économique — ont aussi souligné la ligne politique qu’empruntait M. Erdoğan, plus conservatrice sur le plan sociétal, que ses prédécesseurs. M. Erdoğan est aussi accusé d’enfreindre, au passage, les dispositions de la Constitution sur la neutralité politique de la fonction présidentielle. Une société turque fragile Mais l’ère Erdoğan ne vient pas de nulle part. L’AKP est arrivée au pouvoir dans une vague d’exaspération liée à la situation économique du pays. Depuis M. Erdoğan a voulu s’inscrire dans une histoire turque plus large. Alors que sur le plan économique il continuait les réformes libérales, sur le plan sociétal, il a aussi voulu incarner la continuité avec la « grande histoire ». Les six principes du kémalisme — que l’on doit au premier Président turc, Mustafa Kemal Atatürk — qui ont fondé la République, ont été énoncés de façon formelle dans la Constitution : « L’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (1937). Ce qui est frappant aujourd’hui, c’est que la crispation religieuse que l’ont voit surgir en Europe n’épargne pas la Turquie et s’inscrit en faux des principes d’Atatürk. Le Président Erdoğan, qui a été emprisonné quatre mois à la fin des années 1990 pour avoir « menacé le sécularisme » en ayant récité des vers de Gökalp, est en quelque sorte le témoin de ce renouveau religieux. Il a suivi l’ascension de Recep Tayyip Erdoğan, Maire d’Istanbul au poste de Président. De retour au pouvoir, comme Premier ministre (2003), puis comme Président (2014), M. Erdoğan a renoué avec un certain ottomanisme, notamment pendant les campagnes électorales. Cette propension à rappeler le mythe ottoman au cœur de la politique contemporaine a fait de M. Erdoğan une sorte de nouveau sultan turc. Aussi, la tentative de coup d’État dans la nuit du 15 juillet 2016 est la conséquence de cette dérive autoritaire en rupture avec la tradition républicaine kémaliste. Le putsch mené par plusieurs factions issues de l’ensemble des corps d’armée turcs a pour but de « rétablir la démocratie ». Les appels sur CNN Türk des Présidents Erdoğan et Gül via FaceTime ont incité la population à se rebeller contre l’instauration de la loi martiale voulue par les putschistes. Au delà d’une tentative de coup d’État telle qu’a pu en connaître la Turquie à plusieurs moment de son histoire (en 1960, 1971, 1980 et 1997), ce sont les répercussions, la répression, qui ont montré la vraie teneur du régime de M. Erdoğan. Pour le président turc, les arrestations en masse après le putsch raté ont été critiquées trop vite par des occidentaux qui ne saisissent pas véritablement, selon lui, les enjeux présents. À l’en croire, le duel qui l’oppose à M. Gülen serait la cause de la rébellion. L’imam, Fethullah Gülen, et Recep Tayyip Erdoğan partagent pourtant la même vision de la Turquie : un pays qui doit devenir une république religieuse au centre du monde sunnite. Le Président avait d’ailleurs confié de très nombreux postes aux partisans de l’imam, les Gülenistes, qui voulaient moderniser l’État tout en accordant une nouvelle place à la religion — d’où l’ampleur des purges actuelles. L’État est infiltré depuis longtemps par les Gülenistes ; ils ont dès 2007 manipulé par exemple le recrutement de l’armée. Après de faux procès lancés par les Gülenistes contre les kémalistes et des négociations à couvert avec le PKK en 2012, M. Erdoğan s’est déclaré en rupture avec le mouvement de Fethullah Gülen. Il est encore trop tôt pour savoir si, oui ou non, les Gülenistes sont responsables de la tentative de coup d’État mais force est de constater que le mouvement a servi de bouc émissaire récurrent pour l’État turc depuis les années 1990. Dans tous les cas, l’Europe nourrit des inquiétudes pour l’État de droit en Turquie. La Turquie est-elle le jouet de l’Europe ? Au printemps 2016, l’État turc s’est révélé à l’Occident comme un partenaire majeur. Alors que la Turquie était relativement invisible sur la scène médiatique de l’Europe de l’Ouest, elle est aujourd’hui une préoccupation majeure des médias comme des hommes politiques. La cause ? L’Europe a besoin d’elle. La vieille mythologie de l’Europe centrale nous rappellera que l’Empire ottoman, et plus récemment la Turquie, est avant tout un espace de transition, un espace de confrontations. Celui du monde chrétien et celui du monde musulman. Sans nul doute, les velléités nationalistes des XIXème et XXème siècles (et celles naissantes du XXIème siècle) ont réveillé le mythe d’un mur des pays de l’Est, protecteur de la veille Europe. M. Orbán, le Premier ministre hongrois, ne s’est pas privé de ranimer la vieille victoire de 1686, année pendant laquelle les Hongrois ont bouté hors d’Europe l’ennemi ottoman. Mais c’est pour préserver les intérêts électoraux d’hommes comme M. Orbán que l’Europe a dû se plier à un accord. Le mur de l’Europe ne devait pas céder. Aussi l’accord sur les réfugiés du 18 mars dernier ouvre la voie à un changement de grande ampleur : les Turcs doivent à terme accéder sans visa à l’espace Schengen (cf. point 5, EU-Turkey Statement, 18/03/2016). Un tel changement incite l’UE à s’intéresser encore plus à la vie intérieure du pays. Après une telle compromission, il est évident que l’Europe ne peut que prier pour que l’État turc respecte ses paroles. L’instabilité politique du pays ne fait que fragiliser cet accord — d’où, d’ailleurs, le recul fréquent de la date à laquelle les Turcs pourront voyager en Europe sans visa. Et M. Erdoğan s’en amuse dans son entretien récent au Monde, où il n’hésite pas à mentionner la précarité d’un tel accord. En quelque sorte, il fait chanter les Européens. Peut-être que les dirigeants européens auraient dû se féliciter de la victoire de M. Erdoğan sur les putschistes, comme l’a suggéré Carl Bildt, ancien Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères suédois : « L’UE aurait été dans une bien meilleure position aujourd’hui si les dirigeants européens s’étaient rendus immédiatement en Turquie pour exprimer leur horreur vis-à-vis coup d’État et avaient félicité le peuple turc pour l’avoir défait. […] Bien sûr, il n’y a pas de garantie que cela aurait empêché le pays de glisser vers plus d’autoritarisme. Mais l’Europe aurait au moins essayé de se lever pour ses idéaux politiques et ses valeurs démocratiques. » Carl Bildt, ‘Europe, stand up for Erdogan’, Politico Europe, 02/08/2016 Cet absence de sympathie des dirigeants européens a peut-être fait glisser les relations de l’UE avec la Turquie vers encore plus d’hypocrisie. Tout le monde sait que les négociations entre la Turquie et l’Union européenne sur une hypothétique adhésion ne sont que nonsense. Pour l’Union européenne, une adhésion turque est plus qu’improbable : la Turquie ne répond pas aux plus précieux des critères d’adhésion, les critères de Copenhague (p.ex. démocratie, droits de l’homme, droits des minorités ou liberté). Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, l’a encore répété sur le plateau de France 2 le 25 juillet 2016 : « la Turquie, dans l'état où elle se trouve, n'est pas en situation de pouvoir adhérer sous peu, ni d'ailleurs sur une plus longue période ». Qui plus est, une adhésion renverserait les équilibres européens en faisant de la Turquie le pays le plus peuplé d’Europe. Alors pourquoi la Turquie et l’Union continuent-elles de jouer un jeu qui n’apporte a priori rien de nouveau aux deux parties ? Ces négociations créent un espoir dans la société turque et donne une image d’une société proche des valeurs de l’UE sur la scène extérieure. En quelque sorte, elle sert de garantie au pouvoir d’Erdoğan. Pour l’Union européenne, c’est un mandat tacite pour prendre position sur la politique intérieure turque. Malgré tout, on peut considérer que cela compromet l’intégrité de l’Union, au sens où nous nous associons à un régime qui contredit les principes clefs de nos Traités. Ainsi, le fait de s’associer à la Turquie souligne deux choses pour les institutions et les partenaires européens : primo, la grande détresse des gouvernements face à la crise des réfugiés et, secondo, l’impossibilité d’exclure la Turquie du champ des partenaires de l’Union. Une voie dangereuse : le risque d’être mis à la marge Mais si le rôle européen de la Turquie est reconnu par l’UE depuis longtemps, le comportement des dirigeants turcs et la situation géopolitique de l’Anatolie risquent de faire de la Turquie un paria sur la scène mondiale. Depuis quelques jours, des voix s’élèvent aux États-Unis pour exiger le retrait de l’armement nucléaire américain entreposé en Turquie. M. Anderson, ancien du National Security Council et consultant de la Nuclear Threat Initiative, a ainsi publié une tribune dans le Los Angeles Times pour souligner les risques d’une présence d’armes nucléaires américaines en Turquie : outre la situation géographique de la base d’Incirlik (en zone frontalière avec la Syrie), il va de soit que l’instabilité politique du pays et la perte de confiance dans l’État d’Erdoğan sont aussi à l’origine des risques pressentis. La base d’Incirlik a ainsi été fermée quelques temps à la suite du coup d’État. Tout cela, alors même que la Turquie est membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Doit-on sous entendre que la Turquie pourrait être l’un des nouveaux dangers sécuritaires en Europe ? M. Erdoğan n’a cessé de rappeler que la Turquie était la frontière avancée de l’Europe, notamment avec les territoires aux mains des terroristes. La stabilité du pays est donc un enjeu essentiel pour l’OTAN et, avant tout, l’Europe puisque des terroristes islamistes transiteraient par les frontières turques. Mais les relations de la Turquie avec le cœur de l’alliance, les États-Unis, sont encore loin d’être paisibles. Les accusations et la demande d’extradition de M. Erdoğan contre M. Gülen, installé depuis 1999 aux États-Unis, ont contribué à refroidir encore plus les relations avec la Maison Blanche. L’exigence du président turc de procéder à une extradition sans laisser le Département de la Justice gérer la procédure relève pour les conseillers américains d’une ingérence tout autant que d’une attitude surprenante pour le chef d’un État de droit. D’autant plus que M. Gülen, dans une tribune au Monde, a plaidé son innocence et demandé une enquête internationale sur le coup d’État raté… De l’autre côté du monde, les relations avec M. Putin ne sont pas non plus au beau-fixe. Après qu’un avion russe a été descendu par l’armée turque, la rencontre des deux présidents à Saint-Pétersbourg, le 9 août 2016, devait être l’occasion de renouer des liens entre les deux puissances. Pour les officiels turcs il ne s’agissait pas de tourner le dos à l’Europe, mais il est évident que cette rencontre a de quoi intriguer les diplomates européens. Le comportement de la Russie vis-a-vis de l’Europe et de l’OTAN (notamment dans la crise syrienne) est provocateur ; en suivant son modèle la Turquie risque une mise à l’écart encore plus lourde. Somme toute, la Turquie restera pour l’ère qui s’ouvre un enjeu majeur de la politique européenne (intérieure et extérieure). Le défi posé à l’Europe est incommensurable. Il nous faudra, nous Européens, faire face à la montée d’un autoritarisme croissant en promouvant nos valeurs tout en nous trouvant obligés de traiter avec le régime turc pour assurer notre sécurité et notre prospérité, ainsi que la stabilité de l’Europe. Alexis Chalopin Étudiant en Affaires européennes (Sciences Po & London School of Economics) [email protected] Les événements en Turquie compromettent les chances du pays de rejoindre l'UE. Les Vingt-Sept doivent alors songer à lui donner une nouvelle place. Ils ne peuvent se passer de ce partenaire stratégique majeur.La tentative avortée de coup d’Etat par une fraction militaire de l’armée a créé un flottement au sommet de l’Etat, le soir du 15 juillet, alors que les mutins bombardaient l’Assemblée nationale et le siège des services secrets à Ankara, et que les ponts sur le Bosphore, à Istanbul, étaient occupés par des blindés.
Au lendemain de ces événements, la question qui se pose est plus que jamais celle de l’avenir de la Turquie et de l’évolution du régime politique de Recep Tayyip Erdogan. Le président sort incontestablement renforcé de ce nouvel affrontement entre l’Etat profond, c’est-à-dire les tenants du kémalisme à l’ancienne, principalement l’armée, et les islamo-conservateurs incarnés par l’AKP (Adalet Kalk?nma Partisi), le parti de la justice et du développement. Puissance régionale La Turquie a connu, depuis l’accession au pouvoir de l’AKP en 2002, une vaste libéralisation de l’économie. En treize ans, le PIB a plus que doublé, faisant de la Turquie la première puissance économique régionale, devant l’Arabie saoudite ou l’Iran. Ce succès trouve son origine dans plusieurs facteurs. D'abord, la prise du pouvoir par une élite islamo-conservatrice, qui a mélangé libéralisme économique et conservatisme social. Puis, la personnalité d’Erdogan, actuel président, devenu Premier ministre en 2003, qui a stabilisé le gouvernement turc par son autoritarisme emprunt à son ancien passé de maire d’Istanbul et de cadre islamiste incarcéré par l’armée. Enfin, l’AKP qui a habilement joué du processus d’adhésion à l’Union européenne, relancé depuis 2002, pour asseoir son pouvoir à l’encontre des kémalistes, et désormais de Fethullah Gülen . Le chef de la confrérie des Gülénistes, qualifiés de « jésuites » turcs car disposant d’un vaste réseau d’écoles formant l’élite turque, est exilé en Pennsylvanie. Quatre années de crise Cependant, cette période faste de croissance économique et de stabilité institutionnelle a volé en éclats à cause de trois facteurs. Tout d’abord, la Turquie est entrée, depuis 2012, dans une période économique incertaine en raison de la sortie des capitaux et de la défiance des investisseurs à l’égard des puissances émergentes. Ensuite, la Turquie s’est engagée sur le chemin de la guerre en prenant la tête de la coalition anti- Assad, ce qui a conduit à financer et armer indirectement les mouvements d’opposition islamistes en Syrie, puis à s’opposer à la Russie et aux mouvements kurdes. Cet engagement militaire direct a mis fin à la « doctrine Davutoglu », du nom de l’ancien premier ministre turc, qui visait à pacifier la région grâce à la politique du « zéro problème » avec ses voisins. Enfin, les négociations ouvertes avec le PKK, ainsi que le rapprochement avec l’Arménie, ont volé en éclats. Le conflit avec le PKK s’est réouvert, embrasant les régions kurdes en Turquie depuis l’été 2015. Dès lors, la Turquie a dû faire face à deux mouvements terroristes distincts (Daech et le PKK), tout en poursuivant le raidissement autoritaire du régime Erdogan, dont la tentative de coup d’Etat du 15 juillet va achever de convaincre le puissant président de la nécessité de mettre l’armée et les institutions « au pas ». Pays tiraillé Derrière ce grand jeu stratégique, le destin de la Turquie est en jeu – et un peu le nôtre tant ce pays joue un rôle tampon majeur pour les Européens comme l’a montré la crise des migrants – aussi bien son arrimage européen que son émergence économique comme pays quasiment développé. Or, la classe moyenne turque aspire à une évolution stable et démocratique du régime, comme les émeutes autour du parc Gezi à Istanbul, en juin 2013, l’ont démontré. La Turquie est à la recherche de son identité et de sa voie de développement. Faut-il continuer le vieux rêve de rejoindre l’Europe ou trouver son propre « Sonderweg » en renouant avec le rêve impérial néo-ottoman ? La Turquie est tiraillée entre les différentes faces de ses identités : identité occidentale et orientale, mais également identité religieuse et laïque, ou encore démocratique et autoritaire. Un nouvel espace économique Dans ce cadre, il est nécessaire de réfléchir aux relations entre l’Europe et la Turquie, dont l’émergence économique, démographique et le poids régional en font un partenaire stratégique majeur. Selon Nicolas Sarkozy, il est désormais temps pour l’Union européenne de prendre ses responsabilités en arrêtant de négocier une adhésion sans issue. Il a d’ailleurs proposé de créer un Espace commun entre l’Union européenne, la Russie et la Turquie afin d’arrimer nos deux grands voisins. Cette nouvelle architecture pourrait être qualifiée d’Espace de coopération économique et de sécurité (ECES), lequel permettrait d’offrir une perspective commune à Moscou et Ankara, plus que jamais déterminées à retrouver un chemin impérial tsariste et ottoman. Pour Ankara, il s’agit de trouver une juste voie entre l’élite européanisée d’Istanbul et la classe moyenne anatolienne religieuse, symboles d’une Turquie plus que jamais à la croisée des chemins. Laurence Daziano, maître de conférences en économie à Sciences Po, est membre du Conseil scientifique de la Fondapol Dans les échos: http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159048-apres-la-tentative-de-putsch-quelle-place-leurope-doit-elle-donner-a-la-turquie-2015590.php |
AuteurÉcrivez quelque chose sur vous. Pas besoin d'en rajouter, mentionnez juste l'essentiel. Archives
Juin 2017
Catégories |
|
L'Objectif est un journal contributif de la jeunesse. For the Youth. By the Youth. Pour vous. Par vous. Pour contribuer, envoyez votre texte à [email protected].
Nous sommes des étudiants, des jeunes de différents horizons, cultures, pensées, animés par une même passion et une même envie: changer les choses qui doivent l'être. Pour cela, commençons par écrire de manière engagée et authentique, et il n'y a pas meilleur moyen que le journalisme. Et vous dans tout ça? Vous êtes inclus dans le Nous, si vous voulez nous rejoindre et mener ensemble notre projet. |


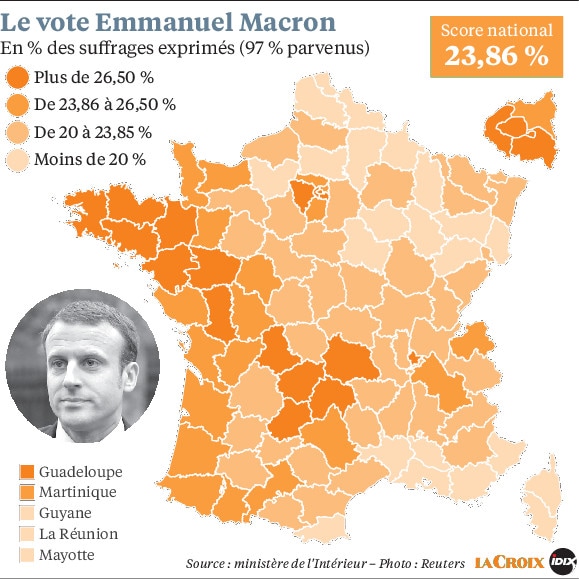



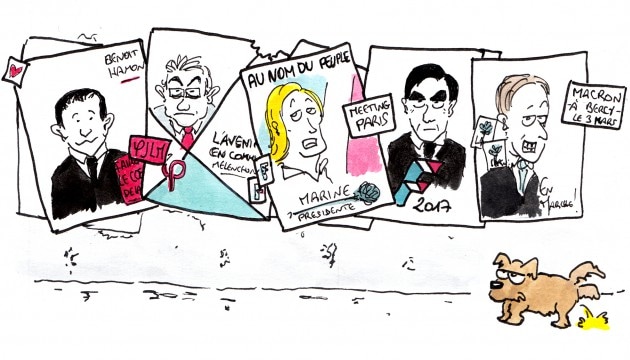







 Flux RSS
Flux RSS